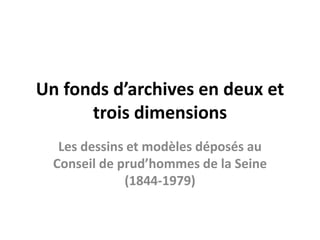
4_NAHON.pptx
- 1. Un fonds d’archives en deux et trois dimensions Les dessins et modèles déposés au Conseil de prud’hommes de la Seine (1844-1979)
- 2. Une composante de la propriété industrielle • Composante de la propriété industrielle, avec les brevets qui protègent des inventions ou des innovations techniques, et les marques permettant de distinguer visuellement un produit, les dessins et modèles sont destinés à protéger l’apparence des objets industriels : lignes, contours, couleurs, forme, texture, matériaux utilisés, etc. Ils se présentent en deux dimensions (dessins, photographies) ou en trois dimensions (échantillons, modèles réduits ou en grandeur nature). • Instaurée par la loi du 18 mars 1806, la procédure de dépôt des dessins et modèles auprès des conseils de prud’hommes permet à tout créateur de produit industriel ou artisanal de prouver ses droits et, le cas échéant, d’engager une action en contrefaçon. Le premier conseil est créé à Lyon la même année pour protéger la production des soyeux lyonnais. • Profondément modifiée par la loi du 14 juillet 1909, cette compétence des conseils de prud’hommes a été transférée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) par la loi du 18 janvier 1979.
- 3. Les dessins et modèles à Paris • Une ordonnance de 1825 donne compétence aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux de première instance pour recevoir les marques et dessins et modèles en l’absence de conseil de prud’hommes. Le Tribunal de commerce de Paris exerce cette compétence jusqu’en 1844, mais les archives en résultant n’ont pas été conservées. • À Paris, quatre conseils de prud’hommes spécialisés sont créés en 1844 et 1847 pour différentes branches industrielles : métaux, tissus, produits chimiques, industries diverses. En 1908, tous les conseils fusionnent au sein du conseil de prud’hommes du département de la Seine, organisé en cinq sections spécialisées : tissus, métaux et industries diverses, produits chimiques, bâtiment, commerce (différends entre patrons et employés de toutes les professions). • Les premiers dépôts sont effectués en 1845. Les collections des Archives de Paris commencent dès cette époque et s’arrêtent en 1979. Malgré d’importantes lacunes, ce sont plusieurs centaines de milliers de dessins et modèles qui sont parvenus jusqu’à nous, occupant plus d’1,5 kilomètre linéaire de rayonnages. Les dépôts étaient décrits dans plusieurs séries de registres (procès-verbaux, déclarations ou certificats de dépôts, enregistrement, répertoires alphabétiques des déposants, etc.) qui peuvent aujourd’hui servir de clés d’accès au fonds.
- 6. Un conservatoire de la création industrielle • Véritable conservatoire de la création industrielle parisienne des XIXe et XXe siècle, ce fonds fait la part belle aux arts décoratifs et à l’industrie du luxe, particulièrement bien représentés à Paris. • Il comprend également une variété infinie d’objets du quotidien, outils et machines, de tous usages, de toutes natures et de toutes qualités. • Ce grand bazar de l’innovation constitue ainsi un corpus de sources d’une richesse inégalée sur l’histoire de la culture matérielle à l’âge industriel. • Les dépôts se répartissent entre les quatre des cinq sections spécialisées établies en 1908 : tissus, métaux, industries diverses, produits chimiques, bâtiment.
- 7. Greffe puis section des Tissus • Les dépôts du greffe (jusqu’en 1908) puis de la section des tissus incluent de nombreuses créations en nature ou en reproduction de modèles de vêtements, d’accessoires et de textiles vestimentaires. Les plus grands noms de la haute couture, tels Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Jean Patou ou Christian Dior, côtoient de plus modestes artisans : modistes, chausseurs, fabricants de corsets, de tournures ou de châles, etc. • Les textiles d’ameublement ou de décor sont également présents, comme les très belles impressions sur coton des maisons Steinbach, Koechlin et Cie, ou Wilhelm, Frey et Cie. • À partir des années 1930, les dépôts de haute couture se raréfient, en raison d’une jurisprudence qui reconnaît de plus en plus le droit d’auteur des couturiers créateurs. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1934 en faveur des maisons Vionnet et Chanel consacre cette possibilité de cumuler les propriétés industrielle et intellectuelle.
- 8. Coussin de senteur orné d’une photographie de toréador imprimée sur étoffe, déposé par le photographe Adolphe Disdéri le 17 mars 1866
- 9. Modèle de corset, déposé en nature et en photographies par Auguste Soustre le 15 mai 1900
- 10. Photographie d’un manteau déposée par Sonia Delaunay le 13 juin 1925
- 11. Échantillon de tissu déposé par la maison Chanel le 27 décembre 1928
- 12. Greffes puis section des métaux et industries diverses • Les conseils des métaux et des industries diverses fusionnent en 1890 au sein d’un seul conseil, devenu section en 1908. • Cette section était dépositaire de productions très variées : l’orfèvrerie et la joaillerie, illustrées par des maisons comme Christofle ou Cartier, mais aussi l’automobile, l’aéronautique, les appareils mécaniques, électriques, photographiques, radiophoniques, cinématographiques, médicaux, etc. • Jusqu’en 1890, date de la création du conseil du bâtiment, les artisans du bois peuvent également y déposer leurs créations, tels les dessins de marqueterie de la maison Volkert déposés en 1850.
- 13. Photographie de chandelier, déposée par la maison Christofle le 22 mai 1933
- 14. Greffe puis section des produits chimiques • Comme son nom ne l’indique pas, la section des produits chimiques couvre aussi des domaines très divers, tels que la céramique, le verre, le conditionnement des produits alimentaires, les jouets, l’impression et la publicité. • Là encore, les objets de luxe, comme les cristaux de Baccarat et de Saint-Louis ou les flacons de parfum Guerlain, voisinent avec des produits de grande consommation : bouteilles de verre blanc, vaisselle de céramique commune, carrelages, boîtes et emballages de carton, jouets, jeux de société, etc.
- 15. Trois flacons déposés par la maison Guerlain le 7 février 1903
- 16. Greffe puis section du bâtiment • Le conseil du bâtiment est créé en 1890. Il devient une section du conseil de prud’hommes de la seine en 1908. • C’est l’une des sections les moins bien couvertes par les instruments de recherche existants. • La grande majorité des dépôts est composée de modèles de meubles déposés par des ébénistes, menuisiers, architectes, décorateurs, ingénieurs, etc. • On peut également y trouver toutes sortes de luminaires, appareils électriques, poêles, chaudières, accessoires et outillages, etc.
- 17. Les grandes étapes de l’entrée du fonds aux Archives de Paris • Les premiers versements ont lieu en 1939-1940 et concernent les sections des métaux, produits chimiques et tissus, pour la période 1917- 1934 principalement. • Les doubles de la section des tissus sont transmis à la photothèque du musée des Arts décoratifs. • Le reste du fonds est versé au début des années 1990, à la faveur du regain d’intérêt pour l’histoire et les archives relatives au monde du travail et à l’industrie. L’impulsion de Brigitte Lainé, conservatrice en charge des archives judiciaires, fortement encouragée par Jean-Marie Jenn, directeur des Archives de Paris a été déterminante. • Des lacunes importantes sont alors constatées tant dans les dessins et modèles proprement dits que dans les registres qui servent de clés d’accès. Le fonds de l’INPI est également incomplet.
- 18. Cave du conseil de prud’hommes, vers 1990
- 19. État des collections Périodes Modalités de dépôt Tribunal de commerce (Archives de Paris) - 1825-1858 Conseil des prud’hommes de la Seine (Archives de Paris) - 1844-1979 ONPI/INPI - 1901-1979 1825-1858 1, 3, 5 ans et perpétuité Tout est détruit / / 1845-1910 1, 3, 5 ans et perpétuité / dépôts publiés transmis à l’ONPI à partir de 1910 / Ne sont conservés que les dépôts à perpétuité (hors dépôts transmis à l’ONPI/INPI à partir de 1910) Tout est détruit sauf les modèles publiés à partir du 20/01/1910 1910-1917 5 ans au secret / dépôts au secret prorogés et dépôts publiés transmis à l’ONPI / Tout est détruit (hors modèles publiés transmis à l’ONPI/INPI à partir de 1910) Tout est détruit sauf les modèles publiés à partir du 20/01/1910 1917-1930 5 ans au secret / dépôts au secret prorogés et dépôts publiés transmis à l’ONPI/INPI / Tout est conservé (hors modèles publiés transmis à l’ONPI/INPI à partir de 1910) Tout est détruit sauf les modèles publiés 1930-1979 5 ans au secret / dépôts au secret prorogés et dépôts publiés transmis à l’ONPI/INPI / Tout est conservé (hors dépôts transmis à l’ONPI/INPI) Tout est conservé (sous réserve pour les années 1930-1940)
- 20. Un « monstre » archivistique ? • Depuis les premiers versements, ce fonds a posé et continue de poser une infinité de questions d’ordre juridique, archivistique, matériel et culturel. S’agit-t-il vraiment d’archives ? Ne faudrait-il pas plutôt les conserver dans un musée ? Comment les conserver dans un dépôt d’archives conçu pour le stockage de documents en deux dimensions ? Peut-on renoncer à les prendre en charge ? Comment les classer et les décrire ? Comment les communiquer, les diffuser, les valoriser ? Toutes ces questions ont un malheureux point commun : la doctrine, la culture et la pratique archivistiques françaises, très centrées sur les documents textuels sur papier, n’y apportent que des réponses insuffisantes, incomplètes ou inadaptées. • C’est donc nécessairement de façon empirique et évolutive que les Archives de Paris ont tenté d’appréhender ce fonds tout à la fois passionnant, rebutant et extrêmement attachant.
- 21. Premières réponses • Il ne fait aucun doute que ces matériaux répondent pleinement à la définition des archives du code du patrimoine, au même titre que les maquettes d’architecture, les enregistrements sonores des assemblées des collectivités, les photographies des services techniques, etc. • Les musées sont certainement encore moins bien armés que les services d’archives pour conserver une collection d’un tel volume. • Quoiqu’il en soit, la grande valeur patrimoniale de ce fonds justifie sa conservation définitive . À Paris, ce sont les Archives qui l’ont pris en charge. Dont acte ! • Grâce à l’engagement sans faille de Brigitte Lainé, il a été sauvé et en grande partie traité et mis en valeur. Depuis 2015, il représente une des toutes premières priorités scientifiques et culturelles du service. • Malgré des difficultés nombreuses et de tous ordres, nous tentons de nous donner les moyens de le conserver, de le rendre accessible et de le valoriser dans les meilleures conditions possibles, avec persévérance et humilité ! • Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier la petite équipe des dessins et modèles (moins de 2 ETP), aujourd'hui représentée par Jean- Charles Virmaux et Marie-Pierre Lambelin.
- 22. Quelles solutions en matière de conservation préventive ? • L’état initial du fonds était déplorable, mais les boîtes scellées ont relativement bien protégé leurs contenus. • Le fonds a été déménagé plusieurs fois. Il a subi des inondations et des infestations de moisissures à la fin . • Dans les années 1990, un travail considérable a été mis en œuvre pour conditionner une grande partie du greffe des tissus : photographies, dessins, notices et échantillons placés dans des pochettes en polyester rangées dans des classeurs de conservation. Parallèlement, une campagne de mise à plat et de restauration de nettoyage des photographies a été entreprise en interne. • En 2016, un protocole de traitement matériel a été élaboré. Des choix ont été té faits en matière de conditionnement et de rangement matériel.
- 24. Vers un traitement normalisé • Jusqu’aux années 2010, le fonds a été traité selon des méthodes qui ont beaucoup varié dans le temps : fichiers manuels et manuscrits, répertoires numériques détaillés couvrant des parties de fonds, documents bureautiques ne facilitant pas les recherches. Le ir finalisés sont en ligne. • Une grande partie du fonds était dans un vrac complet. Les déménagements successifs avaient accentué le désordre constaté dans les caves du Conseil de prud’hommes. • A partir de 2016, une grille unique de description des dépôts a été mise en place, afin d’homogénéiser les métadonnées et de les importer dans notre système d’information (THOT). • Un récolement du vrac a été réalisé par une prestation externalisée (23162 dépôts ont été récolés, soit 590 ml, 24 mois de sept. 2018 à sept. 2020). Le principe était de ne pas ouvrir les boîtes et de se limiter au relevé des mentions qui y figuraient. C’était la seule façon d’acquérir rapidement une connaissance synthétique du fonds, afin de programmer des chantiers de traitement et de description d’ensembles cohérents (en cours : inventaire exhaustif des dem antérieurs à 1870).
- 25. Instruments de recherche en ligne
- 26. Grille de description unifiée INTITULE Cote Numéro de dépôt Vérification Tranche Date du dépôt Nom / Raison sociale Nom / Raison sociale normalisés Profession Adresse Lieu Voie parisienne 1 Voie parisienne 2 N° Rue hors Paris Pays Cachet Titre (et description) Description complémentaire Nb d’ex. (anciennement type de représentation) Nom et adresse du Photographe-Dessinateur État de conservation Durée de conservation Nature de dépôt En nature Matériau Préconisations de traitement Dessin Matériau Préconisations de traitement Photographie Matériau Préconisations de traitement Légende Nb de légendes individualisées Reproduction Références biblio. Intérêt pour la prochaine campagne photo Ligne principale ou détail Greffe Crédits Image début Image fin Droits de diffusion Images Parisienne
- 28. Numérisation et diffusion • Des campagnes photographiques sélectives ont débuté dans les années 1990, notamment pour le catalogue de l’exposition Objets. Dessins et modèles de fabrique déposés à Paris. 1860-1910 (Archives de Paris, 1993). Les ektachromes provenant de ces campagnes ont été numérisés en 2019. • Un programme de numérisation systématique d’ensembles cohérents du greffe des tissus a démarré en 2017 (maisons Paquin, Vionnet et Callot sœurs). Les dem libres de droit sont privilégiés. • Des opérations de mécénat ont permis de numériser d’autres séries prestigieuses : Christian Dior (2017), Jean Patou (2019). • Toutes les images issues de ces différentes campagnes de numérisation vont être mises en ligne très prochainement. Les images non libres de droits seront consultables sur les postes de la salle de lecture (Christian Dior, notamment). • Base de test : http://t73.arkotheque.rec.apps.paris.mdp/s/19/dessins-et- modeles/
- 29. Valorisation • En 1993, sous l’impulsion de Brigitte Lainé, l’exposition Objets. Dessins et modèles de fabrique déposés à Paris. 1860-1910 a permis de mettre en valeur la partie la plus ancienne du fonds. • Depuis, des prêts sont consentis très régulièrement pour des expositions telles que Jeanne Lanvin au Palais Galliera en 2015, Splendeurs et misères. Images de la prostitution. 1850-1910 au Musée d’Orsay en 2015, Mode & Femmes 14/18, à la Bibliothèque Forney en 2017, etc. • Certaines publications puisent leurs sources et leurs illustrations dans le fonds : Une histoire des parfumeurs. France, 1850-1910, par Rosine Lheureux, 2016 ; La Maison Worth, 1858-1954. Naissance de la Haute- Couture, 1858-1954, ouvrage collectif, 2017. • Un cycle de conférences organisé aux Archives de Paris en 2016 en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris a encore été l’occasion de mettre en valeur le fonds : Les arts du superflu : un luxe indispensable ? Paris, les arts décoratifs et la mode. • Le fonds est encore représenté dans la 3e collection nationale des Micro- folies et voisine avec des documents des Archives nationales et des Archives municipales d’Angers.