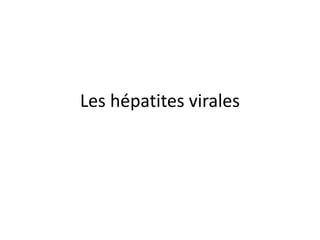
residennt_hepatite__virus_A_et_E.pptx
- 2. Généralites: • En 1969, Blumberg mit en évidence l’antigène Australia AgAu qui n’est autre que l’AgHBs de la particule de Dane ou virus de l’hépatite B (VHB). • Le virus de l’hépatite A (VHA) fut identifié en 1973 dans les selles de malades atteints d’hépatites aiguës. • L’antigène delta a été décrit en 1977
- 3. • Ce sont les techniques de biologie moléculaire qui ont permis la découverte du virus de l’hépatite C (VHC) en 1989 et du virus de l’hépatite E (VHE) en 1990 • Le virus de l’hépatite G (VHG), virus pathogène, a été identifié en 1996. • La pathogénicité des autres virus non A-non B […]-non G, tel le transfusion-transmitted virus (TTV), demeure incertaine.
- 4. • l’hépatite à virus A (HVA) bien que très commune pose peu de problèmes de morbidité, mais les hépatites à virus B (HVB), à virus C (HVC) et à virus E (VHE) constituent un problème majeur de santé publique. • Depuis mai 2010, les hépatites sont considérées comme la quatrième priorité de santé publique à l'échelle mondiale par l'OMS, après l'infection à VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose.
- 5. • D’après le Rapport mondial sur l’hépatite 2017 de l’OMS, l’hépatite a causé 1,34 million de décès en 2015, soit un nombre comparable à celui des décès dus à la tuberculose et supérieur aux décès causés par l’infection à VIH/Sida. • Le nombre de personnes atteintes d’une infection chronique est en hausse : 328 millions. • pour les hépatites B (257 millions) et C (71 millions) en 2015.
- 6. • La stratégie, élaborée par l’OMS pour la période 2016-2021 vise à réduire de 90 % l’incidence et de 65 % le nombre des décès. • Le thème de la Journée mondiale contre l’hépatite le 28 juillet 2017 a été : « Eliminer l’hépatite », à l’horizon 2030 .
- 9. Taxonomie La famille des Picornaviridae inclut le virus de l'hépatite A (VHA). Ce dernier est le seul représentant du genre Hépatovirus. Le VHA est subdivisé en 4 génotypes humains : I, II, III et VII dont chacun possède deux sous types A et B. Les génotypes IV, V et VI sont d'origine simienne.
- 11. Structure du virus. Le virus de l'hépatite A (VHA) est un virus non enveloppé d’un diamètre de 27 à 28 nm. à ARN linéaire simple brin de polarité positive renfermé dans une capside icosaédrique qui se compose de 32 capsomères dont chacun est constitué de 4 protéines virales : VP1, VP2, VP3 et VP4 . Son génome viral contient environ 8000 nucléotides et code pour des protéines de capside, une polymérase et des protéases .
- 12. Structure du VHA [13].
- 13. • L'ARN génomique du VHA est de 7,5 Kb et contient une zone 5' non codante d'environ 7500 nucléotides suivie d'un seul cadre de lecture ouvert de 2220 nucléotides et d'une zone 3' non codante de 40 à 80 nucléotides. • Cet ARN est lié en 5' à une petite protéine de 2,5 Kda :la VPg qui permet l'amorce de la réplication et la synthèse de l'ARN. • La région 5' non codante représente le site d'entrée du ribosome IRES indispensable à la traduction du cadre de lecture. Ce dernier est traduit en une unique polyprotéine .
- 14. • Des protéases cellulaires (VP1/2A et VP4/VP2), ainsi qu'une protéine virale 3Cpro clivent cette polyprotéine en protéines structurales de la capside et en protéines non structurales produisant les protéines de la réplication virale (2B, 2C, 3A, 3B/VPg, 3Cpro, 3Dpol). • La protéine 3Dpol est une ARN polymérase ARN dépendante indispensable pour la formation de nouveaux brins d'ARN positifs et négatifs durant la réplication.
- 16. Cycle de réplication Les étapes de la réplication virale du VHA se déroulent dans le cytoplasme cellulaire et sont comme suit : Fixation du virus par interaction des récepteurs viraux mucine-like HAV-cr1 de la famille des immunoglobulines avec le récepteur de l'asialoglycoprotéine des hépatocytes
- 17. Pénétration virale . Décapsidation et libération de l'ARN viral. Traduction de l'ARN en une polyprotéine qui subit un clivage par les protéases en protéines structurales et non structurales nécessaires à la réplication et l'assemblage. Réplication de l'ARN viral. Assemblage, encapsidation de l'ARN viral et maturation des provirions. Libération des virus néoformés.
- 19. Sensibilité et résistance • Le virus de l'hépatite A se différencie des autres entérovirus par sa stabilité élevée . • Sa résistance aux agents physiques et chimiques lui attribue une longue survie dans le milieu extérieur. • L'absence d'enveloppe virale confère à ce virus sa stabilité à ph acide, aux solvants des lipides tel l'éther à 20 %, le chloroforme, la chlorhexidine et aux concentrations de chlore dans les eaux de piscines et l'eau de boisson.
- 20. Il résiste à la chaleur avec une stabilité qui dure 1h à 60° , 19 minutes à 80°et 3 minutes dans les fruits de mer à 90°. Il survit 4 heures à 20°sur les doigts de sujets infectés. et reste stable à 4° .
- 21. • En revanche, il est inactivé par le chauffage durant 20 minutes à 120°, par les rayons ultraviolets à 1,5 W durant 1 minute, par le formol dilué au 1/ 4000; par le bêta- propiolactone 0,03% en 72 h à 4°, par l'iode en 5 minutes à 3 mg/l et par le chlore après traitement à des concentrations de 10 à 15 parties par millions (ppm) pendant 30 minutes . Il est aussi détruit en moins de 3 minutes par les solutions d'eau de javel.
- 22. 2- Épidémiologie: • 2-1-Réservoir Le réservoir principal du virus est l'homme, à savoir les sujets infectés. • Il peut aussi infecter certaines espèces simiennes dont la réceptivité de l'homme est très minime . • Une autre source d'infection du virus est représentée par les dispositifs de ravitaillement en eau contaminés, les coquillages souillés et les aliments contaminés
- 23. Modes de transmission: - l'excrétion des particules virales dans les fèces s'effectue À des concentrations très augmentées de l'ordre de 10 8 à 10 10 /g de selles, - Leur résistance élevée dans le milieu extérieur justifie les divers modes de transmission . - Le mode de transmission principal est représenté par la voie féco-orale. - La transmission directe par contact interpersonnel constitue le mode majeur dans les communautés fermées, dans les crèches et dans les hôpitaux. Ce mode favorisé par le manque d'hygiène facilitant la contamination manuportée
- 24. • La transmission indirecte se fait par le biais d'ingestion d'eau ou d'aliments souillés , notamment les fruits de mer, les coquillages crus et les produits fermiers contaminés durant la fabrication . • La transmission maternofoetale et la transmission sanguine par les produits sanguins labiles et les dérivés de sang collectés sont possibles, mais restent moins courantes . • La transmission sexuelle est essentiellement observée chez les homosexuels dont l'activité implique les contacts oro- anaux et dont les partenaires sont multiples
- 26. Réceptivité: • La réceptivité humaine pour le VHA est totale car toute personne sans contact antérieur avec le virus de l’hépatite A sera contaminée. • L'infection par le virus de l'hépatite A est une infection immunisante. Même en l'absence de symptomatologie clinique, une immunité définitive protectrice est acquise. • Elle est confirmée par la persistance des anticorps anti-VHA de classe IgG plusieurs années après la guérison.
- 27. Répartition géographique: L'hépatite virale A est une maladie cosmopolite endémique. Le nombre de cas dénombré dans le monde s'estime à 1 0 millions . L'allure épidémiologique se différencie selon le niveau d'hygiène et le développement sanitaire de chaque pays. On distingue 3 zones d'endémie variant conformément aux différentes régions :
- 28. • Zones de forte endémicité : au niveau d'amples régions d'Asie (Moyen Orient, Asie mineure, continent indien, Sud-est asiatique), d'Afrique et d'Amérique centrale . Ces pays en voie de développement sont caractérisés par le défaut d'hygiène et l'absence d'assainissement Le risque de développer une hépatite est très augmenté. L'infection est incontournable et survient précocement durant les premières années de la vie et permet de garder une immunité permanente . Les épidémies sont rares et sont liées à la présence des touristes et voyageurs non immuns
- 29. • Zones d'endémicité intermédiaire : au niveau des pays en transition économique dans le pourtour méditerranéen, l'Amérique du Sud, le Mexique, la République de Cuba, la Russie et la Chine avec prédominance chez la population adulte due à la réduction de la transmission du virus .
- 30. • Zones de faible endémicité : au niveau des pays industrialisés dans l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, le Japon et l’Australie et les pays scandinaves, l'Allemagne et la Suisse . • Le risque de contracter l'infection est faible et le nombre de cas s'élève progressivement avec l'âge . • L’infection survient tardivement à l'âge adulte avec la présence d’une grande vulnérabilité au cours d'un voyage à l'étranger .
- 32. 3-Histoire naturelle et physiopathologie • Histoire naturelle L'infection par le virus de l'hépatite A entraîne un processus aigu d'inflammation et de nécrose qui se résout en général spontanément sans séquelles chroniques. L'évolution est habituellement bénigne sans induction d'infection chronique
- 33. • L'incubation a une durée de 15 à 45 jours. Dans 10% des cas, l'évolution se fait vers une forme prodromique puis symptomatique avec installation d'un ictère. • Les formes les plus fréquentes, survenant dans 90% des cas, ne présentent aucune symptomatologie et passent inaperçues. Elles apparaissent principalement chez l'enfant. • Des formes prolongées ou à rechutes sont présentes. • La forme la plus grave, mais rare, est l'hépatite fulminante survenant surtout chez l'adulte et le sujet âgé
- 35. Physiopathologie • Après contamination, le virus entre dans l'organisme par voie orale . • Étant résistant à l'acidité gastrique, il traverse l'estomac et gagne les villosités intestinales . • il arrive par la circulation portale au niveau du foie qui représente son organe cible. • Sans symptomatologie clinique, l’accroissement de la réplication virale au niveau du cytoplasme des hépatocytes survient suivie par l'excrétion virale dans la bile , puis dans les selles de l'ordre de 10 9 par gramme de selles • À la fin de cette phase asymptomatique, le virus est aussi détecté dans le sang.
- 36. • Après la guérison, l'ARN viral peut être révélé dans le sang et les selles pendant 2 à 3 mois . • Le virus de l'hépatite A n'est pas cytopathique. Il n'induit pas directement des lésions au niveau des cellules hépatiques. En effet, sa pathogénie est essentiellement due à la réaction immunitaire dirigée contre les cellules infectées par le virus
- 38. Clinique : 1 -Forme commune : La forme commune typique est caractérisée par la présence de quatre phases clinico-biologiques : La Phase d'incubation : durant laquelle il y'a réplication du virus dans le tube digestif jusqu'à l’atteinte du foie, induisant une virémie qui persiste plusieurs semaines. L'excrétion du virus dans les selles, par la bile, est remarquable. Elle est d'environ un milliard de virions par gramme. • Cette phase est complètement asymptomatique et dure de 7 à 45 jours .
- 39. La Phase prodromique : se manifeste surtout chez l'adulte et s'étend de 1 à 15 jours. Elle dure pendant cinq jours en moyenne. Les signes cliniques observés sont des troubles digestifs à type d'anorexie, de nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, un syndrome pseudo grippal avec une fièvre, des arthralgies, des myalgies et exceptionnellement des éruptions cutanées. Une cytolyse hépatique en phase de début est constatée par l'augmentation de l'activité alanine aminotransférase sérique (ALAT) .
- 40. La Phase d'état : accentuée par l'existence d'un ictère et une grande cytolyse hépatique avec une activité ALAT dépassant 10 à 100 fois la normale. Cliniquement, elle se manifeste par une oligurie à urines foncées et des selles décolorées. Ensuite, s'installe un ictère débutant au niveau des muqueuses puis s'étendant vers la peau en 5 à 10 jours. • Les symptômes s'estompent en deux à trois mois. L'activité ALAT se normalise en approximativement six semaines
- 41. 2 -Autres formes cliniques : Formes anictériques ; Formes cholestatiques ; Formes prolongées et formes à rechutes Formes avec manifestations extra hépatiques Formes avec insuffisance hépatocellulaire grave : hépatites fulminantes ou subfulminantes Hépatite chronique auto-immune.
- 44. Evolution des marqueurs de l'infection: Dès l'apparition de l'ictère, les IgM anti-VHA sont décelables par technique ELISA . Elles atteignent le pic un mois après l’exposition et peuvent demeurer jusqu'à un an . Elles témoignent d'une infection récente par le virus. Les IgG apparaissent une semaine après les IgM et persistent toute la vie conférant une activité neutralisante pour les futures expositions. Elles témoignent d'une ancienne exposition au virus. La durabilité des IgG peut être limitée dans le temps dans le cas d'une immunosuppression, notamment dans l'infection par le VIH . La virémie est détectable, chez les hôtes immunocompétents, en quelques jours suivant l'infection et persiste 3 à 4 semaines après , Elle peut rester audelà de 4 semaines en présence d'immunosuppression
- 46. • a) Prélèvements Le diagnostic biologique du VHA peut se faire sur plusieurs prélèvements. - Culture et immuno-microscopie électronique : selles dans un pot stérile. - Biologie moléculaire : tube EDTA. - Sérologie : tube sec.
- 47. Diagnostic direct: • Le diagnostic direct est un diagnostic biologique mettant en évidence la présence directe soit du VHA (culture cellulaire-Microscopie électronique) ou de l’un des ces constituants ( génome par biologie moléculaire et les Ag viraux par technique immuno-enzymatique) Ces techniques ne sont pas effectuées en pratique courante.
- 48. Isolement du virus par culture : • Les cellules FRhK4 du rein de singe d'origine simienne et les cellules MRC5 des fibroblastes humains représentent des systèmes de culture du virus , mais la culture reste sans intérêt pour le diagnostic du fait de la réplication lente du virus et de son ECP très réduit .
- 49. Détection des particules virales dans les selles par immuno-microscopie électronique : Des extraits de selles concentrés et purifiés sont utilisés en présence d'un immun-sérum anti-VHA. Ainsi, les particules virales s'agglomèrent en agrégats qui renferment des formations icosaédriques . Cette technique est peu sensible en raison du seuil de détection élevée (106 particules/ml)
- 51. Détection des antigènes technique immuno-enzymatique ELISA dans les selles; L'antigène est repéré par un anti-VHA marqué d'une enzyme. la sensibilité de cette technique est limitée. radio-immunologie en phase solide (RIA): l'antigène est mis sur un support comportant un anti-VHA à sa surface. Secondairement, un anti VHA radioactif marqué à l'iode 125 permet la mise en évidence de l'antigène .
- 52. Détection du génome dans le plasma et/ou dans les selles et/ou dans le foie : • la détection de l'ARN du VHA se fait dans le sang lors de la virémie, dans les selles, voire dans le foie au moment de la cytolyse par technique de biologie moléculaire fondée sur la transcription inverse de l'ARN virale suivie de son amplification par PCR (RT-PCR).
- 53. • La séquence amplifiée se place dans la zone 5' non codante. L'amplification génique de la zone VP1 -2A permet de distinguer les différentes souches du VHA au cours d'une épidémie, • Au niveau du foie, la détection in situ du génome se fait par immunofluorescence ou immuno-peroxydase • La RT PCR en temps réel avec sonde d'hybridation aide à quantifier le nombre de copies d’ARN existant dans l'échantillon. Elle a remplacé la RT PCR classique où plusieurs couples d'amorces sont indispensables pour la caractérisation du génome des souches virales
- 54. 5-5-Diagnostic indirect: Détection des IgM anti-VHA :. Elles sont décelées essentiellement par ELISA immunocapture. Ces anticorps représentent le marqueur d'une infection aigue par le VHA. Ils peuvent être aussi détectés à la suite d'une vaccination récente contre le virus
- 55. Détection des IgT anti- VHA : Les différents isotypes formés en réponse à l'infection à savoir l'IgM, l'IgG et l'IgA sont contenus dans les IgT anti-VHA
- 56. • i ls sont repérés dans le sérum par immuno-compétition. • En dehors d'une hépatite aigue, les IgT contiennent majoritairement les IgG indiquant ainsi la présence d'une immunité naturelle ou post vaccinale contre le virus. • Les IgT anti-VHA évaluent le statut immunitaire envers le virus Avidité des IgG anti-VHA : la technique se base sur l'utilisation de l'urée qui permet de dénaturer et de décomposer les IgG anti VHA se manifestant en début de l'infection et possédant une affinité faible pour leurs cibles antigéniques
- 57. • . Un test ELISA IgG anti-VHA, avec ou sans urée est effectué pour le même échantillon. L'index d'avidité est ainsi mesuré selon la formule : Il permet de distinguer les IgG constitués au cours de la primo-infection de celles constituées à distance. Après la primo-infection, les IgG obtiennent une maturation d'affinité pour leurs cibles s'exprimant par un indice d'avidité faible en cas de primo-infection et par un index élevé en dehors de celle-ci . Un index <50% indique une primo-infection probable, tandis qu'un index >70% révèle un infection ancienne probable. Un index se situant entre 50 et 70% est non différenciant
- 58. • l'avidité des IgG joue aussi un rôle dans le diagnostic différentiel de l'hépatite virale aigue A. En effet, plusieurs pathologies auto- immunes et infections virales peuvent avoir une symptomatologie hépatique imposant la recherche d'IgM anti VHA. L'avidité des IgG permet ainsi de trancher.
- 60. Prophylaxie : • Après plusieurs années, l'immunothérapie active ou vaccination est devenue disponible. • Havrix fut le premier vaccin commercialisé en 1992 entier inactivé par le formol et adsorbé sur hydroxyde d'aluminium préparé à partir de la souche virale de génotype IB HM175 La forme chez l'adulte comporte 14400 unités ELISA, alors qu'il contient 720 unités ELISA chez l'enfant. • Depuis 1997, un deuxième vaccin Avaxim® élaboré de façon identique au premier a été commercialisé. • Le troisième vaccin Vaqta®, forme de la souche CR 326F, est mis sur le marché depuis 1999. Le vaccin Epaxal est formé de 10 ug d'hémagglutinine de virus grippal, ainsi que de 500 unités RIA du VHA. • Il existe aussi un vaccin combiné contre le VHA et le VHB disponible depuis 1996 En Chine, des vaccins vivants atténués contre le VHA ont été développés à partir des souches virales H2 et L-A-1. Après plusieurs passages en culture cellulaire suivie de la diffusion au niveau des fibroblastes pulmonaires diploïdes d'embryon humain, l'atténuation fut obtenue. Ils ont été commercialisés depuis 2008. Un essai vaccinal comprenant 1200 enfants fut élaboré durant une endémie en 1998 dans la province Hebei en Chine. L'efficacité du vaccin fut estimée à 95 %. Néanmoins, ils ne sont pas préconisés chez la femme enceinte et les immunodéprimés
- 61. Protocole vaccinal • Il s'agit de deux injections intramusculaires à six mois d'intervalle. Un rappel peut être effectué dans les 5 ans si la deuxième dose n'a pas pu être administrée 6 à 12 mois après la première injection • . Le taux de séroconversion rapporté chez les sujets immunocompétents est de 99.8%. Il est plus faible et se situe autour de 90% chez les groupes à risque, les patients avec hépatopathie chronique ou coinfectés par le VIH . Effets secondaires de la vaccination La vaccination possède généralement une bonne tolérance. Mais, des réactions indésirables peuvent être décrites chez l'enfant. Elles sont similaires à ceux observés durant l'administration de vaccins pédiatriques. Elle se manifestent par des réactions locales en relation avec la présence d'hydroxyde d’aluminium tels la rougeur, la douleur et induration au point d'injection, se résolvant en 2 jours. Les effets secondaires généraux sont rarement observées et sont représentés par la fièvre, les céphalées, les nausées, les vertiges, l'asthénie et la perte d'appétit .
- 62. • Les contre-indications de la vaccination Les contre-indications de la vaccination sont l'hypersensibilité à l'alumine et une réaction anaphylactique documentée à la suite d'une administration d'une dose ancienne du vaccin . • L'OMS recommande d'inclure la vaccination contre le VHA dans le calendrier de vaccination des enfants de plus d'un an pour les pays d'endémicité intermédiaire, par l'administration d'une dose unique de vaccin inactivé en raison de la forte incidence de l'hépatite A et du bon rapport coût/efficacité
- 63. Intérêt des antiviraux dans l'hépatite A En général, il n'existe pas d'indication de traitement antiviral au cours d'une hépatite A. Cependant, il a été constaté que l'usage d'antiviraux pourrait raccourcir la durée de la maladie et diminuer les symptômes. La prévention de l’évolution vers l'hépatite fulminante pourrait être effectuée par un traitement antiviral précoce des individus non vaccinés. Ces antiviraux sont : L'interféron pégylé Amantadine : son mécanisme d'action se fait par inhibition de la traduction dépendante du site interne d'entrée interne des ribosomes (IRES) Cependant, les études pharmacocinétiques ont montré que les concentrations plasmatiques maximales atteintes sont inférieures aux concentrations efficaces, limitant ainsi son utilisation clinique
- 64. HÉPATITE E
- 65. caractère virologique: Taxonomie Le virus de l'hépatite E est un virus de la famille des Herpesviridae du genre Orthohepevirus .il possède 4 principaux génotypes. • En se basant sur les génomes complets, les séquences des génotypes ont un degré de divergence variant entre 22 et 27 % • Chaque génotype est divisé en sous-génotypes : cinq pour le génotype 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e), deux pour le génotype 2 (2a, 2b), dix pour le génotype 3 (3a 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j) et sept pour le génotype 4 (4a, 4b, 4c ,4d, 4e ,4f, 4e). Les génotypes 1 et 2 sont strictement humains. Les génotypes 3 et 4 sont identifiés chez l'homme et plusieurs animaux domestiques et sauvages
- 67. 1-2-Structure du virus: • Le virus de l'hépatite E est un virus non enveloppé d'environ 30-34 nm de diamètre qui possède une capside icosaédrique . • Son génome est formé par une molécule d'ARN simple brin de polarité positive d'environ 7200 nucléotides. Il présente une queue polyadénylée en son extrémité 3'et une coiffe dans son extrémité 5'. Il contient trois cadres ouverts de lecture : ORF1, ORF2 et ORF3 entourés par deux régions non codantes. Ils participent à la réplication et la transcription du génome viral. Ces trois cadres codent respectivement les protéines ORF1, ORF2 et ORF3
- 68. • La protéine ORF1, est nomée la réplicase, c’ est une poly protéine non structurale formée de 1700 AA. Elle contient des domaines avec plusieurs activités enzymatiques, notamment la méthyle-transférase, l'ARN hélicase et l'ARN polymérase ARN dépendante . • La protéine ORF2 est la protéine de la capside. Elle se constitue de 660 acides aminés et possède un peptide signal Nterminal, et trois sites potentiels de N-glycosylation. Cette protéine renferme 3 domaines différents : S (Shelly), M (Middle) et P (Protruding) . • La protéine ORF3 est une protéine non structurale de 113 à 115 acides aminés. Elle contient deux domaines N-terminaux (D1 et D2) et deux autres domaines (P1 et P2). Son rôle précis n'est pas bien connu. Cependant, un rôle dans la sécrétion des particules virales, ainsi qu'une activité viroporine lui ont été accordées
- 71. Cycle de réplication: les différentes phases du cycle infectieux du virus de l'hépatite E restent mal élucidées en raison de l'amplification virale difficile en culture cellulaire. Cependant, les étapes suggérées sont présentées comme celles-ci : Attachement du virus à la surface de la cellule cible par des protéoglycanes à héparane sulfate. Interaction du virus avec des récepteurs spécifiques non encore identifiés . Internalisation des particules virales dans la cellule par endocytose.
- 72. Dissociation de la capside virale dans le cytoplasme, suivie de la libération du génome viral . Traduction de l'ARN viral et synthèse de la protéine ORF1 qui comporte la réplicase virale . Synthèse d'un ARN simple brin de polarité négative à partir de l'ARN génomique de polarité positive par le biais de la réplicase virale . Synthèse de nouveaux ARN génomiques (6) et ARN sous génomiques de polarité positive . Traduction des ARN sous génomiques en protéines ORF2 et ORF3
- 73. • La protéine ORF2 prend 2 voies : une voie productrice dans laquelle elle demeure localisée du coté cytosolique et détient un peptide signal non fonctionnel permettant l'encapsidation du génome. Elle s'assemble avec l'ARN (+) pour former des virions . • Ces derniers, sont présents dans les corps multi vésiculaires (MVB) et seront enveloppés par la suite d'une couche bi-lipidique. Au niveau de cette couche, la protéine ORF3 vient s’insérer. • L'activité viroporine d'ORF3 permettra par la suite la sécrétion des virions.
- 74. • Une grande fraction de la protéine détient un peptide signal (PS) fonctionnel qui permet sa translocation dans la lumière du réticulum endoplasmique, suivant ainsi la voie de sécrétion classique des protéines. • Cette voie est dite non productrice . La protéine subit ainsi des transformations post-traductionnelles comme la Nglycosylation, la O-glycosylation et la sialylation. • La protéine glycosylée ORF2g est ensuite clivée pour former ORF2c. Ces deux dernières sont libérées dans le sérum des individus infectés en importantes quantités .
- 77. Sensibilité et résistance • Dans les milieux à haute teneur en sel, tel le chlorure de césium, durant les cycles de congélation-décongélation et durant un stockage à -20°C, les particules virales se désintègrent vite • Le virus est aussi sensible aux désinfectants, aux antiseptiques habituels et aux agents physiques (rayons ultraviolets) . • En revanche, il résiste aux solvants lipidiques et à l'acidité (ph de 3 à 5) expliquant sa présence dans le tractus gastro- intestinal et dans les environnements naturels désavantageux où il y'a exposition à la sécheresse et aux températures élevées
- 78. Epidémiologie • Réservoir L'hôte principal du virus est l'Homme, mais il possède aussi un réservoir animal le différenciant des autres virus de l'hépatite, notamment le porc et le poulet . Il a été récemment identifié chez le lapin , le rat , le furet et la chauve-souris . • On peut aussi le trouver dans l’environnement surtout dans l’eau contaminée par les déjections des animaux porteurs du VHE
- 79. Modes de transmission • Le virus de l'hépatite E possède 4 voies de transmission : • La transmission féco-orale : est la principale voie de transmission par ingestion d'eau contaminée ou par les particules virales présentées dans les selles. Ce moyen de propagation est donc favorisé par le manque de contrôle d'évacuation des déchets et par le déficit des systèmes de traitement de l’eau. Cette transmission correspond aux génotypes 1 et 2 du virus. • Le virus se transmet aussi par consommation de viande de porc, de sanglier, de cerf ou de gibier crue ou mal cuite et par l'ingestion de saucisses disposées à partir du foie du porc. Les génotypes 3 et 4 sont responsables de cette transmission zoonotique.
- 80. • Transmission par contact interindividuel ou contact avec le réservoir animal direct : expliquant la propagation du virus chez les vétérinaires, les éleveurs, les bouchers et les chasseurs. • Transmission parentérale : liée à l'existence d'une virémie transitoire durant la phase prodromique par transfusion de produits sanguins contaminés. Cette voie est exceptionnelle La transmission par injection d'héparine dérivée de la muqueuse intestinale du porc est suggérée sans être prouvée . • Transmission maternofoetale : surtout durant le troisième trimestre de la grossesse entraine une mortinatalité élevée et un accouchement prématuré chez environ deux tiers des femmes contaminées
- 82. Réceptivité: • La réceptivité est totale vis-à-vis du VHE. Tous les patients non immunisés sont la cible du virus. Il touche essentiellement la population jeune de 20 à 40 ans. • L'hépatite E peut se manifester même après une ancienne exposition. Ceci est dû à la présence d'infections infra-cliniques, avec faible inoculum qui n'aboutissent pas à la production d'anticorps
- 83. Répartition géographique: • Les quatre génotypes du VHE ont des répartitions différentes selon l'endémicité de la maladie. L'infection par le VHE survient sous 2 aspects : • une épidémie touchant plusieurs sujets ou en cas sporadiques au retour d'un voyage en région d'endémie . Les génotypes 1 et 2 entrainent des épidémies et des cas sporadiques dans les zones moins développées (Afrique, Asie centrale, Sud-est, Mexique).
- 84. • Les pays en voie de développement se caractérisent par des épidémies touchant les jeunes adultes de 15 à 35 ans avec prédominance masculine
- 85. • Au niveau des pays développés, les génotypes à transmission essentiellement zoonotique engendrent des cas sporadiques. Le génotype 3 possède une répartition mondiale, tandis que le génotype 4 est endémique en Asie (Japon, Corée, Chine, Taiwan) . • Les patients symptomatiques sont en général âgés de plus de 50 ans avec consommation excessive d'alcool ou ayant une hépatopathie chronique sus jacente . La transmission sanguine par transfusion est commune aux pays développés et au niveau des pays à ressources limitées .
- 87. Histoire naturelle et physiopathologie: Histoire naturelle La période d'incubation de l'hépatite E se situe entre 15 et 60 jours. Elle dure moyennement 40 jours . Dès la 3éme semaine, la virémie et l'excrétion virale dans les selles sont positives. L'ARN viral se négative dans le sang en une à deux semaines. L'excrétion virale dans les selles se prolonge durant une à trois semaines additionnelles
- 88. Physiopathologie: • La physiopathologie de l'hépatite E n'est pas parfaitement connue. Après absorption digestive, le virus se reproduit dans l'intestin, puis se dirige vers le foie par la veine porte. Il se réplique par la suite dans le cytoplasme des cellules hépatiques et cellules biliaires. • L'excrétion dans la bile survient suivie de l'excrétion dans les selles. La virémie est mise en exergue dès le commencement des symptômes et dure quelques jours après
- 89. • La réplication virale dans le foie est détectable 7 jours après la transmission du virus, mais le pourcentage d'hépatocytes infectés reste méconnu. • Bien que le VHE soit un virus hépatotrope, l’immunohistochimie indique que la réplication peut également se produire au niveau d'autres tissus tels le tractus gastrointestinal, les reins, le système nerveux central et le placenta . • Le VHE est faiblement cytopathique. En effet, la cytolyse hépatique est due à la réponse cytotoxique immunitaire de l'hôte et non liée à l'action directe du VHE. Ceci explique la symptomatologie amoindrie chez les immunodéprimés, qui possèdent habituellement une cytolyse moins intense et asymptomatique. La virémie survient en effet plusieurs jours avant les manifestations histopathologiques.
- 90. Clinique: 1-Forme classique Comporte une phase prodromique pré ictérique avec fièvre, anorexie, nausées, céphalées, rash cutané et douleurs abdominales qui durent 1 à 27 jours suivie d'une phase ictérique de 15 à 40 jours contenant l'ictère avec urines foncées, des selles décolorées et une hépatomégalie
- 91. 2-Forme asymptomatique Pour 70 % des cas, l'infection par le VHE est asymptomatique. Elle se révèle par une augmentation modérée isolée des transaminases . 3-Forme avec manifestations extra-hépatiques : rares, se manifestent par: Atteinte neurologique : une atteinte centrale ou périphérique , comme le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de Parsonage-Turner, la myélite aigue transverse, la polyradiculite inflammatoire, l'encéphalite, la myopathie et la neuropathie périphérique avec syndrome pyramidal bilatéral. Atteinte hématologique : à type de thrombopénie profonde, d’anémie hémolytique, de gammapathie monoclonale et de cryoglobulinémie.
- 92. Pancréatite aigüe : survenant généralement durant la deuxième ou troisième semaine suivant l'apparition de l'ictère . Atteinte rénale : se manifestant par une néphropathie telle la glomérulonéphrite membraneuse et membrano-proliférative Atteinte dermatologique : les lésions cutanées infantiles observées au cours d'une hépatite virale E aigue sont l'exanthème maculo- papuleux et le purpura rhumatoïde . Ces symptômes diminuent après la rémission
- 93. 4-Forme chronique Le VHE est responsable d'infection hépatique aigue. Néanmoins, il peut engendrer une infection chronique en cas d'immunodépression. Cette infection est définie par la persistance du virus dans les prélèvements sanguins durant plus de 6 mois . Des cas d'hépatite E chronique ont été observées chez des patients immunodéprimés, particulièrement les transplantés d'organes solides , les patients traités par chimiothérapie pour hémopathies et les patients atteints par le virus de l'immunodéficience humaine ayant un taux de CD4 moins de 250/mm3 . L'infection chronique par le VHE est souvent non remarquable. La majorité des transplantés sont asymptomatiques ou présentent uniquement de l'ictère . Le principal risque encouru est l'évolution vers la fibrose et vers la cirrhose pouvant nécessiter une transplantation hépatique.
- 94. • Chez les patients infectés par le VIH, l'infection par le VHE peut entrainer une hépatite chronique rapidement progressive avec développement d'une cirrhose à court terme. Des cas d'hépatite E chronique ont été décrits chez des individus coinfectés par le VIH ayant un CD4<200 cellules/μL. • L'infection par le VHE doit être considérée comme une infection opportuniste en cas de coïnfection VIH et doit être dépistée en cas d'élévation inexpliquée des aminotransférases ou en cas de fibrose de cause inconnue . • Un unique cas d'hépatite évoluant vers la chronicité a été mentionné dans la littérature. Il s'agit d'un sujet immunocompétent sans comorbidité préalable, dont l'évolution après 18 mois fut marquée par une fibrose hépatique sévère. À l'exception de ce sujet, les formes chroniques sont strictement l'apanage des patients immunodéprimés
- 95. -Hépatite E et grossesse: Le VHE entraine un tableau clinique grave chez la femme enceinte. Il engendre durant le 3 ème trimestre de grossesse une mortalité maternelle augmentée de 20 % . Le décès survient dans un tableau d'hépatite fulminante se présentant par une encéphalopathie, par un syndrome hémorragique et par une insuffisance rénale. Ce tableau témoigne d'une nécrose aigue et massive du foie de pronostic sévère . La mort peut être due non seulement à l'hépatite fulminante, mais aussi aux complications obstétricales engendrées telles l’éclampsie et l'hémorragie entrainant des fausses couches . La transmission verticale maternofoetale du VHE est bien documentée. Elle entraine un accouchement prématuré, une l'augmentation du risque d'avortement et la survenue d'une hépatite aigue chez le nouveau-né.
- 96. Hépatite E et Hépatopathie chronique -L'hépatite E entraine une forme sévère chez les sujets porteurs d'une hépatopathie chronique préexistante telle la cirrhose. En effet, elle cause une décompensation aigue induisant une mortalité
- 98. -Circonstances de diagnostic: La majorité des infections par le VHE sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques. L'hépatite virale E doit être évoquée devant toute hépatite aigue inexpliquée même en manque de notion de voyage récent. Elle peut être aussi révélée par des formes graves surtout en cas de grossesse ou d'hépatopathie préexistante
- 99. -Évolution des marqueurs de l'infection: • Depuis la troisième semaine, la virémie et l'excrétion virale sont positives et devancent l'infection clinique d'une à deux semaines. En une à deux semaines, • l'ARN viral devient négatif dans le sang et également lors de la normalisation des transaminases. • L'excrétion virale dans les selles se prolonge plus et se continue durant une à trois semaines additionnelles. D'où l'intérêt de la recherche du virus dans les selles, bien que la virémie soit négative
- 100. • Durant l'hépatite virale E aigue, les IgM anti VHE deviennent détectables dans le sang dès le début des symptômes et persistent jusqu'à6 mois après l'infection. • les IgG se manifestent et durent plusieurs années. • L'ARN viral est décelable dans le sang très précocement durant l'infection. Il devient indétectable 5 à 6 semaines après l'infection. Ensuite, l'ARN viral apparait dans les selles après environ 2 semaines suivant la contamination. Cet ARN est uniquement détectable durant la phase aigüe de l’infection, tandis que sa sécrétion dans les selles est plus prolongée
- 102. • a) Prélèvements Le diagnostic biologique du VHE peut se faire sur plusieurs prélèvements. - Culture et immuno-microscopie électronique : selles dans un pot stérile. - Biologie moléculaire ; tube EDTA. - Sérologie : tube sec.
- 103. Diagnostic direct: • Isolement du virus par culture : Il existe plusieurs systèmes de culture de réplication in vitro telle poumon humain, le rein, le foie et les hépatocytes des macaques. Cependant, la majorité de ces systèmes ne fournissent pas un titre élevé de particules virale et possèdent une faible reproductibilité . • Détection des particules virales dans les selles par immuno-microscopie électronique : la recherche des particules virales dans les selles par immunoélectroscopie est limitée par la difficulté de la technique, par sa sensibilité minime et par la courte durée de l'excrétion virale dans les fèces
- 105. Détection du génome viral dans le plasma et/ou dans les selles : • par la RT-PCR associant une transcription inverse suivie d'une PCR conventionnelle. ou en temps réel. • La recherche du génome se fait par amplification génique après obtention d'un ADNc par rétro transcription. La RT-PCR représente la méthode de choix permettant une bonne sensibilité non corrélée au génotype étudié. • Elle offre aussi une identification précise de la virémie. En revanche, cette technique s'avère limitée par le temps de circulation très bref du virus dans le sang et les selles, par le coût élevé et par l'exigence de matériel et d'expertise spécialisée. • Cet intervalle se termine avec la disparition de l'ictère du malade. • La phase de choix pour diagnostic l'infection correspond aux deux premières semaines .
- 106. • , différents types de PCR ont été introduits, y compris la PCR en temps réel, la PCR multiplex et PCR nichée. Ces derniers sont plus sensibles et plus rapides avec un pouvoir de détection pouvant atteindre 10 à 100 copies de la cible ADN/ARN dans un échantillon [ À la différence de la PCR conventionnelle, la PCR en temps réel minimise la contamination et accélère l'analyse. • Plusieurs kits et trousses commerciaux de PCR en temps réel ont été développés, bien qu'ils soient variables en sensibilité et spécificité. Ces kits sont représentés par : Light mix HEV, Ampli Cube HEV 2.0 Kit, Ceeram kit et The Real Star HEV RT-PCR 1.0 kit
- 107. • Deux zones indépendantes sont amplifiées par RT-PCR nichée ou PCR classique : la première se localise dans le gène de la polymérase dans l'ORF1et la deuxième se situe dans la zone 3' de l'ORF2 . • La limite de détection des sondes ARN disponibles est de 7– 80 UI / ml • l'hybridation moléculaire permet de préciser les génotypes des souches sur les produits d'amplification. • Les amplicons sont ensuite clonés dans un plasmide. Pour chaque souche de VHE, trois clones au minimum subissent un séquençage . Une étude récente préconise l'utilisation de la RT-PCR ciblant la zone ORF3, plutôt que la région ORF2 afin de quantifier l'ARN viral des souches du génotype 3 . • L'étude des produits de PCR par les enzymes de restriction permet de préciser les génotypes des isolats du VHE. Ce génotypage possédé un intérêt épidémiologique. En effet, il permet de distinguer un virus autochtone d'un virus emporté d'une zone endémique et d'identifier le mode de contamination
- 108. • Détection d'antigène de capside : l'antigène de la capside virale peut être détecté dans le sang des patients infectés avant le début de la symptomatologie et persiste durant environ 4 semaines.. • Il est réalisé à l'aide d'un test immunoenzymatique indirect en sandwich avec une sensibilité estimée à 91 % et une spécificité de 100 % . Sa facilité de réalisation, ainsi que son coût inferieur permettent le dépistage sanguin et le diagnostic précoce de l'infection
- 110. • Détection des IgM anti-VHE : Les IgM sont décelables au commencement de la phase aigüe et sont les marqueurs d'une infection aigue. Les techniques immuno- enzymatiques utilisent des protéines recombinantes, particulièrement les protéines de la capside ORF 2 et/ou ORF 3 recombinantes du virus, ainsi que des peptides comme sources d’antigènes . Ces peptides sont généralement utilisés pour la confirmation du résultat du test immunoenzymatique et pour l'exclusion des réactions non spécifiques . Les trousses commerciales disponibles varient selon la spécificité et la sensibilité de chacune .
- 111. Détection des IgG anti-VHE : les IgG sont les marqueurs d'une infection ancienne. Différentes trousses permettent leur identification : la trousse Wantai avec une sensibilité de 0,25 UI/ml,
- 112. Interprétation des résultats • Le diagnostic d'infection aigue repose essentiellement sur la recherche d'IgM anti-VHE en premier lieu. Néanmoins, l'indispensabilité de la recherche supplémentaire de l'ARN viral dépend du statut immunitaire du patient. • Chez l'immunocompétent, les IgM ont une bonne sensibilité et spécificité pour retenir le diagnostic en cas de positivité et de l'exclure en cas de négativité . Cependant en cas d'infection par le virus Epstein-Barr et par le cytomégalovirus, des faux positifs pour les IgM peuvent être observés . La recherche de l'ARN par PCR est donc plus spécifique .
- 113. • En revanche, en cas d'immunodépression, la détection d'IgM doit être complétée par la recherche de l'ARN viral dans le plasma ou dans les selles dont la positivité indique la présence d’une infection récente ou évolutive, alors que sa négativité élimine l'existence de celle-ci .
- 114. • Le test d'ARN garde ainsi son intérêt en cas d'immunodépression avec sérologie négative, • la recherche de l'ARN viral est nécessaire. Cette recherche permet la caractérisation moléculaire et la délimitation de l'infection chronique. En effet, si l'ARN viral persiste durant 3 mois, l'atteinte d'une clairance virale sans traitement devient peu probable. Ce test possède aussi un intérêt pour la surveillance surtout après réduction de l'immunosuppression ou après l'initiation de la thérapie antivirale pour s'assurer de la clairance virale avant la déclaration de la guérison du patient. Un algorithme diagnostique a été élaboré des virus à transmission entérique
- 117. • Cependant, le diagnostic de l'hépatite E pose toujours un problème. En effet, le diagnostic différentiel du VHE est vaste. Outre les quatre autres virus de l’hépatite, il existe plusieurs autres causes virales tels le cytomégalovirus CMV et le virus d'Epstein-Barr (VEB). Les causes infectieuses non virales comprennent les infections bactériennes comme la leptospirose, la rickettsiose, la fièvre typhoïde et les infections parasitaires telle la distomatose hépatique. Les causes non infectieuses sont représentées par l'hépatite auto- immune, le lupus érythémateux systémique et l'intoxication alcoolique . L'infection par le VHE peut être donc sous diagnostiquée et ne pas être considérée comme diagnostic potentiel. • Le VHE est un virus émergent et sa connaissance reste encore limitée
- 118. Prophylaxie: Immunothérapie active Le vaccin contre le VHE a pu être développé en se basant sur les propriétés d’autoassemblage des peptides issus de la zone ORF2 codant à la capside virale. Ces peptides comportent des propriétés identiques au virion natif. Un unique vaccin utilisant un peptide recombinant de 239 AA , nommé Hécolin, est actuellement commercialisé en Chine depuis 2011 pour les individus de plus de 16 ans. Son efficacité est estimée à 97 % . L'injection de 3 doses sur 6 mois, engendre une séroconversion . La population nécessitant cette vaccination n'est pas encore définie. Elle peut inclure les voyageurs, la femme en âge de procréer en zone endémique et les transplantés ou patients nécessitant une transplantation d'organes solides. La durabilité de la protection reste méconnue . L'administration chez la femme enceinte est possible .
- 119. • 2-Mesures non spécifiques Les mesures non spécifiques, d'importance égale à la vaccination, jouent un rôle important dans la prévention. Ils reposent sur les mesures hygiéno-diététiques limitant la transmission oro-fécale des deux virus.
- 120. Traitement: • Le traitement des hépatites virales aigues est essentiellement symptomatique incluant le repos stricte, l'hydratation, l'éviction de l'alcool, de la corticothérapie, l'arrêt des œstroprogestatifs durant 3 à 6 mois et la proscription de tout médicament hépatotoxique . En général, la clairance virale est obtenue spontanément
- 121. -Traitement de l'hépatite aigue E Au cours d'une hépatite E, un traitement antiviral est indiqué en cas d'infection chronique. Ce traitement inclut essentiellement la réduction du traitement immunosuppresseur, la Ribavirine et l'Interféron - α
- 122. • -Le Sofosbuvir : Il a été récemment rapporté que le Sofosbuvir, inhibiteur nucléotidique spécifique de l'hépatite C, possède une activité antivirale contre la réplication du VHE in vitro permettant un effet additif à la Ribavirine Cependant, l'efficacité in vivo de ces observations in vitro restent inconnue . -Suivi virologique : Une surveillance virologique après l'arrêt du traitement permet de concrétiser l'élimination du virus.
- 124. -Infection VHE et grossesse La prise en charge de l'infection VHE chez la femme enceinte est essentiellement symptomatique. L'utilisation de la Ribavirine et de l'interféron pégylé n'a pas été étudiée en raison de leurs risques augmentés de tératogénicité [100]. La terminaison de la grossesse peut être indiquée en cas d'insuffisance hépatique à médiation immunitaire telle le HELLP Syndrome et la stéatose hépatique aigue. Actuellement, il n'y a aucune preuve de bénéfice thérapeutique de l'interruption dans l'insuffisance hépatique aigue induite par le VHE