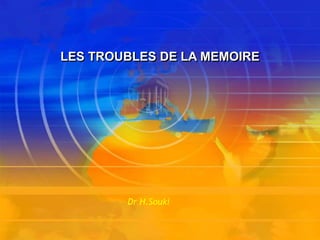
les troubles de la memoire.ppt
- 1. LES TROUBLES DE LA MEMOIRE Dr H.Souki
- 2. 2 DEFINITIONS – Fonction qui permet et assure l’enregistrement de nouvelles informations,leur stockage et leur restitution.(exclue les apprentissages fondamentaux du développement normal de l’individu.) – Fct psychique qui permet d’enregistrer,de conserver et d’évoquer les informations et les expériences du passé et de les confronter aux données de la situation présente;elle est sans cesse active puisque les informations reçues à tout moment viennent renforcer ou modifier l’ensemble des éléments stockés depuis l’enfance.
- 3. 3 HISTORIQUE Evoquée tôt par artistes et philosophes XIX eme siècle=1ers travaux /méthodologie scientifique:3 voix de recherche - Psychologie expérimentale humaine: H.Ebbinghans ,G.Muller(consolidation) -Etude de patients:Korsakoff,Freud,Luria. -Expérimentation animale:Pavlov…
- 4. 4 DIFFERENTS TYPES DE MEMOIRES • Mémoire ancienne/mémoire récente • Mémoire de fixation/mémoire d’évocation • Mémoire contrôlée/mémoire automatique • Mémoire rétrograde/mémoire antérograde • Mémoire à court terme/mémoire à long terme
- 5. 5 MEMOIRE A COURT TERME • MEMOIRE A COURT TERME=M de TRAVAIL=M primaire:permet l’analyse d’1 information sensorielle et sa restitution après 1à2 mn=indispensable à la réalisation de différentes taches,peut être évaluer grâce à l’empan,processus dynamique(traitement de l’information et de sa restitution),son contenu est continuellement mis à jour car système de capacité limitée ,permet le maintien actif et la manipulation d’informations durant la réalisation d’activités cognitives complexes(ex:résolution de problèmes)introduit la notion d’attention et son contrôle,aires concernées:PF dorsolatérales puis relais par régions pariétales si charge cognitive intense .Les informations tractées par la M.de travail sont ou effacées ou stockées dans la M.à long terme
- 6. 6 MEMOIRE A LONG TERME § Plusieurs subdivisions=s/systèmes en fonction du contenu. §-M.episodique:référence au souvenir conscient d’expériences passées,spécifiées dans le temps et l’espace(M.biographique+M.prospective) -M.semantique:référence aux concepts qui font la connaissance générale du monde ,sans association au contexte d’apprentissage §Cohen: -M.déclarative=M.episodique+M.semantique:les 2 accéssibles à la Cs et donc verbalisables. -M.non declarative=procedurale=Incs,peu flexible,concerne les capacités perceptives et motrices.
- 7. 7 MEMOIRE A LONG TERME D.Schater et P.Graf: -M.explicite:référence à la récupération Cs et intentionnelle(M.semantique+M.episodique). -M.implicite:référence à la récupération inCs et non intentionnelle(M.procédurale;habilités motrice..+Amorçages perceptifs+Automatismes+Stockage des apprentissages)
- 8. 8 Mémoire à Long Terme Mémoire Explicite Mémoire Implicite Mémoire sémantique = savoir Mémoire épisodique = souvenirs Rappels MEMOIRE A LONG TERME
- 9. 9 Les processus mnésiques Encodage : perception d’une nouvelle information, opération sur cette information et introduction en mémoire des opérations effectuées. Stockage : maintien en mémoire de l’information encodée. Récupération : retrouver une information (Disponibilité et accessibilité) MEMOIRE A LONG TERME
- 10. 10 Processus d’acquisition et de restitution • Elaboration et l’emploi d’1 trace Mnésique implique 3 temps:encodage/stockage/restitution. • Encodage=transformation(avant enregistrement) s/1 forme +ou- élaborée d’1 information sensorielle;l’encodage peut être Cs ou InCs,ex:codage contextuel. • Stockage=3 niveaux d’analyse et de stockage. - N.superficiel:traite et enregistre les caractéristiques physiques élémentaires de l’information. -N.moyen:analyse les données/stock interne de prototypes. -N.profond:réseau abstrait de nœuds interconnectés;chaque information traitée(enregistrée)à ce Niveau est codée selon sa richesse sémantique et chaque nœud=1 elt de signification
- 11. 11 SUITE • Récupération=restitution d’1 information stockée;elle dépend de l’encodage,la reconnaissance est plus efficace que le rappel. • Oubli=toutes les données enregistrées ne persistent pas indéfiniment,même chez les hyper mnésiques:courbe d’oubli(1885).oubli est lié à 2 phénomènes:déclin de la trace+interférences(souvenirs plus récents peuvent utiliser les même codes.
- 12. 12 RAPPEL ANATOMIQUE • Absence d’organe de la mémoire. • Lésion de quoi dans Amnésie? • Certaines structures anatomiques sont clairement impliquées même si elles le sont dans d’autres fonctions(étude de patient avec syndrome lésionnel=amnésie pure,expérimentation animale). • Système limbique +cortex cérébral en général+cortex sensoriel+cortex associatif+ cortex orbitofrontal. • Circuit de Papez=boucle hippocampo- hippocampique;reliant hippocampe+corps mamillaire+thalamus+cortex cingulaire. • Surtout:cortex préfrontal+gyrus frontal+HIPPOCAMPE
- 13. 13 PHARMACOLOGIE DE LA MEMOIRE • M=coopération entre des systèmes hiérarchisées à différents niveaux de l’organisation cérébrale. • Biochimie+Electrophysiologie+Génétique moléculaire. • Recherche =visées multiples(ex:thérapeutique) • Acétylcholine=N.M le plus impliqué dans le processus de M. -déficit cholinergique dans maladie d’Alzheimer -anticholinergiques perturbent l’apprentissage et mémoire chez l’animal • Noradrénaline=système coeruléocortical pourrait contrôler l’attention sélective dont le rôle est essentiel dans processus de mémorisation. • 5H-T+=lien mal connu,dans Alzheimer:diminution de l’innervation serotoninergique corticale. • Récepteurs Gaba=agonistes inverses des récepteurs Gaba améliorent l’apprentissage. • BZD=amnésie anterograde
- 14. 14 FACTEURS MODULANT L’ACTIVITE MNESIQUE • Niveau d’activation de la vigilance=Attention • Motivation=sélection en fonction de l’intérêt. • Etat affectif:participe à la motivation. • Répétition de l’apprentissage=phase de consolidation. • Forme et Nature de l’information. • Age=facteur important,fixation diminue avec l’age • Certains agents pharmacologiques,ex:amphétamines=augmentent mémoire en augmentant la vigilance mais gros risques
- 15. 15 EXAMEN CLINIQUE DE LA MEMOIRE • EXAMEN PSYCHIATRIQUE • INFORMATIONS ET ELEMENTS D’ORIENTATIONS:plaintes du sujet,dires de l’entourage,récit de sa vie,organisation chronologique de la mémorisation. • LES EPREUVES SIMPLES:apprécier la mémoire à court terme et fonctions de fixation(span verbal=empan=faire répéter des listes de chiffres de +en+ longues,score entre 5 et 7 ou listes de mots.Reproduction d’1 figure complexe de Rey.Epreuves des objets cachés(évocation,reconnaissance,répétition 1h et 24h après:Barbizet).Echelle de mémoire de Weschler(srt pour déficit mnésique isolé) • EXAMEN NEUROPSYCHOLOGIQUE.
- 16. 16 Limites de la psychopathologie cognitive • Les mécanismes fonctionnels qui sous-tendent les troubles cognitifs ne sont pas compris • Il n’existe pas de modèle cognitif suffisamment détaillé pour rendre compte de manière intégrée la multiplicité des dysfonctionnements cognitifs et de leur relation avec les difficultés quotidiennes des patients.
- 17. 17 • La psychiatrie pose le problème de l’application du modèle et des méthodes de la neuropsychologie à l’étude des troubles mentaux. • Dysfonctionnements neurobiologiques chez les patients schizophrènes le modèle lésionnel n’est pas applicable stricto sensu. • L’articulation des niveaux clinique et cognitif reste difficile. La neuropsychologie et la psychiatrie
- 18. 18 La neuropsychologie et la psychiatrie • Rappel historique • Nécessité de posséder des connaissances : – Psychopathologie – Neuropsychologie • Relations psychologue / neuropsychologue
- 19. 19 L’évaluation neuropsychologique • Aide au diagnostic • Evaluation du retentissement des troubles • Prise en charge (suivi, rééducation)
- 20. 20 Comment se déroule une consultation avec un psychologue-neuropsychologue ? • L’évaluation comprend plusieurs temps distincts : - entretien clinique ou anamnèse, - passation de tests neuropsychologiques - restitution orale en fin de bilan avec les patient - rédaction d’une synthèse (compte-rendu du bilan, suivi, prise en charge…) L’évaluation neuropsychologique
- 21. 21 Objectif général de l’évaluation : • déterminer la présence de troubles cognitifs, • identifiées les aptitudes intactes, • recherche un profil neuropsychologique spécifique. L’évaluation neuropsychologique
- 22. 22 CLASSIFICATION DES TROULES MNESIQUES • AMNESIES++++ • HYPERMNESIES • PARAMNESIES
- 23. 23 AMNESIES TRANSITOIRES ORGANIQUES -1/ICTUS AMNESIQUE:d’apparition brutale,oubli total,conservation du langage,conservation de la motricité,conservation des gestes de la vie courante,amnésie de l’épisode+amnésie rétrograde;juste avant l’événement=amnésie lacunaire,dure quelques heures,origine vasculaire voir méconnue.
- 24. 24 (SUITE) -2/AMNESIE POST TRAUMATIQUE:(syndrome subjectif des traumatisés crâniens ou syndrome post commotionnel ou encore suite à un coma). Amnésie antérograde+oublis à mesure après la confusion mentale suite au coma,dure quelques secondes à plusieurs mois,retour progressif avec amélioration de la fixation,amnésie rétrograde de quelques mois ou années avant le traumatisme,amnésie lacunaire persiste.
- 25. 25 (SUITE) -3/AMNESIES TRANSITOIRES PENDANT LA CONFUSION MENTALE:encéphalopathie toxique,métabolique…,convulsion généralisée,cure par ECT,certaines dépressions
- 26. 26 AMNESIES ORGANIQUES PERMANENTES • SYNDROME DE KORSAKOFF:alcoolisme chronique+carences nutritionnelles,installation souvent rapide après 1 encéphalopathie aigue de Gayet-Wernicke,consécutive à 1 atteinte diencéphalique,fait d’1 amnésie antérograde massive+désorientation temporelle totale,capacité d’acquisition de nouvelles information très perturbée,mémoire à court terme est conservée(empan),possibilité d’apprentissage en mémoire épisodique et biographique,souvent amnésie rétrograde étendue avec gradient temporel.
- 27. 27 (SUITE) • DEMENCES CORTICALES(TYPE ALZHEIMER):troubles mnésiques sont prédominant,M. à court terme est atteinte,M.déclarative est constamment perturbée meme au début,M.episodique est particulièrement atteinte(troubles de l’encodage:du rappel libre , de la reconnaissance et mauvaise amélioration lors d’apport d’indices)la M.sémantique est touchée plus tard,la M.procédurale(lecture en miroir,labyrinthe)reste normale jusqu’à 1 stade avancée. • VIELLISSEMENT CEREBRAL NORMAL ET PATHOLOGIE:diminution de certaines capacités mnésiques cependant beaucoup de maladies dégénératives sont liées à l’age.
- 28. 28 AMNESIES NON ORGANIQUE • CHOC EMOTIONNEL • ETATS SECONDS • TAUMATISMES PSYCHIQUES
- 29. 29 CAS PRATIQUES Maladie d’Alzheimer/dépression/ La schizophrénie
- 30. 30 Diagnostic différentiel : dépression / démence • Certains symptômes sont communs à la dépression et à la démence : – Réduction de l’activité, – Ralentissement psychomoteur, – Troubles cognitifs… • La pseudo-démence (tableau clinique rare) • La dépression peut aussi précéder l’émergence d’une démence.
- 31. 31 La Maladie d’Alzheimer (MA) • Problème de santé mentale • Atteinte des fonctions cognitives : – perturbation de la mémoire épisodique. • Quelques chiffres (Belleville 2004) : – 20 – 40 % des patients MA souffrent d’une dépression, – 20 % des dépressions sont associées à des troubles cognitifs. Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 32. 32 La dépression Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 33. 33 • Les échelles cliniques d’évaluation de la dépression : - instruments d’auto évaluation • Questionnaire de dépression de Beck ou BDI (1961) dont il existe 3 versions (13, 21, 25 items). Les items sont cotés de 0 à 3 • Questionnaire Center for Epidemiologic Studies Depression scale ou CES-D (Radloff, 1977) : 20 items cotés de 0 à 3 - instruments d’hétéro évaluation • Echelle de Hamilton ou HDRS (1967), dont il existe plusieurs formes, à 17 (la plus utilisée), 21, 23, et 26 items, les paliers étant variables (de 0 à 2, à 3 et 4) • Echelle de Montgomery et Asberg ou MADRS (1979) : 10 items, Paliers de cotation = 0-6 Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 34. 34 1. Humeur dépressive 13. Symptômes somatiques généraux 2. Sentiments de culpabilité 14. Symptômes génitaux 3. Suicide 15. Hypocondrie 4. Insomnie du début de la nuit 16. Perte de poids 5. Insomnie du milieu de la nuit 17. Prise de conscience (autocritique) 6. Insomnie du matin 18. Variations dans la journée 7. Travail et activités 19. Dépersonnalisation et déréalisation 8. Ralentissement 20. Symptômes délirants de persécution 9. Agitation 21. Symptômes obsessionnels 10. Anxiété psychique 22. Sentiment d'impuissance 11. Anxiété somatique 23. Sentiment d'être sans espoir 12. Symptômes somatiques gastro- intestinaux 24. Sentiment de dévalorisation Echelle de dépression de Hamilton (HDRS)
- 35. 35 La mémoire Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 37. 37 Reconnaissance Rappel indicé Rappel libre Les processus mnésiques
- 38. 38 Rappel libre Conditions de récupération Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 39. 39 Café Tulipe Assiette Abricot Bêche Quels étaient les mots appartenant à la liste ? Rappel libre Apprentissage
- 41. 41 Rappel indicé Conditions de récupération Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 42. 42 Il y avait une boisson ? Il y avait une fleur ? Il y avait une pièce de vaisselle ? Il y avait un fruit ? Il y avait un outil ? Rappel indicé
- 44. 44 Reconnaissance Conditions de récupération Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 47. 47 Tomate N Thé N Bêche O Café O Pêche N Reconnaissance Café Tulipe Assiette Abricot Bêche
- 48. 48 Reconnaissance Rappel indicé Rappel libre Minimisent implication LF Conditions de récupération Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 49. 49 Troubles cognitifs liés au vieillissement Les ressources attentionnelles diminuent La mémoire de travail est moins efficace La vitesse de traitement de l ’information est ralentie Effort de concentration plus important Difficultés pour faire plusieurs choses en même temps Un nouvel apprentissage demande plus de temps Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 50. 50 Troubles de la mémoire épisodique dans la MA • Déficit pas ou peu amélioré par les procédés de facilitation des mécanismes de rappel • Troubles de l'enregistrement et de l'accès à l'information • Rappel libre déficitaire (avec des intrusions) • Pas d’amélioration en rappel indicé • Pas d’amélioration entre rappel et reconnaissance Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 51. 51 Mesures quantitatives - Rappel libre +++ +++ - Rappel indicé - ++ - Reconnaissance - ++ - Rappel différé - +++ Mesures qualitatives - Intrusions - +++ - Persévérations + +++ Autorégulation + +++ Flexibilité cognitive + +++ Mise en œuvre de stratégies + +++ Autocontrôle + +++ Inhibition + +++ Sensibilité aux interférences + +++ Dépression M A Mémoire explicite Fonctions exécutives Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 52. 52 Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 53. 53 1ère planche Diagnostic différentiel : dépression / démence hareng gilet domino jonquille
- 54. 54 Diagnostic différentiel : dépression / démence Rappel immédiat
- 55. 55 Diagnostic différentiel : dépression / démence 2ème planche dentiste groseille cuivre harpe
- 56. 56 Diagnostic différentiel : dépression / démence Rappel immédiat
- 57. 57 mésange tilleul judo céleri valse rougeole tabouret géographie 3ème planche 4ème planche Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 58. 58 Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 59. 59 Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 60. 60 Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 61. 61
- 62. 62 Normes Age 16-29 30-49 50-64 65-74 75-100 R Immédiat 15,8 (0,5) 15,5 (0,9) 15,7 (0,7) 15,3 (0,8) 15,2 (1,4) R Libre 1 11,3 (1,9) 9,6 (2,6) 9,4 (2,6) 8,4 (2,5) 8,7 (2,1) R Total 1 15,5 (1) 14,9 (1,6) 14,8 (1,7) 14,3 (2,1) 14,8 (1,4) R libre 2 13,5 (1,5) 11,6 (2) 10,3 (2,6) 9,2 (2,4) 10 (2,9) R Total 2 15,8 (0,4) 15,5 (0,8) 15,3 (1,2) 14,8 (1,8) 15,2 (1) R Libre 3 14,3 (1,3) 13,5(1,5) 12,1 (3) 11,2 (2,8) 9,9 (2,3) R Total 3 15,9 (0,2) 15,9 (0,5) 15,5 (0,9) 15,6 (0,6) 15,5 (1) Total 3 RL 39,1 (3,8) 34,7 (4,9) 31,8 (7,3) 28,9 (6,8) 28,5 (6,6) Rec correctes 15,9 (0,2) 15,9 (0,6) 15,7 (0,7) 15,7 (0,5) 15,8 (0,5) FR sém 0,06 (0,4) 0 0,09 (0,4) 0,08 (0,3) 0,04 (0,2) FR neutres 0,02 (0,1) 0 0,03 (0,2) 0 0 RL différé 14,9 (1,5) 13,9 (1,8) 12,2 (2,7) 11 (2) 10,4 (2,9) RT différé 15,9 (0,1) 15,9 (0,3) 15,7 (0,8) 15,2 (1,4) 15,3 (0,9) Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 63. 63 Autre méthode d’évaluation de la mémoire épisodique La mémoire autobiographique Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 65. 65 Mémoire et états subjectifs de conscience Episodique Autonoétique Sémantique Noétique Procédural Anoétique (Noese=acte par lequel la pensée vise un objet.) Tulving (1985) Systèmes de mémoire Conscience
- 66. 66 Mesures quantitatives - Rappel libre +++ +++ - Rappel indicé - ++ - Reconnaissance - ++ - Rappel différé - +++ Mesures qualitatives - Intrusions - +++ - Persévérations + +++ Autorégulation + +++ Flexibilité cognitive + +++ Mise en œuvre de stratégies + +++ Autocontrôle + +++ Inhibition + +++ Sensibilité aux interférences + +++ Dépression M A Mémoire explicite Fonctions exécutives Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 67. 67
- 68. 68 Les fonctions exécutives Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 69. 69 Fonctions exécutives • fonctions cognitives élaborées • Intervenant dans le comportement orienté vers un but et les activités non routinières (situations nouvelles, conflictuelles ou complexes) • Impliquent structures pré-frontales et sous-corticales, • Difficultés fonctionnelles: Impact sur la qualité et la réussite de la réadaptation • Evaluation difficile Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 70. 70 Stratégie Fonctions exécutives Planification Maintien de l’attention Flexibilité mentale Inhibition Les fonctions exécutives
- 71. 71 Le Wisconsin Card Sorting test (WCST) • Le Wisconsin Card Sorting Test est très largement utilise en neuropsychologie pour évaluer le raisonnement abstrait et l’aptitude à changer de stratégie cognitive en réponse aux modifications de l’environnement. • Plusieurs versions : - 2 X 24 cartes - 2 X 64 cartes • Analyse : -Nombre de catégories, - Nombre et type d’erreurs (persévérative, non persévérative) Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 72. 72 Le Wisconsin Card Sorting test (WCST) 48 cartes réponses 4 cartes-stimulus Nelson, H.E. (1976). A modified card sorting test sensitive to frontal lobe defects. Cortex, 12, 313-324.
- 73. 73 SUJET EXAMINATEUR ? Le Wisconsin Card Sorting test (WCST) Nelson, H.E. (1976). A modified card sorting test sensitive to frontal lobe defects. Cortex, 12, 313-324.
- 74. 74 1er critère : la couleur Le Wisconsin Card Sorting test (WCST)
- 75. 75 2ème critère: la forme Le Wisconsin Card Sorting test (WCST)
- 76. 76 3ème critère : le nombre Le Wisconsin Card Sorting test (WCST)
- 77. 77 1 Forme Oui 2 Forme Oui 3 Couleur Non 4 Nombre Non 5 Couleur Non 6 Forme Oui 7 Forme Oui 8 Forme Oui 9 Forme Oui 10 Forme Oui 11 Forme Oui "Maintenant, la règle change, vous devez trouver une autre règle« 12 Nombre Oui 13 Couleur Non 14 Forme Non 15 Forme Non 16 Couleur Non 17 Couleur Non 18 Nombre Oui 19 Nombre Oui 20 Forme Non 21 Nombre Oui 22 Nombre Oui 23 Nombre Oui 24 Couleur Non Le Wisconsin Card Sorting test (WCST)
- 78. 78 Normes (Heaton, 1981) Age Nombre de catégories Nombre total d’essais N total rép correctes Nbre total d’erreurs % erreurs Réponses persévératives % réponses persévératives 20-29 5.75 (.77) 88.63 (18.98) 70.10 (8.75) 18.52 (14.06) 19.13 (9.78) 9.70 (7.83) 10.06 (5.76) 30-39 5.62 (1.08) 84.81 (18.98) 68.65 (10.58) 16.16 (13.31) 17.57 (10.74) 8.87 (8.28) 9.40 (5.84) 40-49 5.52 (1.24) 83.63 (19.72) 65.70 (8.89) 17.94 (18.88) 18.75 (13.98) 10.11 (11.10) 10.50 (7.86) 50-59 5.46 (1.35) 87.42 (19.40) 67.85 (11.51) 19.57 (17.07) 20.47 (12.78) 12.01 (16.58) 12.17 (12.48) 60-64 4.64 (1.70) 102.96 (24.99) 71.56 (8.66) 31.40 (20.70) 27.60 (13.48) 20.12 (15.84) 17.31 (11.06) 65-69 4.31 (2.07) 105.94 (22.34) 68.81 (14.25) 37.09 (22.51) 33.10 (16.60) 23 (17.51) 20.14 (12.83) 70-74 3.97 (1.64) 117.93 (18.01) 72.86 (7.02) 45.07 (17.21) 36.77 (11.16) 26.79 (12.39) 21.92 (8.70) 75-79 2.87 (1.54) 126.81 (4.75) 69.44 (15.13) 57.38 (17.28) 45 (13.11) 42.19 (25.60) 33.06 (19.88) 80-84 3.78 (2.24) 112.11 (22.98) 68.17 (14.64) 43.94 (22.42 37.43 (15.90) 33.44 (23.67) 28.20 (17.75) 85-89 2.75 (3.20) 89.25 (31.17) 51.25 (31.77) 38 (8.08) 46.72 (18.93) 29.25 (10.08) 38.70 (23.62) Le Wisconsin Card Sorting test (WCST)
- 79. 79 Le Trail Making Test (Reitan, 1944) • 2 planches : - TMT A - TMT B • Cotation : - Nombre d’erreurs, - Temps. Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 80. 80 Partie A Partie B Le Trail Making Test (Reitan, 1944)
- 81. 81 81 A C 1 2 7 3 D 5 B 4 6 Partie A Partie B [initiation] [flexibilité] Le Trail Making Test (Reitan, 1944)
- 82. 82 Le Trail Making Test (Reitan, 1944)
- 83. 83 Le Trail Making Test (Reitan, 1944)
- 84. 84 Normes (Ivnik, Malec et Smith, 1996) 56-62 ans 66-71 ans 72-77 ans 81-86 ans 87-97 ans Percentile A B A B A B A B A B 90 20 45 25 52 25 56 29 75 29 76 75 25 57 29 68 30 75 38 101 38 101 50 31 70 35 85 38 102 50 125 47 125 25 38 90 44 120 48 156 60 172 60 165 10 50 13 0 60 180 75 210 79 235 80 235 Le Trail Making Test (Reitan, 1944)
- 86. 86 Diagnostic différentiel : dépression / démence Le stroop (1935) • 3 planches - lecture des noms de couleurs, - dénomination des couleurs, - planche d’interférence. • Différents modes de passation • Cotation : normes pour chaque planche et calcul du score d’interférence Stroop, J.R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18, 643-662.
- 87. 87 Le test de stroop (1935)
- 88. 88 Le test de stroop (1935)
- 89. 89 Le test de stroop (1935)
- 90. 90 BLEU VERT JAUNE ROUGE VERT JAUNE ROUGE BLEU JAUNE BLEU VERT ROUGE ROUGE VERT BLEU JAUNE BLEU ROUGE JAUNE VERT VERT JAUNE BLEU ROUGE JAUNE VERT ROUGE BLEU ROUGE BLEU JAUNE VERT BLEU ROUGE VERT JAUNE ROUGE JAUNE BLEU VERT BLEU VERT JAUNE ROUGE VERT BLEU ROUGE JAUNE ROUGE JAUNE VERT BLEU JAUNE ROUGE BLEU VERT VERT JAUNE BLEU ROUGE JAUNE VERT BLEU ROUGE VERT ROUGE JAUNE BLEU ROUGE BLEU VERT JAUNE BLEU JAUNE ROUGE VERT JAUNE ROUGE VERT BLEU ROUGE BLEU JAUNE VERT BLEU VERT ROUGE JAUNE JAUNE ROUGE BLEU VERT BLEU JAUNE VERT ROUGE VERT ROUGE JAUNE BLEU Le test de stroop (1935)
- 91. 91 Un score d’interférence est calculé Interférence = CW – score prédit CxW Score prédit = -------- C+W Le test de stroop (1935)
- 92. 92 déduction de règles maintien d’une règle correcte Le test de Brixton (Burgess et Shallice, 1996)
- 93. 93 Mesures quantitatives - Rappel libre +++ +++ - Rappel indicé - ++ - Reconnaissance - ++ - Rappel différé - +++ Mesures qualitatives - Intrusions - +++ - Persévérations + +++ Autorégulation + +++ Flexibilité cognitive + +++ Mise en œuvre de stratégies + +++ Autocontrôle + +++ Inhibition + +++ Sensibilité aux interférences + +++ Dépression M A Mémoire explicite Fonctions exécutives Diagnostic différentiel : dépression / démence
- 95. 95 Modèles cognitifs de la schizophrénie Attention, Langage, Mémoire... Heinrichs et Zakzanis (1998) 1911 Schizophrénie ... une pathologie de la cognition Descriptions cliniques 1980 La schizophrénie
- 96. 96 Les altérations de la mémoire chez le patient schizophrène MÉMOIRE À LONG TERME Perturbation de la mémoire explicite Conservation de la mémoire implicite Perte de cohérence de la remémoration consciente Perte du lien entre l’information et son contexte = altération de la mémoire contextuelle Perte de la capacité de représentation d’une situation, d’un acte D’après Huron C. et al. Impairment of recognition memory with, but not without, conscious recollection in schizophrenia. Am. J Psychiatry, 1995 ; 152(12): 1737-1742.
- 97. 97 • Le déficit des fonctions cognitives débuterait même avant l’apparition des premiers signes cliniques. • Des études mettent en évidence des perturbations cognitives au cours du premier épisode de la maladie (Bilder et al., 2000 ; Barch et al., 2001 ; Saykin et al., 1994). • Au décours de la maladie, certains déficits cognitifs se stabiliseront alors que d’autres s’aggraveront. Cognition et schizophrénie : jeune adulte
- 98. 98 • Les dysfonctionnements cognitifs sont étroitement liés à la désinsertion sociale et professionnelle plus que les symptômes positifs et négatifs. • En terme de fonctionnement quotidien : – Le pronostic d’un patient avec de bonnes capacités mnésiques est meilleur que celui d’un patient présentant un déficit, et ce même si le premier patient présente des symptômes cliniques plus marqués que le second. Cognition et schizophrénie D’après Green M.F . Schizophrenia from a neurocognitive perspective, Allyn and Bacon, Boston, 1998. Frith C.D. The cognitive neuropsychology of schizophenia.LEA, Hove, 1992.
- 99. 99 Evaluation de la personnalité Examens complémentaires
- 100. 100 Minnesota Multiphasic Personnality Inventory-2 • Hathaway et Mc-Kinley, 1943 MMPI, 1992 dernière version • Auto-questionnaire composé de 567 énoncés. Le sujet doit répondre par Vrai ou Faux • Profil constitué de 10 échelles cliniques et 3 échelles de validité • Echelles de validité : Mensonge (L), Rareté de réponses (F) et Correction (K) • Echelles cliniques : Hypochondrie (1-Hs), Dépression (2-D), Hystérie (3-Hy), Déséquilibre Psychopathique (4-Pd), Masculinité-féminité (5-Mf), Paranoïa (6-Pa), Psychasthénie (7- Pt), Schizophrénie (8-Sc), Manie (9-Ma) et Introversion sociale (10-Si) L’évaluation de la personnalité
- 101. 101 Minnesota Multiphasic Personnality Inventory-2 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 L F K 1-Hs 2-D 3-Hy 4-Pd 5-Mf 6-Pa 7-Pt 8-Sc 9-Ma 0-Si Profil banal L’évaluation de la personnalité
- 102. 102 Minnesota Multiphasic Personnality Inventory-2 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 L F K 1-Hs 2-D 3-Hy 4-Pd 5-Mf 6-Pa 7-Pt 8-Sc 9-Ma 0-Si Schizophrénie paranoïde L’évaluation de la personnalité
- 103. 103 Temperament and Character Inventory (Cloninger) • Auto-questionnaire composé de 226 énoncés. Le sujet doit répondre par Vrai ou Faux. Distinction tempérament/caractère • Le tempérament : composantes héritables, d'expression précoce, qui interviennent dans l'apprentissage par des processus préconceptuels ou inconscients. Les échelles de tempérament sont : la recherche de nouveauté, l'évitement du danger, la dépendance à la récompense, et la persévérance • Le caractère : s'oppose aux prédispositions héritées, il traduit la réorganisation des concepts de l'individu en réaction au vécu de l'expérience. Les échelles de caractère sont : la détermination, la coopérativité et la transcendance. L’évaluation de la personnalité
- 104. 104 Temperament and Character Inventory (Cloninger) L’évaluation de la personnalité
- 105. 105 PRISES EN CHARGE DES TROUBLES MNESIQUES • Examen clinique+++ • Psychopathologie+ • Psychologie++ • Neuropsychologie+++
- 106. 106 Fin