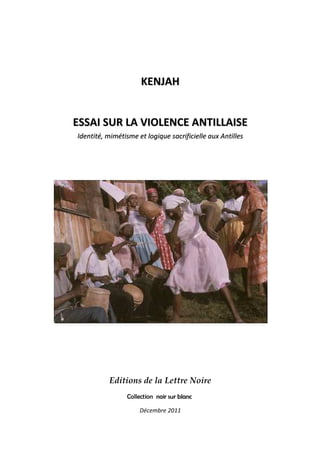
Essai sur la violence antillaise
- 1. KENJAH ESSAI SUR LA VIOLENCE ANTILLAISE Identité, mimétisme et logique sacrificielle aux Antilles Editions de la Lettre Noire Collection noir sur blanc Décembre 2011
- 2. Ali Babar KENJAH ESSAI SUR LA VIOLENCE ANTILLAISE Identité, mimétisme et logique sacrificielle aux Antilles I. Avant-vents. L’Apocalypse ou la tragique guerre des Mêmes p. 4 II. La violence et le sacré comme fondations. Présence de René Girard p. 7 III. La logique sacrificielle dans les discours antillais (Césaire, Fanon, Glissant) p . 15 1) Césaire, ou la permanence du tragique p . 15 2) Ibrahim Fanon, ou l’échec de la violence légitime p . 23 3) Glissant ou la refondation mythologique p . 37 IV. La trace du vidé. Société martiniquaise et violence p . 51 2
- 3. Au sortir d’un nième débat sur « la violence », où j’avais été invité en commune par une association familiale, je me fis à moi-même un constat affligé. En dépit de la prétendue qualité formelle de nos prestations de « spécialistes », mes camarades et moi n’avions réussi qu’à enrober de langage technique et de vérités éculées le constat banal d’une violence quotidienne que n’importe qui pouvait « interpréter » aussi légitimement que nous. Si on est en droit d’attendre d’un intellectuel qu’il éclaire et ouvre l’accès, alors nous avions échoué à justifier ce statut car jamais nous n’avons réussi (jamais nous ne réussissons, en général) à sortir du cercle clos de nos représentations communes des phénomènes de violence. Nous prétendons à la vérité objective, mais la vérité est que dans nos pratiques - en quelque bord d’où vienne la parole - nous trouvons toujours à légitimer une forme de violence en retour. Comme si le feu qui consume la maison changeait de nature selon celui qui l’a allumé. Je choisis ici, délibérément, d’envisager les choses sous l’angle de la maison qui brûle plutôt que sous celui de la culpabilité … S’agissant d’affronter intellectuellement la réalité de la/notre violence, pour l’essentiel, nous en restons au voyeurisme et nous comptons les morts. Une fois réinvoquées les mannes esclavagistes, le racialisme sexuel et la pwofitasyon coloniale, comment aborder avec pertinence, par ex., la violence à l’école ou celle faite aux femmes ? Comment lier ces deux aspects du problème, ainsi que tous les autres, dans une perspective globale et opératoire ? D’où faire levier pour agir ? Une part manifeste de notre échec vient du fait que nous traitons toujours la violence de l’intérieur même de la société qu’elle a contaminée. Nous sommes toujours-déjà dans la violence, par insuffisance de recul par rapport à l’épaisseur de pratiques sociales que nous endossons plutôt que mettre à nu. Il m’en vint la réaction déterminée d’établir un inventaire argumenté de ce que je croyais pouvoir dire – en tant qu’ « anthropologue Rastafari» – sur la violence… Car s’il nous faut prendre ce recul dans l’échange et la discussion, cela ne peut se faire dans la posture, sous le masque, du « spécialiste » mais dans l’exigence de l’exposition. Je ne crois pas à l’objectivité, mais à l’exposé. Corps nu, crucifié, de la pensée vivante ; de l’expérience de vie qui informe nos idées d’une épaisseur de vérité indicible. L’énergie que déploie Guillaume Suréna pour maintenir les braises d’une auto- analyse collective, authentiquement fondée sur l’expérience de la parole intime, relève de cette exigence fanonienne de rapporter le verbe à la pratique assumée. Que lui soient reconnus les mérites qu’on accorde à ceux qui s’exposent, Pharmakos de l’exil intérieur… Le pré-texte de cet essai fut une contribution au séminaire organisé par l’association freudienne Forum à Fort-de-France. Cette contribution, nourrie d’échanges fructueux et d’intimations personnelles, n’a pu échapper à l’inflation des « convergences éclairantes » et à la surcharge pondérale de mes attentes. Que tous soient d’avance remerciés pour leur indulgence... S’inscrire ainsi dans la première personne du singulier c’est comme passer du jeu au je. Eprouver la dimension risqué du héraut, sa dimension tragique. C’est dénouer son raccord quotidien à la chair souffrante du pays. C’est prendre sa part du drame et peser sa réplique. C’est, aussi, soulager l’amitié fidèle qui interroge, sans jamais déchoir de sa présence fraternelle : s’écrier (bien plutôt que s’écrire) peut être partage fécond ; écriture en suspension, sans filet, mais habitée… C’est donc bien de cette posture revendiquée1 (« anthropologue Rastafari ») que je porte témoignage et suggère hypothèses concernant la question de la violence aux Antilles. En m’appuyant sur l’idée de « l’inventaire », j’ai essayé de dresser un feed-back de mes lectures, rencontres intellectuelles et influences sur le chemin passionnel de mon identité martiniquaise et caribéenne… En profiter pour rendre hommage à la trilogie fondatrice de mes trois maîtres disparus… Or, très vite, il m’est revenu une véritable empathie avec les thèses et la synthèse de René Girard, celles d’une fondation sacrificielle de toutes les cultures humaines, dont il s’agit ici de proposer la féconde singularité comme point de départ d’une plus large, et nécessaire, investigation collective… Ali Babar KENJAH 1 Revendiquée, puisque certains me la conteste… 3
- 4. I. Avant-Vents. L’Apocalypse, ou la tragique guerre des Mêmes Les rares « mythes » du monde moderne, en somme, ne sont pas de vrais mythes en ceci qu’au lieu de se refermer sur des solutions sacrificielles épousées sans la moindre restriction mentale, comme les vrais mythes, au lieu de refléter la vision persécutrice, ils refusent ce genre de sacrifice, ils y dénoncent toujours une abomination. René GIRARD, Le bouc émissaire La peste est de retour. La vraie, la noire, la maudite. Après avoir ravagé le monde, la peste est dans nos murs et nul ne saurait en conjurer le sort, car nous avons aboli les rituels. La peste est contagion, envahissant et contaminant l’espace comme un gigantesque incendie incontrôlable. Tous sont égaux face au fléau. Aucune différence ne triomphe de cette malédiction : riche ou pauvre, belle ou laide, noir ou blanc, tous en tombent victimes. « Tous n’en mourraient point, mais tous étaient frappés » (J. de Lafontaine, Les animaux malades de la peste)… La calamité est totale et menace la Cité d’effondrement. Un sacrifice s’impose. Mais aucune victime potentielle ne s’impose plus à l’unanimité, toutes sont trop marquées d’une manière ou d’une autre pour soulager, à la fois, toutes les attentes. Or l’efficacité du meurtre rituel (conjurer la violence contagieuse) dépend de l’unanimité qui désigne et lapide le pharmakos, bouc émissaire. Cette unanimité permettra, in fine, le retournement qui transmutera le sacrifié en divinité. Divinité consentante à verser son sang, « pour le pardon de nos péchés ». Ce retournement du meurtre originel en paix retrouvée, est au cœur de ce que nous instituons comme « le sacré » ; c’est-à-dire le système organisé des totems et tabous par lequel nous mettons à distance les motifs les plus fréquents de déclenchement de la violence la plus contagieuse : celle des frères ennemis… Il revient à René Girard d’avoir, en réhabilitant la valeur archéologique des textes mythologiques, identifié sous la figure tragique de « la Peste » la réalité historique, préhistorique et psycho-analytique de la violence en acte. La violence sacrificielle ; le sang versé pour l’apaisement ; le sang des vierges, des nègres ou le sang du bouc qu’Abraham immola en lieu et place de son fils… La « Peste » de Sophocle et d’Euripide, c’est la propension des hommes et des sociétés humaines à succomber à la violence réciproque. Et quand la Cité, la Grande Babylone urbaine, s’arroge les limites du monde (ainsi que le pressens Clauswitz, dès l’entame du XIXème siècle), alors la chute des Tours jumelles menace jusqu’aux extrémités de toute humanité. Des déserts de sable au cœur des grandes Métropoles… « Gémellité » et « montée des extrêmes » sont deux thèmes majeurs de la perspective dégagée par Girard. En fait, le thème de « la montée des extrêmes » est donc emprunté à Clauswitz qui, le premier, en témoin des guerres napoléoniennes, pressens une possibilité désormais latente d’embrasement total de l’humanité dans un affrontement ultime et sans recours. La fin de la guerre en dentelles des aristocrates déchus, et la mobilisation générale de Valmy, ouvrent l’ère des guerres totales de partisans, qu’illustrera l’instrumentalisation en profondeur de la nation allemande par l’hubris nazie, totalitarisme dont la masse critique a été atteinte le 11 septembre 2001… Désormais la guerre est partout et dans tout. La guerre c’est le réel. L’intuition angoissante de Clauswitz, que rien n’arrête les vendettas historiques ni la propension des « violences légitimes » à réquisitionner toute forme de socialité en guise de combustible, cette épée de Damoclès qui menace en permanence la modernité issue des Lumières, c’est la violence exponentielle mondialisée, sans cesse alimentée par l’agressivité réciproque des frères « jumeaux », la pire et la plus humaine des violences (cf. les Balkans, le Rwanda, la Palestine, le Caucase, 4
- 5. l’Afghanistan, la Somalie etc.) Tout comme la société post-édénique fut structurée à partir du (de la) geste de Caïn, Rome s’élèvera à même le sang du meurtre fratricide, tel que transmis par le mythe fondateur des jumeaux de la Louve, Rémus et Romulus… Pour relatif que soit l’espace culturel martiniquais, la prégnance de la question de la violence généralisée y fait écho au constat relevé globalement pour la Caraïbe, comme pour les métropoles occidentales ou des pays émergents. Alors, qu’assez exceptionnellement, pratiquement aucun conflit régional ne menace nos îles-Cité d’une revendication de voisinage, la zone figure aux premiers rangs mondiaux de la violence urbaine endémique, menaçant en permanence et en maints endroits de dégénérer en guerre civile (Jamaïque, Trinidad, Haïti etc.) Le parapluie social de la dépendance politique et économique des îles françaises ne les met pas à l’abri du processus de mondialisation, qui dissout les solidarités et favorise le repli individuel. Bien au contraire. Nous posons, à la suite de Girard, que la dévitalisation du soubassement oral qui accompagnait l’organisation « traditionnelle », consécutive à la rationalisation et à la marchandisation de la société, rend désormais caduques les procédures rituelles de mise à distance de la violence contagieuse. Je tenterais, plus loin, d’illustrer ce propos à partir d’une analyse sur l’évolution du Carnaval martiniquais. La Martinique offre aujourd’hui le cliché d’une société menacée de la peste. Tous les jours la violence trouve l’opportunité de s’exprimer là où on ne l’attendait pas, là où jamais elle n’aurait dû « prendre », si les procédures rituelles (fussent-elles « laïques »), si nos totems et nos tabous avaient conservé leur efficacité et leur légitimité. Tous les membres de la société partagent le même constat d’un effondrement des valeurs anciennes, sans qu’aucune réponse suffisamment globale ne vienne prendre le relais de ce qui n’est plus. C’est l’anomie de Durkheim. Un feu menace qu’on ne sait plus circonscrire. Ce constat populaire s’exprime à travers la corrélation établie entre la violence généralisée et le phénomène repéré comme celui de la «perte des repères » ; c’est-à-dire le constat d’un nivellement progressif des valeurs, qui arase toute différence et transforme le vivant en machine à cloner le même. « Pen-an menm pri zakari-a », tout se vaut, tout est confus, il n’y a plus de certitudes liées à l’âge et aux générations, au sexe, au genre et à la parenté, au statut social, aux règles de voisinage, au langage, à l’argent (voire, depuis Michael Jackson, à la race !)… Bien évidemment, à l’ère d’Internet la perte des repères n’exclue pas la surabondance des repères, et tout un chacun mesure à son niveau basique que tout cela est « poussé » par une marchandisation croissante du vivant. Biznès sé business… Et que c’est la compétition financière mondialisée qui place précisément le vivant sous un régime de violence généralisé, sous la menace apocalyptique d’un krach imminent, sous l’égide des agences de notation, des oracles de Wall Street et de la City. Le marché seul fait la Loi, l’argent (Mammon) en est l’idole… La monétarisation généralisée a contaminé ce que nous tenions auparavant pour sacré : l’intime, le plaisir, le foyer, la famille, l’utilité sociale, l’image de soi… Mais cette marchandisation violente du vivant ne s’érige-t-elle pas à notre corps désirant ? Pouvons-nous encore maîtriser la compulsion consumériste qu’il nous arrive souvent de dignifier en « avantages acquis » ? Pouvons-nous encore stopper la course aux armements qu’est devenue l’affirmation individuelle dans l’espace social antillais ? Ceux qui dans nos îles ont connu le tournant culturel où, au lendemain de la Guerre – et pour la première fois – l’en-Ville s’est imposé à « la campagne », savent que la monétarisation a étouffé de vieilles solidarités pour ensoucher la convoitise et la compétition. La société issue des lois sociales de la départementalisation fut une société de l’abondance inégalitaire, en permanence traversée de tensions partisanes pour un partage équitable de la manne étatique. Nous avions depuis si longtemps partagé toute la misère du monde, qu’il nous était insupportable que la fortune nouvelle ne soit pas également répartie entre tous. A même-parts égales. Egalité mathématique et fantasmée d’un modèle lointain, Tout-puissant, qui peut promettre jusqu’à « la continuité territoriale » (c'est-à-dire d’abolir l’océan !). L’égalité républicaine comme mesure de la civilisation et du Progrès ! L’égalité formelle comme standardisation revendiquée et optimisation systémique des masses grâce à la « croissance » à l’infini des transferts de l’Etat-providence... Idéal, vertigineux et aveugle, de la flèche que seule porte son énergie. Idéal bourgeois, en fin de compte, du mimétisme et de la production en chaîne. Ainsi la juste revendication d’égalité est-elle pervertie par l’illusion d’une conformité vitale aux normes et au 5
- 6. productivisme de la modernité occidentale ; pervertie également par une logique de déliaison collective. Un processus d’individuation systémique qui porte en lui-même le retour à la guerre du tous contre tous, le mimétisme consumériste se révélant la cause fondamentale de la violence sociale générée par le libéralisme mondialisé. A ce niveau, le « Tout nonm sé nonm » républicain est surinvesti par le « nèg kont nèg », hérité de l’habitation esclavagiste (athanor de notre violence, déjà travaillée de matières caraïbes). Nous voici ainsi paré pour justifier toute pwofitasyon, pourvu qu’elle émarge à notre profit singulier (Tous créoles !). Car c’est-là un ressort essentiel de cette atomisation égotiste qui produit les clones de la guerre des Mêmes : elle nécessite notre consentement actif… Je partirais donc de ce chaos des valeurs, et d’une de ses causes les plus fondamentales : la revendication d’une égalité absolue (la « mêmeté », bwabwa du mimétisme), illusoire régression in illo tempore (à l’Age d’Or présocial), indifférenciation qui mène toute société à l’anomie décrite par Durkheim dans Le suicide : privé de tout système de différence, de références, une société s’effondre violemment… Quel prix payons-nous réellement au désir d’être un autre ? Comment allumer les pare-feu de la différence fondatrice là où l’égalité se fourvoie dans les illusions de la mêmeté et se prévaut des arguments juridiques de la légitimité ? S’il s’est renforcé de nouveaux champs de conflictualité (l’homosexualité, l’évangélisme américain et les sectes religieuses, l’urbanisation anarchique, les centres commerciaux « ma-ville-à-moi » etc.), les thèmes liés au mimétisme, souvent opacifiés par toute une rhétorique sur le Divers et la créolité, sont au cœur de la problématique violente aux Antilles, comme au mitan obscur (la fameuse aliénation de Fanon) de la psychologie culturelle des aires coloniales. Dans un premier temps, je tracerais l’éventuelle présence des éléments constitutifs de la lecture sacrificielle au sein du corpus intellectuel produit par Césaire, Fanon et Glissant, afin d’en mesurer les « compatibilités » avec ma propre lecture de René Girard. Il s’agira bien de mesurer la place qu’occupe une telle interprétation des faits de violence sociale dans la fondation intellectuelle antillaise. Je tenterais ensuite d’articuler cette logique mimétique à la perte d’efficacité des procédures rituelles traditionnellement destinées à contenir la menace permanente de violence sociale, à travers – notamment – une analyse de la dévitalisation symbolique et mythologique du carnaval martiniquais. Mais qu’il me soit d’abord permis de fonder ma propre parole et d’exposer sans gloire ma sainte violence, dans la traque identitaire, dans la trace arborescente de toute renaissance… 6
- 7. II. La violence et le sacré comme fondations. Présence de René Girard. A la fin des années 1980, j’ai développé une forme grossière de familiarité avec l’œuvre de René Girard à l’occasion d’un mémoire universitaire2. Il s’agissait de formalisation théorique d’hypothèses de recherche sur le terrain des mangroves urbaines de Fort-de-France3. Centrées sur l’émergence du discours Rastafari (identité dont je me revendique moi-même) et son impact sur l’évolution du système discursif martiniquais, ces hypothèses tentaient assez naïvement d’articuler le puzzle d’une expérience sociale frappée par l’exclusion persécutrice. Jusqu’à ce que la lecture de La violence et le sacré (1972) de René Girard, vienne éclairer mes intuitions de l’épaisseur archéologique de douze mille ans d’humanité, compressée dans la mémoire tragique des mythes de fondation de toutes les cultures dont nous conservons le témoignage. Je fis pendant longtemps un usage « définitif » de cet ouvrage séminal. Instrumentalisation de la logique victimaire, raccourcis méthodologiques, transversalité épistémologique et fermeture argumentative dans un- système-qui-marche, telles furent (trop) souvent les « bavures » de l’enthousiasme intellectuel que suscita en moi cette puissante synthèse. J’en vins à ressentir la nécessité d’une discussion élargie et transdisciplinaire sur ces propositions. Je repense souvent à cette réflexion que me fis Guillaume Suréna, un jour où nous envisagions de porter l’œuvre de Girard à la réflexion collective, «Méfies-toi, c’est précisément quand ça a réponse à tout que c’est louche ! »… De fait, à mes yeux, la synthèse de Girard est magistrale, éclairante ; potentiellement bouleversante, parce qu’elle bouleverse tout. Oh, non pas dans tel ou tel détail qui nous serait inconnu, mais dans la mise en relation dynamique, dans l’agencement signifiant de tous ces éclats de la mémoire humaine qui, soudain, laissent entendre les leçons subliminales de la violence socialisée. La mémoire des origines de ce « sacré », qui éloigne de tous ses rituels la violence de nos désirs réciproques. Il me fallut, malgré tout, du temps pour dégager le « sacré » du « Divin » et de la spiritualité. Cette maturation fut précieuse, elle contribua à clarifier la problématique de l’« objectivité du chercheur », de son recul nécessaire vis-à-vis de son « objet » d’étude et – accessoirement – de ma légitimité (en tant que Rastafari) à parler « scientifiquement » sur Rastafari… Que celui qui débarque de Mars me lance la première pierre. Que tout postulant censeur jette d’abord bas les masques ! Qui peut se prétendre objectif ? Dans l’espace anthropolinguistique du discours antillais il n’y a qu’enjeux, positions et points de vue… J’assume mon identité, qui exprime un point de vue sur l’histoire et la géographie de mon pays-archipel – partagé par les uns, combattu ou ignoré par les autres : un point de vue dont j’ai hérité l’expression de la communauté stigmatisée de mes ancêtres Africains, déportés ici en esclavage. C’est un point de vue dont le rhizome a capillarisé à tout va, mais dont une différence essentielle, une des expressions classiques était perçue et désignée par les Créoles comme étant l’expression des vieux-nègres (qui ne renvoie pas au qualificatif « petit-nègre » de la dérision raciste). Le terme « vieux » est ici à prendre dans sa matière insulaire. Contrairement à ce que laisse entendre la stigmatisation mulâtre, ni vieux-nègre ni vieux-blanc ne sont des termes péjoratifs qui pointeraient la vieillesse ou la laideur. Dans l’épaisseur archéologique de la colonisation des îles, ils désignent des formes d’antériorité sur lesquels il faut faire silence, des états précédents de la société, incompatibles avec l’hagiographie et l’historiographie imposées par les états successifs du Pouvoir. Le terme « vieux-blanc » fait référence à la classe des « petits blancs » (béké griyav, blanc matignon en Guadeloupe) qui, à la Martinique, fut réprimée après le Gaoulé autonomiste de 1717 et fit les frais de l’émergence de l’habitation sucrière « aristocratique ». Ce terme évoque également l’institution de l’ « Engagement », essentielle à la 2 Philippe Alain Yerro, Identité et exclusion à la Martinique. Prolégomènes à une approche anthropolinguistique de la dynamique sociale des mangroves urbaines de Fort-de-France ; mémoire de DEA ; GEREC, UAG, 1991 3 « mangrove urbaine » désigne les quartiers populaires d’habitat spontané des villes-capitales antillaises. Sur ce concept voir Tanic et Letchimy in revue Carbet n° 7
- 8. première phase de colonisation des îles ; phase durant laquelle la force de travail des esclaves noirs est limitée, l’essentiel de la charge de défrichement étant supportée par les engagés européens. C’est l’époque où on parle encore de blancs marrons… Du fait que notre recherche historique reste globalement tributaire des limitations coloniales de l’histoire académique, le terme vieux-nègre est, pour l’heure, laissé à la libre invocation des penseurs libres, poètes et résistants. Ce que les faits établissent en certitude, c’est que la relation des premiers européens à avoir effectué un séjour de quelques mois à la Martinique (L’Anonyme de Carpentras et l’équipage du capitane Fleury, en 16104) mentionne la présence d’Africains des deux sexes au sein des communautés Amérindiennes. Certaines maladies infectieuses observées sur les Caraïbes sont même soupçonnées d’être originaires de Guinée. P. Régent et T. L’Etang documentent le naufrage d’un galion espagnol, avec une cargaison de près de deux cent esclaves trouvant refuge sur l’île (1605 ou 1606). Certains individus proviennent également des razzias lancées sur les îles espagnoles et les communautés arawak urbanisées du nord de l’archipel. Les réfugiés ont semblent-ils un statut de « captifs », bien que l’Anonyme note un traitement privilégié distinguant ces Africains, affectés aux tâches agricoles, des autres captifs et notamment des ennemis jurés, les Inibis : les Africains – ne relevant d’aucune vendetta en cours – ne sont jamais, à l’inverse des Inibis, l’objet de rituels anthropophagiques (même s’il peuvent, rituellement, accompagner leur « maître » dans la mort). Les femmes noires enfantent des enfants Kalinago, qu’une simple visite dans la réserve Caraïbe de Dominique permet parfaitement d’imaginer. Le modèle « pur » de la culture négro-caraïbe disparaît de l’espace insulaire avec la défaite des résistants Blacks Karibs de Saint-Vincent (Seconde Guerre Karib, 1795-1805), dont l’héritage survit à travers les communautés Garifunas de la côte caraïbe hondurienne… Rien ne vient documenter une solution de continuité quant à la présence négro-caraïbe tout au long de la construction de la société martiniquaise. Le métissage martiniquais originel ne naît pas de l’arrogante créolité de l’habitation. Il est déjà à l’œuvre avant même la présence française sur cette terre. Il traverse, invisible, improbable, omniprésent, notre histoire et notre réalité. Il y a parmi nous la présence « Batoutos » (silencieuse et légendaire) de cette rencontre fondatrice qui féconda un certain rapport à la terre, à ces lieux-dits. Co-naissance dont s’emparèrent ultérieurement les nègres marrons (le jardin négro-caraïbe de survie alimentaire, requalifié folkloriquement de « jardin créole »), mais aussi la science madrée de la dissimulation et du camouflage (discursif autant que stratégique). C’est ainsi que le Nègre Marron de Khôkhô René-Corail, sur la place éponyme au Lamentin, est un « arbre ». Un arbre sacré. L’homme-plante qu’avait chanté Suzanne Césaire. Que nous retrouverons dans l’exploration romanesque de Glissant… Les vieux-nègres cultivent le retrait, et les microcosmes abreuvent leur curiosité philosophe. Leur fatalité apparente se transforme en pouvoirs, lorsqu’on entend l’harmonie de leur frappe dans la polyrythmie de la vie. Les vieux-nègres rechignent à jeter leurs perles aux pourceaux, qui plus est domestiqués au Purina ! Les vieux-nègres sont invisibles ; antimatière et trou noir bienveillant des Monsieur Médouze de notre enfance. Ils sont la réalité de notre héritage caraïbe. Beaucoup de Martiniquais, à tort ou à raison, se revendiquent de ce lignage secret, trahissant ainsi le pacte ancien sous le ricanement anba fèy des masses ignorantes (qui garantissent ainsi le secret, malgré tout, par leur incrédulité et leur soumission à l’Histoire officielle). Tous ces développements de la connaissance culturelle n’auraient, somme toute, que peu d’importance dans le champ de nos problématiques contemporaines, si ce n’est leur pertinence à invalider les Créoles comme historiquement détenteurs de cette forme de légitimité à laquelle ils réfèrent leurs prétentions intellectuelles et politiques : le monopole de l’Autochtonie… Car il est faux de prétendre que l’autochtonie martiniquaise procède exclusivement de l’habitation. Cette perspective nouvelle, de l’antécédence et de la permanence négro-caraïbe, interdit à jamais que l’expression du « Nous, les Martiniquais, enfants de cette terre », « Nous, les habitants », ne se construise sur l’exclusion du Nègre revendiquant sa négritude, ainsi que l’envisage la vision créole depuis MM. De 4 In Jean-Pierre Moreau, Un flibustier français dans la mer des Antilles, Seghers 1990, Petite Bibliothèque Payot, 2002 8
- 9. Saint-Méry et Gobineau jusqu’à ceux qui s’affirment dans la triple négation du « Nous, ni européens, ni africains, ni amérindien »… Il y a, dans l’archéologie culturelle martiniquaise, un état précédent les camps de concentration de l’Habitation, une strate historique plus ancienne, dans le rapport collectif à cette terre. Vieux-nègre laisse également entendre qu’avant le Gaoulé, et la concentration foncière des habitations, les relations entre les races n’étaient pas enfermées dans la stricte prophylaxie du Code Noir. Bien que déjà opacifiée par la perspective colonisatrice, la présence séminale du vieux-nègre se laisse entendre dans la qualification même du mouvement autonomiste de 1717 : d’où vient le terme « Gaoulé » ? Si la plupart des commentaires inclinent vers une « incompréhensible » étymologie caraïbe, dans son essai éponyme5 J. Petitjean-Roget avance que c’est le nègre-annonceur de M. Latouche qui, par sa fonction médiatique de lyannaj, répandit partout une synthèse circonstanciée des événements, qu’il résuma d’une expression héritée du patrimoine négro-caraïbe (auquel il devait avoir accès), et qui signifiait certainement « agitation (liée aux bagarres collectives, omniprésentes chez les Kalinagos) », « tohu-bohu », « grand bordel dans la société ». Opacifiée par la mobilisation des colons, la présence silencieuse des vieux-nègres (et des esclaves) se révèle dans la parole qui nomme et qui fait trace dans la mémoire… A distance d’un mépris souvent féminin, et toujours plein d’urbanité, la souche vieux-nègre s’est bien- malement maintenue à travers quelques résidus patrimoniaux de la ruralité délaissée. Elle s’est déployée dans une variété de pratiques progressivement sorties de leur marginalité (et du folklorisme touristique) par la construction identitaire du nationalisme « autochtone » dans son opposition au patriotisme colonial français. Certes les pratiques des vieux-nègres étaient unanimement réprouvées (y compris dans les campagnes, où on redoutait l’occulte), mais on aurait tort, cependant, d’en espérer des contenus « révolutionnaires » ou « libérateurs ». Pour ne prendre qu’un exemple : il y a certainement un contenu politique implicite et explicite dans le bèlè ; mais d’un point de vue politique, l’essentiel est plutôt dans le rapport de notre pratique du bèlè au réel que nous voulons changer (ce en quoi le bèlè, aujourd’hui, véhicule une énergie transformatrice qu’il n’a jamais eu auparavant. Qu’on songe un instant à la place des femmes au cœur de la ronde)… La parole des vieux-nègres ne s’énerve pas de la convoitise consumériste ni des affres de l’accumulation matérialiste. Elle « chante » l’équilibre de la présence naturelle, entre les rythmes de la grâce providentielle et l’ascèse du corps face aux limitations et aux pwofitasyon de la vie. La référence au vieux-nègre n’est pas tant une question de contenus et de substance qu’un rapport à nous-mêmes, noué, enté à un rapport à cette terre-archipel. En ce sens, les réflexions et le travail créatif initiés par le groupe Fwomajé, puis plus récemment, les conceptualisations et les confrontations animées par Monchoachi et Alen Légarès, à travers le pitt et la revue Lakouzémi, me semblent actuellement, les relais les plus féconds de la perspective existentielles des vieux-nègres historiques… Le mouvement identitaire Rastafari relaie également la perspective des vieux-nègres par son affiliation discursive aux complexes historiques du marronnage et de l’éthiopisme. Le marronnage ne doit pas être considéré comme relevant exclusivement de la période esclavagiste, mais comme une structure discursive, une trace, composante à part entière du système discursif antillais ; à ce titre, confrontée à la métamorphose permanente des différentes ethnicités cofondatrices (le Maître blanc de l’habitation, le vieux-blanc de la ville, la classe intermédiaires des Mulâtres en col blanc, le vieux-nègre invisible, le nègre à talent des bourgs et le commandeur des hauteurs, le nègre de champ mutant en nègre des villes, l’Indien silencieux et persécuté, plus marginalement les Orientaux commerçants et les Métros de passage). Sans compter que la nature d’un discours-souche est de capillariser en arborescences infinies… Le marronnage des petites îles Caraïbes ne bénéficie d’aucune profondeur stratégique pour imposer aux Puissances européennes (comme ce fut, a contrario, le cas au Brésil, dans les Guyanes ou en Jamaïque) la reconnaissance d’une organisation culturelle et politique collective, autonome. Les marrons des petites Antilles sont toujours restés dans une proximité de nécessité avec l’habitation. C’est pourquoi il est nécessaire de considérer 5 Jacques Petitjean-Roget, Le Gaoulé, Société d’histoire de la Martinique 9
- 10. que la présence du nègre marron « joue » historiquement au sein même de l’habitation, et non pas exclusivement dans l’imaginaire d’une impossible autarcie collective dans les mornes (voire le personnage de Gani, dans Mahagony d’E. Glissant). Le discours du marronnage, qui refuse la créolisation et l’effacement de la mémoire africaine, s’est maintenu jusqu’à Marny, la Panthère Noire, dernier des nègres marrons historiques et premier « bad boy » de notre modernité départementale… Face aux accusations néocoloniales de nos élites, de n’être qu’une importation jamaïcaine vide de contenus, j’ai analysé le discours des Rastafari de Martinique comme une tresse de trois pratiques discursives lui préexistant, attestant de la filiation « autochtone » de son expression, et de la légitimité de son point de vue : 1°) le marronnage historique (à partir, notamment, des cas de Pierre-Just Marny et du diamantinois Médard Aribo6) ; 2°) la Négritude césairienne (envisagée comme pensée de notre modernité et comme praxis évolutionnaire de l’urbain foyalais) ; et 3°) l’éthiopisme (ou christianisme noir), courant exprimé par différentes figures prophétiques ; ainsi celles d’un Evrard Suffrin ou du mystique Baghioo (Me Jean-Louis Jeune, père de Moune de Rivel)… Haïlé Sellassie est un personnage historique. Aimé Césaire a rencontré Haïlé Sellassie à Addis Abeba, avec la direction de Présence Africaine, en 1965. Frantz Fanon, ambassadeur du FLN algérien à Accra, a rencontré Haïlé Sellassie, en 1960… La tentative d’une partie des élites martiniquaises de disqualifier le discours Rastafari en ridiculisant la personnalité d’Haïlé Sellassie relève de la plus pure aliénation idéologique à la pensée unique « white spirit »… Nous ne tirerons pas sur l’ambulance maoïste des donneurs de leçon marxiste-léninistes, qui ont beaucoup trop à faire avec la défense de Mengistu et des pires années de l’histoire millénaire de l’Ethiopie : les 17 années de la Terreur Rouge qui menèrent aux charniers et à la guerre civile. La perspective nationaliste nous interpelle également, du point de vue de la leçon éthiopienne : en brisant l’unité panafricaine et culturelle, en renvoyant chaque ethnie à son ultra-nationalisme chauvin, en reniant la ferme diplomatie impériale face à la stratégie occidentale d’ériger à son profit des nationalismes opportuns (comme se fut le cas en Erythrée, à Djibouti, à Mayotte ou au Katanga sous Lumumba), l’idéologie ethniquement orientée du nationalisme a manifesté sa puissance de nuisance dans le conflit qui continue d’opposer l’Ethiopie à l’Erythrée. Des milliard de dollars envolés pour la souveraineté d’arpents de sable et de roches… Deux des pays les plus pauvres de la planète, parlant la même langue, partageant la même histoire et les mêmes lignées familiales, s’affrontent dans la fureur sacrée des frères ennemis… Rastafari n’est pas nationaliste, il est panafricain. Il recherche l’Unité de l’Afrique comme fondement d’une nouvelle phase de l’humanité. Rastafari ne croit pas au nationalisme insulaire, il est caribéen (le panafricanisme est né dans la Caraïbe). Il est pour un Etat caribéen, non pour la parodie de coûteux gouvernements de poche, véritable racket organisé au profit des classes intermédiaires, prolongements discursifs des Mulâtres d’avant-guerre. Le choix du Ras Tafari Makonnen, il y a près d’un siècle, de promouvoir une occidentalisation adaptée pour l’empire dont il assurait la Régence, répond à une problématique qui reste, ici, sans réponse. Certains idéologues, adversaires de la négritude, ont cru pouvoir reprendre la propagande fasciste du « potentat cupide, exploitant son peuple jusqu’à la famine pour nourrir ses lions de viandes fraîches »… L’autobiographie de Nelson Mandela exprime une toute autre appréciation du rôle de l’Empereur dans l’organisation panafricaine de la résistance armée au colonialisme et à l’apartheid… En fait, cette défense des élites sur le front de la « vérité historique » (notamment de la part des « maîtres » de l’institution scolaire, co-animateurs de l’« échec scolaire »), s’est prolongée parallèlement sur deux autres fronts de l’ordre postcolonial, autour de l’interdit ethnique du cannabis : celui de la mise en délinquance d’une frange importante des la jeunesse (avec l’institution judiciaire importée et la police) ; et celui du diagnostic de « folie », socialement porté sur tout ce qui déborde la raison laïque (avec l’ordre médical hérité de Vichy, la Famille et l’institution asilaire). Ainsi justifiée de toutes parts, l’unanimité persécutrice s’est déployée avec application à partir des événements de contestation urbaine d’avril à juillet 1979, puis de l’affaire Niki (1981), qui liquida les derniers relents marrons du souvenir de Marny pour plonger le pays dans la traque xénophobe, et expulser le « rasta » semeur d’herbes, comme alien à cette société. Cette victimisation spectaculaire, dramatisée par la 6 Voir sur le cas de Médard Aribo l’essai de Richard Price, Le bagnard et le colonel, PUF, coll. Ethnologies, 2000 10
- 11. rhétorique reggae des dreadlocks de la rue, authentifié d’un nom révélé (« Jah », que les marrons pratiquaient dans l’échange : (cri) « Abobo ! » / (répons) « Dia ! ») conféra à la figure du « rasta » la valeur discursive de l’ « exclu passionné », du rebelle qui rejette l’asservissement commun et paie parce qu’il pose les questions centrales que les élites, européocentrées et marginalement intéressée à la gestion du au Système, refusent de considérer parce qu’attentatoires à leur conception de l’identité et de l’Ordre (la terre et le droit du sol, la sagesse de la décroissance par la créativité culturelle et l’équilibre environnemental, la justice sociale et l’idéal de la méritocratie face à la corruption des préférences organisées, l’africaphobie des élites découlant directement de leur négrophobie, la ressource de la perspective caraïbe face à la morbidité de l’européocentrisme etc.) La figure du rasta concentre une convergence de problématiques cruciales, qui s’affirment dans le contexte d’une évolution politique et sociétale. Après quarante ans de blocage, l’accession au pouvoir du socialiste François Mitterrand offre à la Martinique la timide avancée des lois de décentralisation… Dans ce passage où pour le pays rien n’est clair, où les vieux équilibres seront remis en cause, où certains crient « au loup ! », dans cet entre-deux du début des années 1980, la vieille Martinique, avec ses relents provinciaux et son manque d’ambition, va manifester de sérieuses lézardes. Et voir sa jeunesse lui échapper, quant à la possibilité à saisir d’un projet à partager. Cette fracture générationnelle minera l’unité nécessaire au décollage, et sera le véritablement fondement de l’échec de la vision engagée par Camille Darsières, qui dans la tempête (Air Martinique, Semair, institutions culturelles etc.) ne fut soutenu d’aucune espérance populaire… Durant cette phase, la figure du rasta parvient à rassembler sur son dos toute une martinicanité politiquement correcte, couvrant l’île de Rivière-Pilote au Marigot en passant par le Morne-Rouge. L’unanimité persécutrice anti rasta, mise en place avec le soutien de leaders politiques opportunistes, renforce en fait l’attractivité symbolique et les modalités discursives des frères. Plus l’injustice de leur exclusion est comptabilisée par la jeunesse en panne d’intégration, plus il, devient possible qu’une masse sensible s’identifie à Bob Marley ou à Peter Tosh. Rastafari n’ignore rien de la stratégie victimaire qu’on lui impose, elle correspond parfaitement aux enseignements messianiques de Sa Majesté Impériale et de la Bible… Cette stratégie victimaire traversa la structure familiale martiniquaise de part en part du pays, stigmatisant l’inadéquation des modes de régulation hérités de l’habitation face à la bétonisation stérile des générations urbaines. La montée exponentielle de la crise générationnelle (que la menace du balata n’a pas stoppée) est l’expression majeure de l’incapacité martiniquaise à s’inventer un avenir collectif à partir des ressources de son patrimoine, de son environnement et de l’énergie de sa jeunesse. L’unanimité persécutrice anti-rasta s’est lézardée sous le poids de deux facteurs, essentiellement : l’irruption de la roche (le crack) dans les ghettos de la Caraïbe (1983-1985), qui relativisa dans nombre de familles affectées le crime des rastas d’avoir introduit et justifié l’herbe dans le pays; mais surtout, et de manière plus profonde, la résistance d’une partie éclairée des élites qui (tout en gardant ses réserves quant à l’appréciation de la divinité du Négus), proclama le droit à l’expression des différences et tint un discours alternatif sur le corps, l’esthétique et l’éthique, la santé, le végétarisme, la spiritualité. Il me faut ici saluer la mémoire de Théo Tally qui, un des tous premiers, organisa à la PJJ (sous la suspicion de sa hiérarchie) un groupe de travail qui initia un partage respectueux (V. Permal, J. Corentin, F-L Fanon-Rojas, N. Nelzy etc.) De telles initiatives, soutenues par la proximité affichée de grands noms de la Culture (Mona, Joby Bernabé, le populaire animateur radio Albè Ti-Sirè etc.) cassa l’unanimisme anti-rasta, personne n’ayant pu véritablement « prouver » qu’un Rastafari était un bad boy… Il s’avéra bientôt que les rastas ne fumaient pas la moitié de l’herbe consommée localement, cette pratique étant devenu un trait culturel de toutes les mangroves urbaines de la Caraïbe. C’est un trait partagé qui atteste notre ancrage dans l’environnement archipel (a l’opposé de l’européocentrisme dominant). Aujourd’hui un grand nombre de personnalités médiatiques non rasta, ou de simples quidams, arbore des locks tout à fait « laïques », qui mesurent la nette évolution de la conscience ethnique semée par Rastafari au sein des représentations culturelles… L’unanimité violente s’est, depuis la tolérance marginale du Rastafari (qui est maintenant distingué du bad boy), réorientée – en apparence – contre les djonmpis et autres SDF hantant les trottoirs de nos en-villes de leur nudité crasseuse. En fait c’est la jeunesse et la fracture générationnelle qui persiste à miner le pays. Le rejet et la 11
- 12. crainte des jeunes s’est opacifiée et massifiée, au fur et à mesure que s’affirmait les caractères individualistes et consuméristes de la modernité postcoloniale. L’architecture s’est hérissée de grilles, de fers forgés et de barbelés ; l’espace public urbain s’est dénudé de tout confort pour décourager la présence indésirable ; un repenti, labellisé ONG canadienne et financé par des commerçants, exhibe le scalp des victimes de ses expéditions « humanitaires » tandis qu’il les nettoie au Karcher… La crise de la société martiniquaise, révélée par les événements de février-mars 2009, se déploie dans tous les horizons d’une mutation sans direction. Le fait que cette crise s’alimente, en partie, d’une crise mondiale plus globale, en brouille davantage les perspectives. Nul ne saurait, ne pourrait, du tenant d’une seule parole, dire la complexité et le chaotique qui nous gouvernent sous la loi des « marchés ». J’ai pourtant trouvé dans l’œuvre de René Girard ce supplément d’ « âme savante » qui arme pour la compréhension des grands vidés, des grands déboulés indignés de la crise mondiale. Cette force que j’ai trouvée dans l’œuvre de Girard (et qui ne s’est imposée que dans une seconde approche de l’œuvre), cette dimension qui outrepasse l’excellence académique pour ouvrir la connaissance sur l’être et sur l’étant, c’est précisément ce sur quoi l’analyse critique concentre sa fatwa d’hérésie, pour plonger l’œuvre de Girard dans la suspicion : à savoir, sa lecture révolutionnaire (quoiqu’en tout point académique) du texte des évangiles. Tout au long de cet essai, je développerai un certain nombre des thèmes liés à la thèse sacrificielle de Girard ; je ne me situe ici pas en exégète mais en agitateur provoquant la rencontre, l’échange et la proposition. L’intérêt fondamental des thèses de cet auteur réside, selon moi, dans l’articulation argumentée des thèmes du « mimétisme » et de la « violence », au double niveau psychanalytique et anthropologique. Cette question du mimétisme hante la recherche antillaise, comme l’envers, la face inversée d’une identité malheureuse, fondée dans la persécution de la différence. Je suis particulièrement sensible à la convergence des thèses de Girard sur le mimétisme avec les développements de Durkheim sur l’état social d’anomie. L’état d’anomie (littéralement « société sans normes ») est analysé par Durkheim comme un état transitoire résultant d’une crise sociale majeure (dépression générale ou brusque accroissement de richesses) qui affaiblit toute norme dans une indifférenciation généralisée qui figure le Chaos, dans l’attente ordalique du réamorçage d’un ordre nouveau, générateur de meilleurs équilibres différenciateurs. Dans cet entre-deux sans perspective, les individus sont fragilisés dans leurs certitudes habituelles ; les références sont ambivalentes ; les trajectoires familiales, professionnelles, affectives deviennent aléatoires. L’espace public est de plus en plus sécurisé, pour un résultat sans cesse plus décevant face au défoulement des appétits non régulés… C’’est la loi du plus fort de la jungle urbaine bientôt submergée de violences barbares et de pogroms réparateurs (Rat race ina Concrete jungle, dirait Marley) … Mais (pour en revenir à ma situation initiale d’intervenant frustré), à quoi me servent ces magnifiques analyses, ces projections intellectuelles, si elles n’affectent ma vie que « théoriquement » et si je ne puis en dégager aucune perspective opératoire ? Comment envisager la lutte contre l’esclavage mental et la question de la décolonisation caribéenne sans se confronter à la question de la violence ? Cette question est au centre de la pensée antillaise, au centre des œuvres de Césaire, de Fanon et de Glissant. Cette question taraude d’autant plus qu’elle subit l’échec triste et naïf, le tabou tragique hérité de la tentative avortée de l’ARC, dans les années 70… Cette question de la violence légitime traverse également les différents courants qui animent le « Mouvement » Rastafari dans la Caraïbe, et l’obédience à laquelle j’appartiens (La Foi Orthodoxe Ethiopienne, qui n’est pas l’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie, basée à Saint-Martin) eut à mener de rudes confrontations à travers les îles sur les stratégies à privilégier, notamment face à l’ordre guerrier originaire de Jamaïque qui prône le mot d’ordre de « Mort aux oppresseurs noirs et blancs »… Dans notre organisation, nous considérons la Livity Nyahbingi comme une guideline de la vie quotidienne. Une culture. Non un culte. Notre culte est spirituel ; il est fondé sur une promesse, sur une révélation et sur une manifestation. La Foi Orthodoxe qui nous anime a été semée dans les temps historiques par l’eunuque éthiopien dont le comportement est rapporté dans les Actes des Apôtres( 8:26- 38). Une des principales pierres d’achoppement qui traverse la communauté des croyants porte sur la validité de la Bible et des Evangiles, accusés de falsification et d’instrumentalisation au service de la pwofitasyon coloniale. Le terme « Jésus-Christ », rapproché du 12
- 13. nom du premier navire négrier abordant la Jamaïque (le « Jesus of Lübeck »), est référé à une idole démoniaque qualifiée de « battyman » (« pédé ») dont la croix sanglante exprime un culte vampirique de la mort. Au cours de nos « reasonnings », j’ai approuvé, pour l’essentiel, cette version ; la rapprochant des interdits papaux frappant la lecture et la traduction de la Bible par les peuple asservis ; soulignant que l’Eglise reconnaît forcément avoir traduit le nom original du Messie historique (et qui donc ne s’est jamais appelé « Jésus » !) ; proclamant ma certitude dans l’impossibilité anthropologique d’un Christ blond aux yeux bleus… Cependant, dans un des ses discours les plus prophétiques (repris par Bob Marley dans son titre War) Haïlé Sellassie, tout en légitimant le recours à la violence légitime de la Résistance panafricaine (we, African, will fight if necessary…), fixa un terme à cette légitimité de la violence libératrice : l’avènement d’une société de justice sur l’ensemble de la planète (jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de citoyen de seconde catégorie dans aucune nation… jusqu’à ce que la couleur de la peau d’un homme n’aie pas plus d’importance que la couleur de ses yeux… Jusqu’à ce jour, ce sera la Guerre, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest…) Par sa position de héraut de la cause des peuples opprimés (position qu’il incarna publiquement en 1936, à la tribune de la SDN, à Genève) et la dimension du Paraclet promis de l’espérance messianique que lui reconnurent les sans-voix de la diaspora africaine mondiale, la personnalité du Roi des rois oint (c’est-à-dire littéralement : massiah, messie, christ), descendant de David et de Salomon, convoque forcément le texte biblique, de l’Ancien Testament aux Evangiles… L’organisation de la papauté, et de ses déclinaisons protestantes américaines, sont très certainement d’obédiences sataniques (Satan étant L’Accusateur), mais cela n’enlève strictement rien à la valeur testamentaire de la plus ancienne mémoire du monde à laquelle nous ayons couramment accès, mémoire dont l’origine plonge dans les antiquités de l’Egypte Kemitique et de la Babylone des Nemrod Kushitiques… De manière plus pragmatique, le message évangélique est porteur d’une dénonciation qui outrepasse l’inquisition papale, pour englober dans sa condamnation tous les porteurs de violence : ceux qui – aujourd’hui encore – persécutent le Christ-Roi de la Tribu de Juda au nom d’une version empruntée de l’histoire… Mais aussi ceux qui persévèrent à « voter » pour le chef résistant des Talibans du talion, Bar Abbas le terroriste, au nom d’une vision chauvine et totalitaire de la libération nationale. De telles pulsions collectives peuvent justifier le châtiment du « balata » dans la désignation unanime du pharmakos à expulser… Ma foi christique est fondamentalement différente de celle revendiquée par la chrétienté occidentale car, s’il a refusé de leur retourner ce qui aurait pu être sa violence légitime, le Christ auquel je crois n’a jamais consenti à sanctifier l’injustice, n’a jamais cessé de dénoncer la cruauté et la corruption de ses accusateurs… Que dit le grand prêtre aux conjurés du rituel sacrificiel ? « Vous n’y entendez rien. Vous ne songez même pas qu’il est de votre intérêt qu’un seul homme meurt pour le peuple et que la nation ne périsse pas toute entière » (Jn 11:50) Je crois que tous ceux qui affirment que « Christ a donné son sang (a pris l’initiative de) pour nous sauver de nos péchés », tous ceux-là qui perpétuent l’accusation en hérésie, les rituels sanglants et la mortification, participent de la foule persécutrice éternelle. Je crois que le message christique dénonce notre propre participation quotidienne au lynchage victimaire, et que le Christ est précisément la seule victime émissaire de toute l’archéologie littéraire qui dénonce la violence sacrificielle et propose une stratégie pour éteindre l’incendie de la violence réciproque des frères humains : Aime ton prochain comme toi-même. Eteint la vengeance. Renonce au « bénéfice » de la loi du Talion… Dans l’œuvre de René Girard j’ai puisé un profond soutien intellectuel à mes propres conclusions sur la permanence des structures persécutrices de la société antillaise. Il serait injuste de voir en Girard un défenseur de l’Eglise ou un mystique en mission. Son exégèse évangélique ne postule aucun a priori de l’ordre de la foi, mais s’élabore à partir d’une perspective psychanalytique et anthropologique tout à fait « athéologique » (comme dirait Françoise Proust de Walter Benjamin7). Il faut avouer que si cette œuvre dérange c’est, qu’au moment tendu où toutes les autorités religieuses et politiques sacrifient à l’unanimisme œcuménique de la relativité absolue (chacun maître chez soi à Kyoto ou au G20), revoilà une prétention transcendante de la raison chrétienne venue d’Occident! Or il faut le dire, chez Girard l’analyse de la manière dont la mythologie chrétienne « travaille » nos quotidiens 7 Françoise Proust, Walter Benjamin et la théologie de la modernité, in Archives des sciences sociales des religions, n°89, 1995 13
- 14. saturés de violence, n’ignore rien de la réalité génocidaire de la mondialisation idéologique judéo-chrétienne, ni des manifestations de la violence urbaine contemporaine. Mais il souligne, en retour, combien l’usage persécuteur de la passion christique était anticipé dans le texte évangélique. Cette lecture magistrale, qui établit la terrible singularité de l’Evangile vis-à-vis de la violence victimaire, lecture stigmatisée, hystériquement taxée d’ambitions prosélytes, propagandistes et catéchistes, doit, urgemment, être soumise à l’examen rigoureux de la réflexion collective. Il n’y aura d’échec pour l’intellectuel organique antillais que dans le renoncement paré de certitudes… Mais avant de confronter les propositions de Girard à la pensée antillaise, j’aimerais convoquer l’écho de son plaidoyer, comme une invite (ou un aperçu disait-on), comme un challenge à nos prétentions : L’esprit scientifique ne peut pas être premier. Il suppose un renoncement à la vieille préférence pour la causalité magico-persécutrice si bien définie par nos ethnologues. Aux causes naturelles, lointaines et inaccessibles, l’humanité a toujours préféré les causes significatives sous le rapport social, et qui admettent une intervention corrective, autrement dit les victimes. Pour orienter les hommes vers l’exploration patientes des causes naturelles, il faut d’abord les détourner de leurs victimes et comment peut-on les détourner de leurs victimes sinon en leur montrant que les persécuteurs haïssent sans cause et sans résultat appréciable, désormais ? Pour opérer ce miracle, non pas chez quelques individus exceptionnels comme en Grèce, mais à l’échelle de vastes populations, il faut l’extraordinaire combinaison de facteurs intellectuels, moraux et religieux qu’apporte le texte évangélique. Ce n’est pas parce que les hommes ont inventé la science qu’ils ont cessé de chasser les sorcières, c’est parce qu’ils ont arrêté de chasser les sorcières qu’ils ont inventé la science… J’ai essayé de montrer que beaucoup de choses dans notre monde sont déterminées par le coup d’arrêt porté au déchiffrement de la représentation persécutrice. Depuis des siècles nous en lisons certaines, et nous ne lisons pas les autres. Notre pouvoir démystificateur ne s’étend pas au-delà du domaine qu’il définit lui-même comme historique (…) Nous essayons de protéger le mythe de l’humanisme occidental, le mythe rousseauesque de bonté naturelle et primitive de l’homme. Déchiffrer la mythologie, découvrir le rôle des « boucs émissaires » dans tout ordre culturel, résoudre l’énigme du religieux primitif, c’est forcément préparer le retour en force de la révélation évangélique et biblique. A partir du moment où nous comprenons vraiment les mythes, nous ne pouvons plus prendre l’Evangile pour un autre mythe, puisque c’est lui qui nous les fait comprendre. Etant bâti sur la représentation persécutrice, le monde forcément ne croit pas en Jésus, ou il y croit mal (…) Aucun système de pensée ne peut vraiment penser la pensée capable de le détruire. Toute notre résistance est dirigée contre cette lumière qui nous menace. Toute violence désormais révèle ce que révèle la passion du Christ, la genèse imbéciles des idoles sanglantes, de tous les faux dieux des religions, des politiques et des idéologies. Les meurtriers n’en pensent pas moins que leurs sacrifices sont méritoires. Eux non plus ne savent pas ce qu’ils font et nous devons leur pardonner. L’heure est venue de nous pardonner les uns les autres. Si nous attendons encore, nous n’aurons plus le temps. René Girard, Le bouc émissaire (1982) 14
- 15. III. La logique sacrificielle dans les discours antillais (Césaire, Fanon, Glissant) La victime est toujours divinisée après qu’elle a été sacrifiée : le mythe est donc le mensonge qui dissimule le lynchage fondateur, qui nous parle de dieux mais jamais des victimes que ces dieux ont été. R. GIRARD, Achever Clauswitz Je pose que la logique sacrificielle et la violence persécutrice ont constitué la colonne vertébrale renforcée de l’organisation psycho-anthropologique des sociétés issues de l’esclavage et de la colonisation aux Antilles françaises. Je propose d’explorer cette hypothèse en traçant et en inventoriant la thématique victimaire au sein d’un corpus majeur, produit du triptyque fondateur de la pensée antillaise : Aimé Césaire (Et les chiens se taisaient, 1946) / Ibrahim F. Fanon (Les damnés de la terre, 1961) / Edouard Glissant (Le discours antillais, 1981)… L’arbitraire d’une telle découpe est discutable, non sa pesanteur intellectuelle sur l’affirmation identitaire de nos pays, ni l’universalité des problématiques culturelles qu’elle articule. Trois ans après Césaire, et un demi-siècle après Fanon, Edouard Glissant a franchi le seuil de nos mémoires, refermant après lui le cycle du surgissement de notre parole blessée à la face du monde, le cycle des Maîtres de nos consciences non sevrées. Il nous appartient désormais de hisser l’aube au « grand midi » de nos idéaux et de nos rendez-vous ordaliques… 1. Césaire, ou la permanence de l’identité tragique The apocalypse in Cesairian drama revives in symbolism and movement the apocryphal scenario familiar to Westerners in the Revelation of Saint John. Here in Césaire, we find again revelation, through visions, of things to come, the prophecies, heralds, signs of disasters, symbols of evil pestilence, stain, plagues, and transgression of taboos. Here again are the divine horses, the horror of the Beasts whose unholy scourge upon the land finally dissolve into chaos and is eradicated by the cathartic fury of lightning and fire. Marianne Wichmann Bailey The ritual theater of Aimé Césaire Homme, prend garde, le feu est un langage qui demande à courir Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient Aimé Césaire conclut en ces termes ce que je considère être son texte politique fondateur (Panorama, publié dans la revue Tropiques en février 1944): Et c’est le sang de ce pays qui statuera en dernier ressort. Et ce sang a ses tolérances et ses intolérances, ses patiences et ses impatiences, ses résignations et ses brutalités, ses caprices et ses longanimités, ses calmes et ses tempêtes, ses bonaces et ses tourbillons. Et c’est lui qui en définitive, agira Ce sang là ne vote pas. Ce sang là revigore ou étrangle. 15
- 16. Ce sang qui agit, rétif à la rhétorique des notables, ce sang ambivalent, qui revigore ou étrangle « en dernier ressort », et qui oscille dans la bipolarité des états humains de la violence, ce sang doué de vie comme un être de sang, n’est pas sang humain. C’est le sang de ce pays. L’art et la matière du poète sont dans la portée des passerelles qu’il jette par-dessus nos émotions les plus secrètes. Ce que Césaire évoque dans cette conclusion poétique à un texte politique prophétique (où il annonce son renoncement à l’idée d’indépendance), c’est que toute politique se trouve asservie à la logique sacrificielle. Non seulement il n’y a pas de renouveau sans Apocalypse, mais c’est de la mort même qu’émerge la vie. La pulsion violente qui exprime le sang de ce pays, porte le rapport social à son point d’incandescence maximum, là où la vie et la mort se rejoignent et se superposent comme les deux faces d’une même pièce. Ce qui est la définition même du symbole. Chez Césaire l’homme-symbole par excellence, par son ambivalence, sa double appartenance et ses capacités de retournement, c’est le héros sacrifié, le bouc émissaire royal dont l’archétype est Œdipe, roi de Thèbes. Nul ne s’étonnera donc que chez Césaire ce soit la tragédie (et non l’essai ou le roman, comme chez Fanon et Glissant) qui prolonge la poésie. L’étymologie grecque de « tragédie » se décompose en « oidè » : chant, et « tragos » : « le sacrifice du bouc ». Littéralement, la tragédie est donc « le chant du bouc émissaire ». La tragédie est l’évolution politique d’une forme rituelle du culte de Dionysos. Le fait que, chez Césaire, la tragédie prolonge la poésie est physiquement signalé par le choix éditorial qui place la matrice tragique césairienne (Et les chiens se taisaient) au final du premier recueil de poésie publié par lui à la Libération, Les armes miraculeuses (1946). La structure de Et les chiens se taisaient est dominée par les Archétypes. C’est la seule pièce de Césaire où ni les personnages, ni les lieux ne sont nommés ; où l’arrière-fond historique est à la fois omniprésent et évanescent. Une tempête, qui présente également une forte structure archétypale, constitue à nos yeux une étape intermédiaire vers une matière plus historique qui dominera dans La tragédie du roi Christophe et dans Une saison au Congo. Au sein du corpus tragique césairien, Et les chiens se taisaient constitue une matrice dans laquelle l’ensemble de l’œuvre viendra se mouler comme la redondance cyclique (des Conquistadores à Lumumba en passant par les Jacobins Noirs d’Haïti) de la même structure historique qui voit un ordre nouveau poindre et bégayer, entre la contamination de l’ancien monde et la révolution solaire radicale. La prégnance de la logique sacrificielle chez Césaire s’exprime à travers la perspective messianique qui structure, non seulement sa dramaturgie, mais l’ensemble de son intention poétique. Rapprochant, du point de vue de ce messianisme, l’œuvre de Césaire de celle du philosophe allemand Walter Benjamin j’écrivais par ailleurs8 : Pour Césaire comme pour Benjamin, le messianisme n'est pas un futurisme; ce n'est pas une projection spéculative sur l'à venir. Passé comme avenir ne sont que des figures, des spectres déterminés par le présent. (…). Ce n'est qu'aujourd'hui que le futur peut changer. Seul compte le présent, l'à-présent, comme disent Benjamin et la langue créole. Dans son essai testamentaire publié à titre posthume en 1942, Sur le concept d’histoire (1940), Benjamin introduit ainsi sa conception du messianisme : … il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est juste de ne point la repousser. (Thèse II) À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Car le messie ne vient pas seulement comme rédempteur ; il vient comme vainqueur de l’antéchrist. Le don d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance n’appartient qu’à l’historiographe intimement persuadé que, si l’ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de triompher. (Thèse VI) 8 Ali Babar KENJAH, L’à-présent sismique des villes. Exploration des passages urbains entre A. Césaire et W. Benjamin, contribution aux Journées Mondiales de l’Urbanisme GIP-GPV, Fort-de-France, novembre 2010, 16
- 17. Le sujet de la connaissance historique est la classe combattante, la classe opprimée elle-même. Elle apparaît chez Marx comme la dernière classe asservie, la classe vengeresse qui, au nom de générations de vaincus, mène à son terme l’œuvre de libération (…) À cette école (du compromis social-démocrate, NdA), la classe ouvrière désapprit tout ensemble la haine et l’esprit de sacrifice. Car l’une et l’autre se nourrissent de l’image des ancêtres asservis, non de l’idéal d’une descendance affranchie. (Thèse XII) L’histoire des damnés de la terre souffre de l’illusion du Progrès. L’histoire n’est que répétition du même cycle de violence. Fanon écrira : « Le peuple vérifie que la vie est un combat interminable »9… L’issue ne peut venir de l’idéologie mais de l’embrasement à la fois imprévisible et inévitable. Les hommes, violentés par la domination éternelle, entretiennent de générations en générations la même espérance éternelle d’un retournement du réel. C’est le mystère de ce retournement et la fascination de son énergie, la violence sacrée, qu’explore l’expérience psychanalytique, sociale, religieuse et politique de la Tragédie. La tragédie césairienne est une actualisation de la tragédie grecque (et de la tragédie shakespearienne qui s’y rattache). Elle introduit le point de vue oblitéré des opprimés dans la tension historique de leur accession au Pouvoir, mais en maintenant la permanence de la perspective tragique. Sa matrice reprend la structure même de la logique sacrificielle mise en scène par Sophocle autour du drame d’Œdipe roi. Tous les éléments de la crise sacrificielle repérés par Girard y sont, mais nous n’examinerons ici que deux d’entre eux : la crise mimétique et le sacrifice du héros dionysiaque… a) la crise mimétique, qui abolit les différences dans la contamination de la violence généralisée, éclate dans l’unanimité des retournements de la foule, approuvant et condamnant tour à tour le Rebelle. L’indifférenciation, qui réduit le réel au manichéisme de la violence réciproque, s’exprime par la voix des « énergumènes » qui illustrent les propos de Girard : « Comme dans la tragédie grecque donc, comme dans la religion primitive, ce n’est pas la différence, mais bien sa perte qui cause la confusion violente. » (Vs, p. 81). Les énergumènes profitent du chaos et s’opposent à toute résolution de la crise (par l’instauration d’un nouvel ordre différenciateur), au nom d’une égalité de boutiquiers, au nom de la mêmeté… PREMIER ÉNERGUMÈNE : Pas de silence qui vaille. Nous sommes libres et égaux en droit. N’oubliez pas cela DEUXIEME ÉNERGUMÈNE : Et moi je dis : malheur à ceux qui n’ont pas lu inscrit sur le mur de nos honorables faces délicotées le Mane Thecel Phares de la tyrannie. Et voici, je sais des têtes qui rouleront comme des cabosses de cacao : mort aux blancs LE CHŒUR D’ÉNERGUMÈNES : Mort aux blancs, mort aux blancs. Echos répercutants, vociférations et chants. Le vide et le silence retombent, lourds. Aux vociférations la violence légitime et de la crise mimétique (où la tyrannie joue du miroir entre les uns et les autres), succèdent un vide et un silence « lourds » de sens. Comment mieux signifier et anticiper cette « détente assurément cathartique qui résulte du sacrifice » (Girard, Vs, p. 148) ? La dissolution des différences dans le mimétisme violent est un ressort fondamental de la crise sociale dérapant en chaos anomique. Cette agressivité en miroir convoque les archétypes des « frères ennemis » et du « double monstrueux » comme figures d’une mimésis antagoniste, d’une violence dirigée aveuglément contre soi-même (ce soi-même renvoyant à l’homogénéité première de la société, unité perdue de vue par l’hubris vengeresse). Et le poète volcanique ne cesse de dénoncer les illusions d’une certaine violence « révolutionnaire » qui n’est que l’ombre de la maïeutique libératrice ; parodie héritée des rituels traditionnels, où l’ancien se survit à lui-même et échappe au véritable retournement du temps. 9 Frantz Fanon, Les damnés de la terre, éditions F. Maspero - La Découverte, 1961, p. 66 17
- 18. Loin, très loin, dans un lointain historique le chœur mimant une scène de révolution nègre, chants monotones et sauvages, piétinements confus, coutelas et piques, un nègre grotesque, le speaker gesticule. Le tout sinistre et bouffon, plein d’emphase et de cruauté Le Carnaval offre l’exemple d’une soupape de décompression essentielle à la pérennité sociétale. Nous verrons que la ritualisation opère à se concilier la violence ; elle ne l’élimine pas, elle tente de cohabiter et de contenir sa contagion mortelle. L’efficacité de la violence ritualisée est relative ; elle peut échouer à apaiser les tensions et déraper en incendie incontrôlable ; et s’étendre jusqu’à trouver la victime expiatoire adéquate, non plus de substitution mais de refondation. La violence mise en scène par la résolution tragique déborde du rituel premier, conservateur, pour envisager au contraire une Apocalypse, une rupture du cercle clos de la répétition, une issue ouvrant sur la refondation nécessaire. Là où le rituel est forclos, la tragédie est messianique. La description par Césaire de cette violence rituelle traditionnelle, marquée par la circularité fonctionnelle, s’oppose à la violence messianique, au « coup de dés » ordalique qu’évoque G. Suréna10, caractérisé – dès lors que « les jeux sont faits » – par le dévoilement, la révélation assumée dans l’à-présent qui impose son arbitraire. La ritualisation vise à renouveler le pacte avec une divinité connue, tandis que la violence sacrificielle cherche son issue dans l’oracle d’une divination insue. Il n’y a qu’une seule violence, omniprésente, mais plus d’un stratagème pour la nier, la détourner, la transcender ou la regarder en face… b) Le héros dionysiaque et son double. Homme marassa, homme double, ambivalent, Grand Ambigu, telles sont les figures sous lesquelles se présente le héros césairien. A la fois libérateur solaire adoré et monstre nocturne honni. A l’image d’Œdipe, « roi debout » victime d’une violence qu’il a convoitée, qui le désigne comme cause et remède (pharmakos) de la contagion sanglante, sous les accusation les plus fortement frappées de tabous : blasphème, homicide, parricide, matricide. Ce Janus nietzschéen alterne une face solaire (l’utopie politique), et un envers obscur et trouble (les métamorphoses permanentes d’un désir de violence). Une affirmation positive (au futur) et une résolution négative (passé aboli). Nous verrons que le « non » qui cofonde le héros (comme un pendant intime et féminin à la positivité virile du parricide) répond, chez Césaire, au projet morbide et incestueux de la Mère, qui n’est que désir rusé du Maître. La tragédie jette un pont entre la scène historique (où le Pouvoir est exposé) et l’intimité psychanalytique (où s’éprouvent les émotions et la vie). Ainsi parlait Zarathoustra… Les mythes sont de formidables mass médias. W. Benjamin ou S. Freud ont, parmi d’autres, reconnu la valeur opératoire de l’expérience humaine comprimée dans la mémoire mythologique. Césaire écrit avec l’ensemble de cet arrière-fond, convoqué par la faillite civilisationnelle de la Seconde Guerre Mondiale. Ses archétypes sont ceux du Politique s’affranchissant de l’ordre rituel pour fonder, à partir des mystères de la mythologie antique, la démocratie et la ville moderne. Le héros césairien articule la conscience qui se dévoile à la parole qui insémine. C’est d’ailleurs le rapprochement avec l’œuvre de Freud et la pièce de Sophocle qui permet d’identifier le maître assassiné comme étant le père du Rebelle, lui-même non pas nègre marron, comme souvent affirmé, mais « garde-chiourme commandeur » de l’habitation du béké ( « c’est toi, me dit-il, très calme… C’était moi, c’était bien moi, lui disais-je, le bon esclave, le fidèle esclave, l’esclave esclave… »). Au climax du tragos, la foule s’écrie, identifiant l'Œdipe nègre : UNE VOIX : Assassin, il a tué son maître UNE VOIX Assassin, maudit, il va tuer sa mère 10 Guillaume SURENA, Je or vent paix là. Vers mallarméen de Césaire, texte inédit communiqué par l’auteur 18
- 19. UNE VOIX A mort, à mort, crevez-lui les yeux UNE VOIX C’est ça qu’on lui crève les yeux Le destin du héros tragique césairien oscille sans cesse entre l’ombre et la lumière, entre l’ascension et la descente, entre la réprobation et l’adoration. Biface monstrueux, il cumule en lui-même toutes les différences qui alternent dans la crise mimétique. L’ambivalence, l’ambiguïté et le retournement, autant de figures du double qui caractérisent la destinée du Rebelle. « Je suis un roi qui ne possède rien (…) Je ne suis qu’un vaincu… Je ne suis qu’un coupé, donné et rejeté… », oppose-t-il à l’invocation. C’est, illustrant l’intuition théorique de Girard sur les racines sacrificielles de la royauté, son statut de victime émissaire qui, tout à la fois, le réduit aux ténèbres de son intériorité et le positionne en roi-soleil, prophète luciférien (c'est-à-dire « porteur de lumière »), héros monstrueux d’un processus émancipateur dont il est le germe offert à la terre. Il est seul à voir et à entendre l’unité profonde de la réalité sociale et humaine, l’identité des frères ennemis que nul ne saurait admettre. Seule sa parole peut désormais établir un ordre nouveau, c'est-à-dire un système signifiant de nos différences. LE REBELLE Et tu ne vois rien parmi l’herbe nouvelle… Rien dans la mer n’est-ce-pas ?... Je vois, J’entends… Je parlerai… Ligotez-moi, piétinez-moi. Assassinez-moi. Trop tard… moi aussi je suis une flamme, je suis l’heure LE CHŒUR Il est Roi… Il n’en a pas le titre, mais bien sûr qu’il est roi… un vrai Lamido… Si le héros est monstrueux (si, en vérité, il peut faire l’unanimité des frères ennemis contre lui) c’est parce qu’en lui sont présentes toutes les différences qu’on oppose, par ailleurs, religieusement. Il est monstrueux comme Janus (comme un mulâtre ou un nègre gréco-latin) car, homme marassa, à tout moment, possiblement, dans un tremblement, sa figure exprime la vérité simultanée de ses deux faces. A l’appui de cette importance, pour Césaire, de la bivalence, de l’ambivalence, essentielle du héros tragique, nous nous référons au poème « Rabordaille », publié dans le recueil Moi, laminaire (1982). L’extrait que nous citons ici présente l’intérêt de laisser affleurer le messianisme au point de nous permettre d’entrevoir l’ombre du « messie » : … alors vint un homme qui jetait comme cauris ses couleurs et faisait revivre vive la flamme des palimpsestes alors vint un homme dont la défense lisse était un masque goli et le verbe un poignard acéré alors un homme vint qui se levait contre la nuit du Temps un homme stylet un homme scalpel un homme qui opérait des taies c’était un homme qui s’était longtemps tenu entre l’hyène et le vautour au pied d’un baobab un homme vint un homme vent un homme vantail un homme portail le temps n’était pas un gringo gringalet 19
- 20. je veux dire un homme rabordaille un homme vint un homme Richesse, multiplicité et universalisme des symbolismes et des figures convoqués Mais traversons La jungle (W. Lam) pour nous concentrer sur la seule épithète dont est ici qualifié « celui qui vint », épithète finale : « je veux dire un homme rabordaille » ... Très généralement, et tout à fait correctement, ce vieux terme créole conservé en Haïti est poétiquement référé à l’expression française « à l’abordage ». Le messie césairien, qui est homme et non pas dieu, est celui qui monte à l’abordage. Mais cette lecture n’est que seconde. René Hénane précise ainsi le terme : RABORDAILLE : petit tambour cylindrique à deux peaux. Désigne aussi le rythme rapide 11 joué sur ce tambour, comme pour l’abordage. Petit tambour cylindrique à deux peaux ? Autant dire, en créole martiniquais, an tanbou dé bonda… C'est-à- dire, chez nous, l’expression emblématique qui désigne l’individu ambivalent, le « traître », dont le discours zennzole entre les positions tranchées des uns et des autres, qui – pour lui – reviennent au Même… Le héros tragique combat à démystifier les différents obsolètes entretenues par les appareils et les théologies corrompus par la violence. Ainsi que le souligne Walter Benjamin : « A chaque époque il faut arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer... »12. Le héros sacrifié est le double de tous les doubles confondus dans la masse unanime, mais il est simultanément singulier, d’une singularité absolue et fondatrice. C’est un homme… La richesse et la profondeur tragique du texte césairien vient du fait qu’il est en permanence saturé des problématiques liées à la violence sacrée œuvrant au cœur du processus révolutionnaire. Girard propose d’originer la structure anthropologique de la violence réciproque (la crise anomique de Durkheim) dans le modèle éthologique de base posé par la situation de Rivalité. C’est ce que la tragédie césairienne nous permet de vérifier, dans cette scène intense où l’intimité émotionnelle la plus profonde et l’ordre politique qui lui est invisiblement lié, se dénouent dans la césure « ombilicale » du fiat révolutionnaire : la scène où s’opposent le Fils Rebelle et sa Mère, qui articule un révélé psychanalytique à un dévoilé politique… c) Psychanalyse culturelle antillaise. Dès l’introduction du dialogue, où la Mère vient tenter d’infléchir la radicalité tragique du Rebelle, celle-ci est rejetée. Elle fait désormais partie d’un ordre rejeté. la Mère n’est plus « La » Femme, dorénavant, le Rebelle « ne parle plus qu’à la plus ivre… », « celle qui fait… que le silex est impardonnable ». La Mère est rejetée au « couchant », ce qui désigne autant la fin d’un cycle historique que sa soumission sexuelle au Maître. Elle est accusée clairement d’appartenir au camp de l’ordre oppresseur (… Et ils t’ont envoyée…) Pour sa part, la Mère ne voit que sang et violence sur la figure de son fils, tandis qu’elle-même s’exprime du point de vue de l’humanisme des Lumières (Ma race : la race humaine. Ma religion : la fraternité…) Bien sûr, le Rebelle rétorque qu’elle refuse de voir la violence première, ni l’unanimité persécutrice du lynchage, qui rend sa propre violence légitime : Et le monde ne m’épargne pas… Il n’y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui je ne sois assassiné et humilié La Mère voit en lui un possédé, pharmakos monstrueux condamné à la Passion (Dieu du ciel, délivre-le… J’ai peur de la balle de tes mots… Ce ne sont pas des mots humains… Hélas tu mourras…) Elle voit se dresser au loin le 11 René HÉNANE, Glossaire des termes rares dans l’œuvre d’Aimé Césaire, Jean-Michel Place éditeur, Paris, 2004, p. 112 12 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Thèse VI, Paris, 1942, 20
- 21. gibet et la mort sacrilège. Ce sacrilège de la perspective maternelle ne fait qu’un avec le sacré de la perspective tragique, qui est le choix assumé du Rebelle ; « Bien sûr qu’il va mourir le Rebelle » sont les premiers mots de la pièce, inscrivant d’emblée celle-ci dans la trame sacrificielle. Tout est basé sur cette certitude de la mort sacrée et de son impact sur le monde. Le Rebelle récuse l’humanisme à visières blanches de sa mère, qui ne sert qu’au « désarmement » des opprimés. Sa « religion » se prépare à l’opposé du désarmement ; la violence légitime qu’il incarne en est le carburant, il en est le fondement et la foi, « … moi avec ma révolte et mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute… » Nous dressons ainsi la comptabilité de l’histoire sur le palimpseste du roman familial de notre expérience collective. Dialogue de sourds de la violence réciproque; où la Mère porte la parole de l’ordre colonial et le Rebelle postule, par sa mort annoncée, à fonder (féconder) un ordre nouveau. Le fossé est si profond entre ces deux-là qu’on s’interroge sur son origine. De fait, il n’en a pas toujours été ainsi, et Césaire s’attache à explorer précisément le moment de la rupture existentielle en développant, sous l’exposé des faits contingents, le schéma psychanalytique de la Rivalité qui oppose le Rebelle à son Maître/Père, vis-à-vis de sa mère puis de son propre fils. Résumons. Le texte introduit suffisamment d’éléments pour m’autoriser à identifier le Maître comme le Père du Rebelle : le désir premier de la Mère, son parti pris contre son propre fils, et l’écho œdipien de la foule… il fut un temps où le Rebelle était plus qu’un esclave, c’était « un bon esclave », un « esclave esclave », ce qui compose la métaphore de l’esclave collaborateur et de l’esclavage mental. Le Rebelle n’est pas un nègre marron Africain ; c’est – à l’origine du drame – un esclave privilégié, sans doute un commandeur mulâtre, un chef d’atelier (statut dont le Maître lui fera la faveur de confirmer l’hérédité). L’ordre régnait dans sa double condition : l’ordre suprême de la possession pour le Maître et l’ordre rituel d’un culte funéraire de la « déesse mère » pour les esclaves. A ce stade (historique et psychanalytique), la soumission du Fils à l’ordre dominant implique un consentement incestueux au culte de la Mère (J’avais rêvé d’un fils pour fermer les yeux de sa mère). Le culte de la mort organisé autour de la Mère, symbole d’un certain matriarcat créole, est une stratégie coloniale de sécurité à laquelle s’oppose la Passion révolutionnaire du Fils. C’est le culte d’une « mort vivace et somptueuse » dont hérite celle qui a trahi sa race, « pour avoir trop aimé » (le Maître). Rituel d’une circularité anthropophage, incestueuse, où l’homme servile n’accèderait au sens et à la maturité que dans et par une dévotion éternelle à la Mère. La Mère créole comme figure de l’enfermement libidineux de l’Habitation ; la femme noire, gardienne des rituels – ainsi l’image de la femme poto- mitan ne peut renvoyer qu’au seul espace circulaire de l’architecture populaire de la Caraïbe (avec poto-mitan, donc) : le houmfor, le temple vaudou. La circularité du sacré matriarcal organise la violence ritualisée et la canalisation de la violence esclavagiste, au bénéfice partagé d’une gestion de l’ordre dominant13. Cette inscription de la Mère dans la répétition rituelle et la structure de l’éternel retour, enferme le Fils dans la soumission, mais résume également le cycle de la déportation, de l’esclavage et de l’arbitraire victimaire : « Il te fallait un fils trahi et vendu… Et tu m’as choisi. » En contrepoint, en faisant le choix de la Passion tragique, le Fils rompt la circularité close du culte matriarcal pour ouvrir une issue historique à l’espérance messianique. Le meurtre du Maître est impardonnable, c’est-à-dire irréversible. Seul le sang versé ouvre sur l’aube nouvelle. Le Fils, en sortant du cercle de l’indifférenciation, s’érige en singularité fécondante, véritable alien au milieu des aliénés. La violence ritualisée s’effondre, démystifiée, face au bouleversement qu’amorce l’affirmation de cette différence. Le Fils soumis tranche son cordon ombilical, la société tremble et oscille. La violence « libérée » se répand par la brèche ouverte, en quête d’une résolution introuvable. Quand la Mère s’écrie, « O mon fils mal éclos », c’est bien l’éclosion qui est référée au « mal », à la maladie et à la folie. Le consentement à l’hubris de la Passion par l’esclave modèle qui se rebelle, va chercher plus loin, plus profondément, que la simple aspiration à la liberté du Nègre Marron archétypal (idéalement un Africain fraîchement débarqué); ici le héros doit être habité des contradictions et des ambivalences de la société coloniale. Pour être 13 Voir à ce sujet Guy Cabort-Masson, Stratégies de la femme noire esclave américaine, AMEP 21
- 22. compatible avec le rôle qu’il ambitionne de jouer sur la scène tragique de la (re)fondation, pour être crédible aux yeux de toutes les différences fondatrices, et incarner le retournement qu’implique la violence sacrée, le Rebelle – à l’origine – doit être un antihéros soumis à la commune condition de l’aliénation généralisée. Un nègre créolisé. Un événement va venir rompre l’équilibre de l’ordre esclavagiste « premier »: le Fils devient père à son tour et, par ce biais mimétique, accède à une virilité, expérimente une potentialité démiurgique, qui restait jusque là l’apanage du Maître. Il devient pour son fils ce qu’il s’imagine que son Maître devrait être pour lui, et aussitôt ressentir combien ce qu’il éprouve pour son fils diffère de ce que son Maître exprime envers lui. Au moment où il reçoit confirmation de cette différence, il comprend que dans la causalité qui lie son fils au Maître, il est le seul maillon qui puisse briser ou conforter la chaîne de la filiation servile. Césaire va parfaitement décrire ce triangle ontologique de la Rivalité créole, avec le fils du Fils comme enjeu d’un désir d’à-venir, support d’un double bind déclenché par le désir du Maître. La rivalité d’où va sourdre la violence légitime est mûrie dans le triangle fondas des générations mâles, qui exclue le compromis féminin : …Il n’avait pas six mois et le maître est entré dans la case fuligineuse comme une 14 lune rousse , et il tâtait ses petits membres musclés, c’était un très bon maître, il promenait d’une caresse ses doigts gros sur son petit visage plein de fossettes. Ses yeux bleus riaient et sa bouche le taquinait de choses sucrées : ce sera une bonne pièce, dit-il en me regardant, et il disait d’autres choses aimables le maître, qu’il fallait s’y prendre très tôt, que ce n’était pas trop de vingt ans pour faire un bon chrétien et un bon esclave, bon sujet et bien dévoué, un bon garde-chiourme de commandeur, œil vif et le bras ferme. Et cet homme spéculait sur le berceau de mon fils un berceau de garde-chiourme. L’esclave possédé et dépossédé, par la proximité intime avec le « très bon maître », par contamination dirait- on, devient conscient que la dimension paternelle dont on est en train de le frustrer est, à proprement parler, son humanité. Mieux, avec la paternité lui vient une identité : celle qu’il partage (exclusivement) avec son fils. identité que le Maître (son père) lui conteste, tout en l’instrumentalisant comme lignée servile. Jusque là il a été le fruit bâtard de l’amour maternel dans le triangle complété par celle-ci et le Maître. Ce qui sous-tend que sa soumission et son statut d’esclave privilégié participent de l’effacement permanent de l’homme noir qui aurait dû être son père. Ce père nègre impossible, abandonné et humilié par la trahison de la femme créole, cet être rendu invisible par la servilité, va surgir et réapparaître au moment où on l’attendait le moins. C’est-à-dire au moment où le bon-esclave-à -sa-maman-chérie est appelé à parfaire et compléter définitivement sa soumission ontologique, en offrant/sacrifiant son propre fils au Maître/dieu tout-puissant, et par là-même renoncer à son ultime chance d’humanité. Cette ultime chance d’humanité, que pour saisir il devra féconder par un rituel de sang, c’est l’espérance messianique qu’incarne son fils. L’espérance historique d’échapper au néant du nègre soumis. Cette espérance lui appartient dès ce moment triangulaire où il entre en rivalité. Elle le pénètre d’une résolution farouche. Il sera Père (comme le Maître), à l’instar du Maître il tracera l’à-venir. Et, acceptant de faire face à la mort (la sienne et celle du Maître, confondues par la violence réciproque), il s’emparera du pouvoir de nourrir pour les siens une fondation. L’esclave subit le choix (sur la place du marché) ; le Rebelle impose son choix au destin. « J’ai choisi d’ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils »… En affirmant la permanence des enjeux du discours tragique, Césaire délie l’accession à la parole politique (décolonisation) de l’accumulation trompeuse du temps. Le Progrès n’est ni comptabilité certifiée, ni enflure sans fin. Le Progrès n’est pas à venir, il est dans le seul geste tranchant possible : celui qui perce le giron et libère du cordon autrefois nourricier… Rompre dans l’à-présent les illusions de la répétition et du mimétisme par une poétique du surgissement intérieur et l’impensé de la transgression. Si la liberté reste à conquérir, l’ombre ne pourra jamais 14 Les Kalinagos désignent le ciel où réside leur Xémi comme « la case où se tient la lune » (in J-P. Moreau, op cit. p. 183) 22