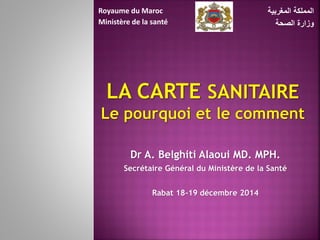
Carte sanitaire MAROC
- 1. Dr A. Belghiti Alaoui MD. MPH. Secrétaire Général du Ministère de la Santé Rabat 18-19 décembre 2014 المغربية المملكة الصحة وزارة Royaume du Maroc Ministère de la santé
- 2. Partie 1: Mise en perspective et justifications Mise en perspective de la planification de l’offre de soins au Maroc Principales justifications de la CS Objectifs et objet de la CS et du SROS Valeur de la CS Typologie de l’accès aux soins Portées de la CS Outils législatifs de la planification de l’offre de soins Partie 2: Benchmark Expérience britannique Expérience française Expérience québécoise Expérience tunisienne Partie 3: Méthodes et composantes de la CS Principes Modèle sous-jacent Composantes de la carte sanitaire Partie 4: Gouvernance et mesures d’accompagnement Organes de concertation Mesures d’accompagnement Annexe : L34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins Décret 2-14-562 relatif à l’offre de soins, à la carte sanitaire et aux SROS. Dr Belghiti/SG/MS 2
- 3. Partie 1 AVÈNEMENT DE LA CARTE SANITAIRE AU MAROC Mise en perspective et justifications Dr Belghiti/SG/MS 3
- 4. Avant 1987 Critères d’implantation des infrastructures sanitaires basés sur des normes de population Un DR pour 15 000 habitants, Un CS pour 45 000 habitants. 1981-1985 (Avènement du 1e mouvement de réforme sur les SSB) 1e plan de développement mettant en œuvre la politique des SSP 1e projet sectoriel : PDSS (Prêt BIRD) De 1987 à 1992 Mise en place du premier plan d’extension de la couverture sanitaire (PECS) Association de critères géographiques et socioéconomiques au critère de population Selon une démarche participative impliquant les autorités locales et les élus; A partir de 1992 Introduction d’un critère territorial : découpage administratif Un CSC dans chaque commune Un CSCA dans chaque chef lieu de caïdat Dr Belghiti/SG/MS 4
- 5. 1997-2003: (Avènement du 2e mouvement de réforme de santé) 1997: Etude de faisabilité sur la réforme de santé, 1998: Signature des conventions de financement des 2 projets d’appui à la réforme de santé projet d’appui à la gestion des services de santé: le PAGSS (Don UE), Projet de financement et de gestion des services de santé: le PFGSS (Prêt BIRD), Introduction auprès du SGG du 1e projet de texte règlementaire relatif à la carte sanitaire (non examiné au conseil du gouvernement). Stratégie sectorielle 1999-2003: déploiement de la première phase de la réforme (élaboration du 1e SROS à la région de l’oriental) Convention de financement CMB1 (2001) avec l’UE: Conditionnalité liée à la carte sanitaire 2011 21-7-2011 : Publication de la loi cadre 34-09 relative au Système de Santé et à l’offre de soins Réforme constitutionnelle (consécration du droit d’accès aux soins) 2014 5-11-2014 : Adoption du décret 2-14-562 relatif à l’offre de soins à la Carte Sanitaire et aux SROS Dr Belghiti/SG/MS 5
- 6. Des disparités dans l’état de santé Mesuré sur la base des écarts dans les niveaux: de mortalité et de morbidité, des facteurs de risque de santé et des déterminants sociaux de la santé Des inégalités dans la couverture sanitaire Mesurée à travers des traceurs des niveaux d’utilisation des soins préventifs, curatifs et de réhabilitation, Des déficits patents dans l’offre de soins Mesurée à travers les niveaux des ratios d’infrastructure et de ressources disponibles, Des mutations importantes dans: La dynamique de population : transition démographique et épidémiologique et/ou nutritionnelle; Environnement politique, économique et/ou social: CMB, Réforme constitutionnelle, 2e CNS, Régionalisation … Mesure d’accompagnement du projet de loi 131-13 La mise en place de la carte sanitaire est un engagement politique de longue date Dr Belghiti/SG/MS 6
- 7. En benchmark (OMS, SSM 2014) Mar Alg Tun Egy Jor RU Fra Esp USA Tha Tur Mex EVN (années) 71 72 76 71 74 81 82 82 79 75 75 76 EVS (années) 61 62 66 61 64 71 72 73 70 66 - 67 TMM (p. 100000 NV) 120 89 46 45 50 08 09 04 28 26 20 49 TMM5 (%° NV) 31 20 16 21 19 05 04 05 07 13 14 16 Entre milieux (HCP 2011) Urbain Rural Ensemble EVN (années) 77,3 71,7 74,8 TMM (p. 100000 NV) 73 148 112 TMM5 (%° NV) 25,4 35,0 31 Dr Belghiti/SG/MS 7
- 8. Des inégalités dans la couverture sanitaire Entre milieux Urbain Rural CPN 91,6 62,7 AMS 90,7 54,6 Consultations médicales pub. 0,7 0,4 En benchmark (OMS, SSM, 2014, +/- BDD/OCDE) OCDE Mar Alg Tun Egy Jor RU Fra Esp USA Tha Tur Mex Vaccination Anti-rougeole moins 1 an (%) 99 95 96 93 98 93 89 97 92 98 98 99 AMS 74 95 74 79 100 99 97 - 99 99 91 95 Césarienne 16 - 27 28 19 24,1 21 25 33 - 37 39 26,9 Consultations médicales/hab 1,7 - 2,7 - - 5,4 6,4 7,6 4,1 8,2 3 6,5 Hospitalisation ou sorties d’hop. (%) 5,6 - - - - 13,6 16, 9 10,4 12,5 14,2 5,1 15,6 Dr Belghiti/SG/MS 8
- 9. Des déficits patents dans l’offre de soins Source : OMS, SSM 2014, complétée par BDD OCDE 2013 Mar Alg Tun Egy Jor RU Fra Esp USA Tha Tur Mex Rev inter med sup OCDE Médecins /10 000 Hab. 6,27 12,1 12,2 28,3 25,6 27,9 31,8 37,0 24,5 3,9 17,1 21,0 15,5 32 Infirmiers & SF/10 000 Hab 8,9 19,5 32,8 35,2 40,5 88,3 93,0 50,8 111 20,8 24,0 25,3 25,3 88 LITS /10 000 Hab. 9,0 - 21,0 5 18,0 61,0 64,0 31,0 29,0 21,0 25,0 15,0 32 5 Scanners pmp 1,2 (7,9) - 8,9 - 5,5 8,9 9,9 13,9 40,9 6,0 14,5 3,7 - 23,6 IRM pmp 0,4 (1,4) 0,4 1,6 0,8 0,8 5,0 5,98 4,2 31,5 1,0 2,0 0,5 1,2 13,3 Dr Belghiti/SG/MS 9
- 10. Des mutations importantes Transition démographique & épidémiologique: Elargissement de l’éventail des besoins (triple charge de morbidité) et assimilation santé/qualité de vie (Espérance de vie en bonne santé); Elargissement du champ du médical vers le médico-social: Incapacités, handicap, dépendance… Réforme constitutionnelle: Accès aux soins = Droit fondamental Exigences bonne gouvernance (transparence, participation, …) Régionalisation … 2e Conférence nationale de la santé Message d’orientation de Sa Majesté le Roi aux participants, Livre Blanc, Recommandations de la 2e CNS Généralisation de la CMB (AMO/RAMED/AMI); Progrès médical et technologique croissant Dr Belghiti/SG/MS 10
- 11. Comment allouer les ressources financières: Sur quelles bases ? Techniques: Besoins, normes, priorités … Besoin de planifier avant l’allocation des ressources Juridiques : Absence de textes règlementaires de cadrage en dehors de la loi des finances Au profit de qui ? Souci d’équité dans l’allocation des ressources Avec quelles garanties ? Besoin de réguler après la mise en place des ressources La carte sanitaire est une alternative à l’improvisation Dr Belghiti/SG/MS 11
- 12. « La carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins [SROS] ont pour objet de: prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, (Rôle de planification) en vue (Rôle de régulation) de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population, de réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux et maîtriser la croissance de l'offre. » Dr Belghiti/SG/MS 12
- 13. Planifier l’offre de soins (Dimension technique) De la méthode Des faits Des analyses des projections De la cartographie Des simulations… Mission de plus en plus décentralisée Réguler le système de santé (Dimension politique) Consolider le rôle de l’État De l’aménagement du territoire, De la Redistribution des ressources selon les besoins De la maîtrise des dépenses De l’atténuation des inégalités en santé Mission de plus en plus centralisée Dr Belghiti/SG/MS 13
- 14. « I 'offre de soins comporte (art 9 L34-09), 1. outre les ressources humaines, 2. l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé 3. et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles 4. ainsi que les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. » « Le secteur public et le secteur privé, qu'il soit à but lucratif ou non, doivent être organisés de manière synergique afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre de soins et de services complémentaires, intégrés et coordonnés », Dr Belghiti/SG/MS 14
- 15. Entre une expression individuelle et collectives de besoins; Et des contraintes de ressources Dans un contexte politique et social spécifique D’où la mise en place par la loi 34-09 d’un cadre organisationnel de concertation « Pour assurer la cohérence des actions du système de santé, améliorer sa gouvernance et permettre la participation active des différents partenaires audit système, les instances [de concertation] suivantes seront instituées: … une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé; une commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins; … » Dr Belghiti/SG/MS 15
- 16. Problèmes de santé (Mortalité, Morbidité, incapacité, Risque…) Populations (Générale/Cibles/spécifi ques) Territoire (Bassin de santé, attraction, découpage…) Prestations de soins et services Infrastructures & installations Équipements Lourds De hautes technologie Professionnels de santé Quels compromis Expression de besoins Propositions de réponses La carte sanitaire est le résultat d’un compromis Contraintes de ressources!!! Dr Belghiti/SG/MS 16
- 17. Au regard des objectifs de planification Capacité de décliner les politiques publiques en matière de santé (prévention, santé rurale, encadrement médical…) Capacité de faciliter l’accès effectif de la population à un ensemble de prestations de soins et services Au regard des objectifs de régulation (consécration du rôle de l’état) Niveaux d’équité et de proximité; Complémentarité entre les secteurs d’activités; Degré de participation de la population et d’implication des parties prenantes; Impact sur la maîtrise des dépenses de santé; Contribution à l’aménagement du territoire; Au regard des objectifs de mobilisation (acceptabilité politique) Solidité des compromis (large adhésion) respect des dispositions de la CS et des SROS dans la programmation des investissements sanitaires Niveau d’actualisation des normes et critères Dr Belghiti/SG/MS 17
- 18. La correction des inégalités nécessite la résolution des questions suivantes: 1. l'identification des interventions sanitaires efficaces visant à réduire les inégalités de santé; 2. l'identification des groupes défavorisés à qui l'intervention sera dirigée; 3. l'identification des zones où vivent ces groupes; 4. l'allocation des ressources en fonction de la composition des groupes ou des zones cibles; 5. d'assurer que les ressources et les interventions nécessaires ont été mises à profit de manière appropriée pour les groupes défavorisés. Source : Peter C. Smith Bulletin OMS, vol 86; 2008 Dr Belghiti/SG/MS 18
- 20. Adaptation de J. Campbell. Bulletin WHO 2013;91:853–863 Dr Belghiti/SG/MS 20
- 21. Portée descriptive : Pour les deux secteurs Fonction répertoire : BOSS (Mar.); FINESS (Fr.) « La carte sanitaire détermine au niveau national, interrégional et pour chaque région, l'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante; … » Art. 23 L34-09 Le SROS « détermine, par préfecture ou province, … l'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante; la projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale ; la répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines… » Art 24 L34-09 Dr Belghiti/SG/MS 21
- 22. Portée normative pour le secteur public « La création et l'implantation de tout établissement de santé public s’effectueront conformément à la carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins ». Article 26 L34-09 Portée incitative pour le secteur privé « La création et l'implantation des cliniques et établissements assimilés, des cabinets de radiologie et des laboratoires d'analyses de biologie médicale s'effectueront par référence aux orientations de la carte sanitaire ct aux schémas régionaux de l'offre de soins. » Art 26 L34-09 « Peuvent bénéficier de mesures d'encouragement aux investissements dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sous réserve du respect du cahier de charges établi par l' administration : les fondateurs des établissements de santé privés, à but non lucratif, qui acceptent de respecter la carte sanitaire; les médecins et les médecins dentistes qui acceptent de se soumettre à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre; les fondateurs des établissements de santé privés qui acceptent de faire partie d'un réseau de soins d'utilité publique fixé par l'administration dans le cadre d'un projet de partenariat public-privé. » Art 29 L34-09 Dr Belghiti/SG/MS 22
- 23. Selon l’art 31 constitution L’accès aux soins est un droit fondamental Selon le PIDESC (Art.12). OG. 14 (2000) Le droit à la santé suppose l'existence des éléments interdépendants et essentiels suivants : La disponibilité (Suffisance) L’accessibilité : Comporte 4 dimensions qui se recoupent mutuellement 1. Non-discrimination, 2. Accessibilité physique 3. Accessibilité économique (abordabilité) 4. Accessibilité de l'information L’acceptabilité (appropriation culturelle) Qualité (appropriation organisationnelle et scientifique) Dr Belghiti/SG/MS 23
- 24. 1.La Carte sanitaire 2.Le SROS 3.Le Numerus clausus 4.Le PPP 5.Le régime des autorisations 6.La coordination institutionnelle Dr Belghiti/SG/MS 24
- 25. Article 10 L34-09 « L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément à la carte sanitaire et aux SROS » Article 20 L34-09 « La carte sanitaire et le SROS ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population, de réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux et maîtriser la croissance de l'offre ». Article 21 L34-09 « La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l'offre et notamment: les types d'infrastructures et des installations sanitaires; les normes et les modalités de leur implantation territoriale. La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical ». Art, 23 L34-09 « La carte sanitaire est établie par l'administration. après avis de la commission nationale de l'offre de soins …, pour une durée maximum de 10 ans ». Dr Belghiti/SG/MS 25
- 26. Article 24 L34-09 « II [le SROS] constitue la base pour l'organisation des liens fonctionnels entre les secteurs public et privé, entre les régions et entre les préfectures ct provinces les composant ». « Il [le SROS] détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra régional et sur la base de l'analyse des besoins; 1. l'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante; [BOSS] 2. la projection des établissements de santé, des lits et places. des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale ; 3. la répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines, Dr Belghiti/SG/MS 26
- 27. Article 24 L34-09 « En fonction des besoins, le SROS peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur l'organisation de ressources rares ». Article 25 L34-09 « Le SROS sera établi par la direction régionale de la santé concernée, pour une période de 5 ans, après avis de la commission régionale de l'offre de soins … Il pourra être révisé suivant la même procédure, en cas de changement des normes ou des modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires dans la carte sanitaire ayant des effets sur le schéma régional ». Dr Belghiti/SG/MS 27
- 28. Article 26 L34-09 La création et l'implantation de tout établissement de santé public s’effectueront conformément à la carte sanitaire et au SROS. La création et l'implantation des cliniques et établissements assimilés, des cabinets de radiologie et des laboratoires d'analyses de biologie médicale s'effectueront par référence aux orientations de la carte sanitaire et aux SROS. Dr Belghiti/SG/MS 28
- 29. Art. 28 L34-09 « Sous réserve des dispositions législatives el réglementaires relatives à la distance entre les officines. il pourra être instauré, sur la base de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins, un numerus clausus pour l'implantation des officines de pharmacie ». Art 57 L17-04 « la distance minimale devant séparer l’extrémité de façade de l’officine en projet la plus proche de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes est de 300 mètres mesurée suivant une ligne droite » Dr Belghiti/SG/MS 29
- 30. L34-09 « Les établissements de santé privés peuvent participer, sur la base d'un cahier de charges, à des actions de santé publique dans le cadre de la complémentarité entre les deux secteurs. Dans ce cadre, des modes de partenariat public-privé seront mis en place pour permettre la participation du secteur privé à des missions du service public de santé, notamment par voie de la gestion déléguée, d'association à l'exécution d'actions conjointes ou par l'achat au secteur privé de prestations sanitaires non disponibles ou insuffisantes dans les établissements de santé publics ». Art 15 « L'exploitation commune de ces installations ou de certains équipements par plusieurs établissements de sante peut être autorisée ». Art 27 « Peuvent bénéficier de mesures d'encouragement aux investissements dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sous réserve du respect du cahier de charges établi par l' administration … les fondateurs des établissements de santé privés qui acceptent de faire partie d'un réseau de soins d'utilité publique fixé par l'administration dans le cadre d'un projet de partenariat public-privé. » Art 29 Dr Belghiti/SG/MS 30
- 31. Article 27 L34-09 « Sera soumise au respect de la carte sanitaire et des SROS la création de toute installation de haute technologie, des équipements biomédicaux lourds ainsi que de tout système de régulation des services d'assistance médicale urgente ». « Il sera institué un régime d'autorisation de l'ensemble de ces dispositifs ». « L'exploitation commune de ces installations ou de certains équipements par plusieurs établissements de sante peut être autorisée ». Art 26 L34-09 Il sera délimité les zones géographiques où la création de certains établissements de santé privés n'est pas autorisée compte tenu de la nature de ces établissements et des besoins de la population. Dr Belghiti/SG/MS 31
- 32. Des instances de concertation : une commission nationale de l'offre de soins (CNOS) et des commissions régionales de l'offre de soins (CROS); Des mécanismes de coordination des soins: Réseaux, filières et SAMU Des dispositifs particuliers de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé et entre les différents niveaux de prise en charge hospitalier, externe et ambulatoire, seront institués et notamment: des filières et des niveaux de soins organisés à partir des médecins généralistes pour le secteur privé et des services de soins de santé de base pour le secteur public; des réseaux coordonnés de soins, notamment pour les patients atteints d'une affection exigeant une prise en charge globale multidisciplinaire; des systèmes de régulation des services d'assistance médicale urgente (SAMU) » art 16 Dr Belghiti/SG/MS 32
- 33. Projets d’arrêtés d’application 1. Décret relatif à l’organisation du numerus clausus des officines; 2. Arrêté sur la carte sanitaire (BOSS); 3. Arrêté conjoint relatif à la définition des besoins en ressources humaines de santé; 4. Arrêtés approuvant les SROS; 5. Arrêté portant organisation des EMS; 6. Décrets/Arrêtés portant dispositions particulières de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé relatives aux filières de soins, aux réseaux cordonnées de soins et aux SAMU prévues à l’art 16 de la L34-09 . Autres outils de la carte sanitaire 1. Cadre de référence pour l’établissement des prévisions de l’offre de soins y compris les structures d’appui, 2. Circulaire relative à l’organisation du mode mobile, 3. Circulaire portant organisation des centres de référence et des pôles d’excellence, 4. Méthodologie d’élaboration des SROS Dr Belghiti/SG/MS 33
- 35. Carte sanitaire GB: Rapport Dawson (1920): 1ere carte sanitaire moderne Bases du modèle du système de soins intégré France: 1970 Publique et hospitalière Complétée par le SROS:1991 et le SIOS: 1996 Tunisie : 1991… Premier projet marocain : 1998 La CS est un préalable ou une mesure d’accompagnement pour d’autres réformes du SS Maîtrise des dépenses de santé Contractualisation Décentralisation Accréditation… Dr Belghiti/SG/MS 35
- 36. 1920 : rapport de Dawson 1ere Carte sanitaire moderne Naissance du Modèle des systèmes de santé intégrés (SSI) 1942: Rapport de Beveridge 1948: Mise en place du NHS Naissance du modèle Beveridge de la couverture médicale Justification : s'attaquer à l'inégalité dans les services de soins de santé. Entre 1948 et 1968 l’évolution des dotations financières du NHS pour les 14 régions sur la base de l'inflation. 1971: La loi inverse des soins (The inverse care law) proposée par Julien Tudor Hart. Elle s’énonce ainsi : « La disponibilité de soins médicaux de qualité est inversement proportionnelle aux besoins de la population desservie ». The Lancet, vol 297, pp. 405-412, le 27 Février 1971 Initiation du principe de la « redistribution sélective des soins » Dr Belghiti/SG/MS 36
- 37. Dr Belghiti/SG/MS Organisation de l’offre de soins • Principes 1. Disposition des bâtiments et équipements. 2. Services convenablement corrélées et disponibles pour tous. 3. Possibilité d’un meilleur travail et de l'avancement des connaissances. 4. Coordination de la médecine préventive et curative. 5. Liberté d'action pour le médecin et le patient. • Organisation des services de santé I. Services à domicile II. Services institutionnalisés 1. Dans Les centres de santé Primaires; 2. Dans Les centres de santé Secondaires; 3. Les services supplémentaires 4. Dans des Hôpitaux d'Enseignement. • Personnel requis par niveau de services 37
- 38. 1976: Mise en place du système RAWP Mise en place du système RAWP (Ressources Allocation Working Party) qui permet l’allocation des ressources à chaque région sur la base des besoins de santé (Mays et Bevan, 1987 ; Jourdain, 1991). La formule de RAWP repose sur 4 critères principaux : La composition de la population régionale par classes d’âge et par sexe ; les taux moyens d’hospitalisation par catégorie de maladie normalisée selon l’âge ; le coût moyen d’hospitalisation pour chaque catégorie de maladie. le taux de mortalité standardisé (standart mortality ratio ou SMR) pour chaque région pour obtenir le ratio de surmortalité ou de sous-mortalité de la région. Cette approche a donné naissance à la notion de «capitation pondérée", dont les principes sont toujours en vigueur dans le NHS, bien que les méthodes de quantification des différents éléments aient changé. Dr Belghiti/SG/MS 38
- 39. 1958 (réforme hospitalo-universitaire) Décret du 11 et 30 décembre portant création des CHU 1960 : Sectorisation de l’offre psychiatrique par circulaire Les premiers secteurs apparaissent réellement vers 1970, et le nombre de lits diminue dans les années 1980 (130 000 lits en 1970 contre 70 000 en 2000) 1970: Instauration de la carte sanitaire par la loi 70-1318 portant réforme hospitalière C’est une Carte Sanitaire hospitalière et publique Création du service public hospitalier (SPH) et du SAMU/SMUR Base de découpage : le secteur sanitaire (de 80 000 à 200 000 hab.) Suppression des petits hôpitaux et création d’une coopération inter- hospitalière incluant le privé volontaire pour le SPH (syndicats inter- hospitaliers) Régulation par la fixation d’indices « de besoin » (ratios d’équipements) par région et secteur sanitaire. Densité réglementée de lits hospitaliers en MCO, d’équipements « lourds » et d’autorisations (réanimation, maternité) Dr Belghiti/SG/MS 39
- 40. 1979: Instauration de la régulation de l’offre hospitalière par la Loi 79-1140 autorisant le MS à supprimer des lits hospitaliers 1983: Mesures de régulation des dépenses de la sécurité sociale (Promulgation de la loi n° 83-25 du 19) Instauration du forfait journalier, de la dotation globale de financement. Le gouvernement fixe le taux d’augmentation des dépenses hospitalières PMSI 1985 Légalisation de la sectorisation psychiatrique avec des circonscriptions géographiques de 70 000 habitants pour les adultes et 210 000 pour les enfants. 1986: Création de la Fonction publique hospitalière par la loi n° 86-33 1991-2003: Décentralisation de la planification de l’offre et diversification des outils de régulation Création des SROS et de l’obligation du projet d’établissement (en plus de la CS) Mise en place des ARH et de la de la Contractualisation (COM); Renforcement de la coopération inter-hospitalière par la création de la communauté des établissements de santé – assurant le service public hospitalier dans le secteur; Dr Belghiti/SG/MS 40
- 41. Lits et places MCO Médecine : 1 à 2.2 lit/1000 hab (2.0) Chirurgie : 1 à 2.2 lit/1000 hab (1.5) Obstétrique : 0.2 à 0.5 lit/1000 hab (0.5) Néonatalogie : 2-3 lits/1000 NA Neurochirurgie: 0.04 lits/1000 hab Équipements lourds IRM: 1/400 000 hab puis [1/190000-1/140000] Lithotripteur extracorporel : 1/1.5 Millions hab Scanner : 1/100 000 hab App. Radiothérapie: 1/150 000 hab Caisson hyperbare : 2/1 million d’hab Dr Belghiti/SG/MS 41
- 42. 2003: Suppression de la CS dans le cadre du plan Hôpital 2007 Simplification du régime des autorisations d’activités de soins en supprimant la carte sanitaire, mais en renforçant le rôle du SROS élaboré par les ARH; Relance de la coopération inter-hospitalière en supprimant le recours aux syndicats inter-hospitaliers issus de la loi du 31 décembre 1970 au profit des groupements de coopération sanitaire instaurés par l’ordonnance du 24 avril 1996 ; Instauration de 2 nouveaux modes de financement des investissements, voire du fonctionnement des hôpitaux avec le recours désormais autorisé au bail emphytéotique administratif (BEA) étendu aux immeubles et aux biens meubles et l’ouverture du marché des grands hôpitaux au partenariat public-privé, véritable formule d’affermage des hôpitaux à des constructeurs en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel par l’hôpital. Cette privatisation du financement des hôpitaux apparaît comme un ballon d’oxygène avec, en contrepartie, une hypothèque pour l’avenir de la politique hospitalière de plus en plus favorable aux grandes concentrations dont les coûts de fonctionnement sont proportionnels à leur gigantisme. Ce financement à crédit a été la base du plan de rénovation hospitalière dénommé plan « Hôpital 2007 ». Mise en place d’objectifs quantifiés de l’offre de soins par territoire Dr Belghiti/SG/MS 42
- 43. 2004: SROS de 3e génération Plus grande prise en compte de la dimension territoriale notion de territoire de santé remplace celle de secteur de santé (indépendamment des départements et des régions) Suppression de la CS et des indices (remplacés par une annexe du SROS) L’offre en fonction des besoins et non de l’existant Déconcentrer les autorisations aux ARH Inter-régionalité (mission de CHU): SIOS Planification spécifique pour Les urgences, La réanimation, L’IRC, La périnatalité, Le cancer Mise en place d’une organisation graduée des plateaux techniques 5 niveaux (non obligatoires): proximité, intermédiaire, recours, régional, interrégional Incitation au développement de réseaux de santé 16 thèmes obligatoires des SROS Médecine, chirurgie, périnatalité, personnes âgées, enfants et adolescents, soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle, HAD, urgences médicales, réanimation & soins intensifs, IRC, Imagerie médicale, techniques interventionnelles, cancer, soins palliatifs, traumatismes. développement des hôpitaux locaux dans le cadre de la lutte contre la pénurie d’équipements dans les zones sous-médicalisées, Développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) 2006: Mise en place des SIOS (schémas interrégionaux de l’organisation sanitaire) pour 5 activités hautement spécialisées Dr Belghiti/SG/MS 43
- 44. 2009: Loi Hôpital Patients Santé Territoires: la loi créé une nouvelle catégorie d’établissements soumis à des obligations particulières : les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC); les centres de lutte contre le cancer; et les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès des agences régionales de santé (ARS). Suppression des hôpitaux locaux. Renforcement de la coopération entre les établissements de santé via deux modalités : Les CHT (communautés hospitalières territoriales) entre établissements public de santé, peuvent conclure une convention pour mettre en œuvre une stratégie commune et gérer en commun. Un établissement ne peut être partie qu’à une seule convention de CHT. Les GCSM (groupements de coopération sanitaire de moyens), peuvent être constitués par des établissements de santé publics et privés, des établissements médico-sociaux, des centres de santé, des pôles de santé et des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société, pour organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche. Ce groupement poursuit un but non lucratif et est soumis à une convention approuvée par le directeur de l’ARS. Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) L’ANAP des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public (GIP) constitué de l’Etat, de l ‘Union des caisses d’assurance maladie (Uncam) ; la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et les fédérations représentatives des - établissements de santé et médico-sociaux. Dr Belghiti/SG/MS 44
- 45. 1960-1969: Instauration de l’assurance hospitalisation et l’accès universel à des services hospitaliers gratuits 1966-1970: Rapport de la commission Castonguay-Nepveu (1966-70) : Castonguay est considéré comme le « père de l'assurance maladie » et du code des professions au Québec. Son rapport a recommandé l'instauration d'une loi sur d'assurance-maladie (Accès au financement) d’un nouveau réseau de santé et services sociaux (Accès aux services médico-sociaux en proximité, CLSC): Création d’offices régionaux de santé 1971-1973 : Loi sur l’assurance maladie (1970) Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971) Réseau intégré de services de santé et des services sociaux Un palier régional: la région devient le cadre de référence de l’organisation territoriale des services publics. Le palier local est l’instance de regroupement des établissements offrant des services directs à la population. Code des Professions avec création de l'Office des Professions du Québec (1973) Dr Belghiti/SG/MS 45
- 46. 1985-1987 : Rapport de la commission Rochon Virage ambulatoire Réduction des lits et Regroupement d’établissements Le nombre d’établissements entre 1990 et 2009 a été réduit de plus des deux tiers (-68 %) du fait, en grande partie, de fusions et de changements de vocation de certains établissements. Si elle a été le fruit d’un processus continu depuis près de 20 ans, cette diminution a été forte entre 2004 et 2008 (-35,8, %) en raison de la restructuration du réseau initiée en 2003 par le ministre libéral Philippe Couillard. 1991: Révision de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Dr Belghiti/SG/MS 46
- 47. 1991: Loi n° 91-63 relative à l’organisation sanitaires « La carte sanitaire du pays détermine, compte tenu de la répartition géographique, de l’importance et de la qualité de l’équipement public et privé existant, de l’évolution démographique ainsi que du progrès des techniques médicales, les zones et le secteurs sanitaires dans lesquels des établissements de soins et d’hospitalisation peuvent être crées », « les structures sanitaires relevant du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur sont régies par des textes particuliers ». « les structures sanitaires publiques sont classées suivant leur mission, leur équipement, leur niveau technique et leur compétence territoriale, en : Centres de santé de base; Hôpitaux de circonscription; Hôpitaux régionaux; Etablissement sanitaires à vocation universitaire « les structures sanitaires publiques peuvent, en cas de besoin, conclure des conventions avec les médecins, pharmaciens, médecins dentistes et techniciens supérieurs de libre pratique, leur permettant d’exercer une activité professionnelle au sein des dites structure, à titre gratuit ou onéreux ». « l’installation dans tout établissement sanitaires privés en activité, d’équipement matériels lourds est subordonnée aux autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la présente loi » Dr Belghiti/SG/MS 47
- 48. Partie 3 LA CARTE SANITAIRE Les Méthodes et les composantes Dr Belghiti/SG/MS 48
- 49. Les principes régissant le système de santé: Art 2 L34-09 « Le système de santé est constitué de l'ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants: 1. la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation ct la restauration de la santé; 2. l'égalité d'accès aux soins et services de santé; 3. l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ; 4. la complémentarité intersectorielle; 5. l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. La mise en œuvre de ces principes incombe principalement à l'Etat ». Dr Belghiti/SG/MS 49
- 50. L’équité, l’intégration et la coordination: Art 9 L34-09 « L'offre de soins doit être répartie sur l'ensemble du territoire national d'une manière équilibrée et équitable, dans le respect des principes énoncés à l'article 2 ci-dessus et conformément aux dispositions du titre III de la présente loi cadre ». « Le secteur public et le secteur privé, qu'il soit à but lucratif ou non, doivent être organisés de manière synergique afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre de soins et de services complémentaires, intégrés et coordonnés » La globalité Article 21 L34-09 « La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical ». Article 9 L34-09 « L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles ainsi que les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. » La gradation des soins Article 7 D2-14-562 « L’offre de soins est régie par le principe de gradation des niveaux de soins ». Dr Belghiti/SG/MS 50
- 51. 1. la solidarité et la responsabilisation de la population; 2. l'égalité d'accès aux soins et services de santé; 3. l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires; 4. la complémentarité intersectorielle; 5. l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. 6. L’intégration et la coordination 7. La globalité 8. La gradation des soins Dr Belghiti/SG/MS 51
- 52. La loi 34-09 et son décret d’application consacrent et consolident le modèle de de système de soins préconisé par le Maroc qui est un système : Pyramidal, Intégré, Hiérarchisé et fondé sur les SSP Article 7 D2-14-562 « L’offre publique de soins est régie par le principe de gradation des niveaux de soins. Elle repose sur un système de référence et de contre référence, qui régule les parcours de soins des patients en dehors des situations d’urgence. Ce système peut être organisé à l’intérieur du même territoire de santé sous forme de réseaux coordonnés de soins, ou entre les territoires de santé sous forme de filières de soins ». Article 30 D2-14-562 « Les établissements relevant du réseau hospitalier font partie de la filière de soins. Ils constituent, à ce titre, des établissements de recours et d'appui pour le réseau des établissements de soins de santé primaires ». Dr Belghiti/SG/MS 52
- 53. Hôp. 3e recours (CHI) Hôpitaux de 2e recours (CHR) Hôpitaux de 1er recours (CHP) Niveau de 1ere ligne : RESSP Population(s) Réseau intégré de soins d’urgence RISUM EMSEMSEMS EMS EMS EMS Réseau des établissements médico-sociaux REMS Dr Belghiti/SG/MS 53
- 54. 1. Un Contenant : Le territoire sanitaire « La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national, en fonction du bassin de desserte de la population et de ses caractéristiques épidémiologiques, géographiques, démographiques, socio-économiques et administratives » art 22 L34-09 2. Un Contenu : Les prestations de soins et services Art 21 L34-09 « La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l'offre et notamment les types d'infrastructures et des installations sanitaires… 3. Une organisation des soins: Réseaux & Filières « La carte sanitaire détermine également les réseaux de prise en charge de problèmes et risques particuliers de santé» art 23 L34-09 4. Des critères et normes d’implantation: «La carte sanitaire détermine « les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires », art 23 L34-09 Dr Belghiti/SG/MS 54
- 55. La responsabilité territoriale sur la santé L’organisation démocratique et politique repose sur le territoire L’organisation de soins doit intégrer cette dimension territoriale pour profiter des opportunités de collaboration intersectorielle, et pour faciliter la responsabilité territoriale et politique sur la santé (santé dans toutes les politiques) Le territoire un déterminant de la santé: Les inégalités géographiques de santé sont des formes d’iniquité et des sources de gaspillage des ressources; La Carte Sanitaire amène une prise de conscience sur les déterminants géographiques de la santé; Dr Belghiti/SG/MS 55
- 56. « Une conscience géographique de la santé » E. Vigneron Sciences Humaines, HS, N°48, 2005 pp. 80-82 Avant 1970 : Géographie de la maladie (en lien avec l’hygiène et l’épidémiologie); 1970 : Naissance de la Géographie des soins avec Henri Picheral, qui introduit la notion de territoire de santé en lien plutôt avec l’aménagement du territoire (méthodologies d’analyse spatiale, création de modèles territoriaux de répartition de l’offre et de recours aux soins. 1980-1990 : Développement de la Géographie de la santé via des approches socio-économiques révélant et analysant les inégalités spatiales de santé (F. Tonnellier, H. Faure…) . Plus récemment, intégration dans la géographie de la santé la consommation médicale, l’accès aux soins et la répartition de l’offre (les travaux de Véronique Lucas et Magali Coldefy). 2012 : initiative d’organisation des sciences du territoire Naissance Depuis sa création en 2012, le Collège international des Sciences du Territoire (CIST) coordonne la recherche francilienne à l'échelle européenne et mondiale dans le domaine des sciences du territoire. Un des axes de recherche du CITS est « Territoire et santé » Dr Belghiti/SG/MS 56
- 57. A. Méthodes classiques : Distribution de (toute) la population autour des établissements de santé B. Méthodes théoriques (SIG & Logiciels) 1. Fréquentation et distance (loi de Newton) : La fréquentation en fonction de la distance peut être modélisée selon la loi classique de Newton et la formule « Fréquentation = Distanceª» (a:attractivité). 2. Zones de chalandise (Géomarketing) Zone de chalandise = Zone géographique d'influence d'où provient la majorité de la clientèle. Courbes isométriques (distance à vol d’oiseau) Courbes isochrones (Temps de déplacement) 3. Aires d’attraction Polygone de Thiessen, Aires de Reilly C. Méthodes fondées sur les flux réels d’utilisation des services (carte des flux de patients). analyse des déplacements de population vers différents types de services construits autour d’un ou de plusieurs services de santé. D. Méthodes de ciblage des « zones à risques », Cumul d’inégalités sanitaires: présence simultanée de mauvais indicateurs de mortalité, de consommations ou d'accès aux soins avec les caractéristiques sociales qui leur sont associées. Dr Belghiti/SG/MS 57
- 58. 28 18 31 23 41 25 1817 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 <3Km 3 à 6 Km 6à 10km >10kM % Dispers Rayon 1996 Dispers Rayon 2003 Dr Belghiti/SG/MS 58
- 59. Ex. Méthode isochrone appliquée à la région Doukala Abda (2008) Dr Belghiti/SG/MS 59
- 60. Ex. de méthodes isométrique Appliquée à la région GCBH (2008) Dr Belghiti/SG/MS 60
- 61. Art 24 L34-09 « En fonction des besoins, le SROS peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur l'organisation de ressources rares ». Art 26 L34-09 « Il sera délimité les zones géographiques où la création de certains établissements de santé privés n'est pas autorisée compte tenu de la nature de ces établissements et des besoins de la population. » Dr Belghiti/SG/MS 61
- 62. Provinces de priorité 1, selon les trois paramètres AMS, Densité litière et distance KM Provinces de priorité 2, selon les deux paramètres AMS en deçà de 50% et densité litière Légende Identification des provinces de priorité 1 et 2 selon les paramètres AMS, Densité litière pour 10.000 hbts et distance kilométrique Ex. de Méthode de ciblage des zones à risque
- 63. (Définis par les textes) Dr Belghiti/SG/MS 63
- 64. La L34-09 et le D2-14-562 introduisent pour la 1ère fois dans la réglementation marocaine 3 notions: • La découpage sanitaire • Le territoire sanitaire • Le bassin de dessert « La carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national, en fonction du bassin de desserte de la population et de ses caractéristiques épidémiologiques, géographiques, démographiques, socio-économiques et administratives » art 22 L34-09 « le territoire national est découpé en territoires de santé » Art 9 D2-14-562 Dr Belghiti/SG/MS 64
- 65. Article 9 D2-14-562 « Conformément à l’article 9 de la loi cadre précitée, l’offre de soins doit être répartie sur l’ensemble du territoire national de manière équilibrée et équitable, sur la base de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l’offre de soins. A cet effet, le territoire national est découpé en territoires de santé qui constituent des bassins de desserte de la population desservis par un ou plusieurs établissements ou installations de santé. La délimitation de ces territoires de santé, qui se base sur la division administrative du royaume, peut être complétée le cas échéant par un découpage spécifique fixé par le ministre de la santé en vue d’arrêter les territoires les plus pertinents pour l’action sanitaire ». Ainsi (définitions) Les territoires de santé « constituent des bassins de desserte de la population desservis par un ou plusieurs établissements ou installations de santé ». Article 9 D2-14-562 Le territoire de santé correspond au découpage administratif complété par un découpage spécifique Dr Belghiti/SG/MS 65
- 66. La CS met en place 4 territoires sanitaires : « Les territoires de santé sont (art 10 D2-14-562): 1. Les circonscriptions sanitaires ; 2. Les préfectures et provinces sanitaires ; 3. Les régions sanitaires ; 4. Les territoires de santé inter-régionaux » La CS prévoit également des sous-territoires sanitaires fonctionnels Secteur sanitaire Bassin de desserte du DR Bassin de desserte d’un hôpital de proximité Bassin de desserte d’un équipement lourd ou de haute technologie Bassin de desserte des Centres de référence Dr Belghiti/SG/MS 66
- 67. Article 11 D2-14-562 La circonscription sanitaire représente le territoire de base dans le découpage sanitaire pour la planification de l’offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d’actions sanitaires. La circonscription sanitaire est l’aire géographique où l’ensemble des prestations de soins de santé primaires doit être disponible. Ces prestations comprennent les activités requises de prévention, de promotion de la santé et des modes de vie sains, ainsi que les soins liés à l’accouchement, aux urgences de proximité et à la médecine générale. Article 12 D2-14-562 La circonscription sanitaire peut être rurale ou urbaine. La circonscription sanitaire rurale correspond au territoire d’un caïdat. La circonscription sanitaire urbaine correspond au territoire d’un arrondissement dans les communes soumises au régime d’arrondissements ; ou au territoire de l’ensemble de la commune urbaine, lorsque celle-ci n’est pas découpée en arrondissements. Article 13 D2-14-562 Chaque circonscription sanitaire est découpée en deux ou plusieurs secteurs sanitaires. Le secteur sanitaire correspond à l’aire de desserte d’un centre de santé. Dr Belghiti/SG/MS 67
- 68. Article 14 D2-14-562 « Les préfectures et provinces et régions sanitaires correspondent respectivement aux ressorts territoriaux des préfectures, des provinces définis par les textes réglementaires en vigueur relative à la division administrative du Royaume ». Article 15 D2-14-562 « Chaque préfecture ou province sanitaire est découpée en deux ou plusieurs circonscriptions sanitaires ». « L’offre de soins au niveau d’une préfecture ou province sanitaire comprend, en plus des prestations de soins de santé primaires, des prestations de réhabilitation et des prestations hospitalières de premier niveau ». La liste des prestations hospitalières du premier niveau, figure à l’annexe 1 du présent décret. Article 16 D2-14-562 « La préfecture ou la province sanitaire constitue le champ d’intervention d’une délégation préfectorale ou provinciale relevant du ministère de la santé ». Dr Belghiti/SG/MS 68
- 69. Article 17 D2-14-562 « Les régions sanitaires correspondent au ressort territorial des régions, tel que défini par les textes réglementaires en vigueur relative à la division administrative du Royaume ». Article 18 D2-14-562 « Chaque région sanitaire est composée de deux ou plusieurs préfectures et provinces sanitaires ». « L’offre de soins au niveau d’une région sanitaire comporte, en plus des prestations de soins du niveau provincial et préfectoral, les prestations hospitalières du deuxième niveau. La liste des prestations hospitalières du deuxième niveau figure à l’annexe 1 du présent décret. La région sanitaire peut abriter des ressources, des installations, des équipements ou des établissements de santé à vocation interrégionale ». Article 19 D2-14-562 « La région sanitaire constitue le champ d’intervention de la direction régionale de la santé relevant du ministère de la santé ». Dr Belghiti/SG/MS 69
- 70. Article 20 D2-14-562 « Le territoire de santé inter-régional correspond au bassin de desserte d’une infrastructure, d’un équipement, d’une installation de santé ou d’une installation de haute technologie rendant des prestations à caractère interrégional, notamment les prestations hospitalières du troisième niveau et les prestations fournies par les pôles d’excellence ou des centres de référence interrégionale ». « La liste des prestations hospitalières du troisième niveau figure à l’annexe 1 du présent décret ». Dr Belghiti/SG/MS 70
- 71. Quel ensemble de prestations de soins et services faut-il soumettre à la planification/régulation? Celui sensé être garanti par la constitution: « Panier normatif de droit »? Celui garanti par l’AMO? RAMED?... Celui recommandé par l’OMS: Soins de santé essentiels et soins de recours ? Celui négocié avec les parties prenantes ? Pour quelle(s) population(s) ? A déployer dans quel(s) territoire(s) sanitaire(s) ? A chaque niveau de territoire doit correspondre un paquet de soins et services Avec quels objectifs de couverture ? Dr Belghiti/SG/MS 71
- 72. Article 20 L34-09 La carte sanitaire et le SROS visent à « satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population… ». Art 21 L34-09 La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical. Art 24 L34-09 « Il (SROS) détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra régional et sur la base de l'analyse des besoins …»; « En fonction des besoins, le SROS peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur l'organisation de ressources rares ». Art 26 L34-09 « Il sera délimité les zones géographiques où la création de certains établissements de santé privés n'est pas autorisée compte tenu de la nature de ces établissements et des besoins de la population. » Dr Belghiti/SG/MS 72
- 73. Autres déterminants de la santé Autres déterminants de la santé Besoins au niveau des autres déterminants Politique de promotion de la santé Etat de santé Objectifs de santé BESOINS DE SANTE Politique de santé Services utilisés et produits Services requis (objectifs de services) BESOINS DE SOINS OU DE SERVICES Politique de soins et de services Ressources disponibles Ressources requises (objectifs de ressources) Besoins de ressources Politique de ressources SITUATION ACTUELLE SITUATION DESIREE ECART A COMBLER ACTIONS Pineault et Daveluy (1995); La planification de la santé : concepts, méthodes, stratégies. Dr Belghiti/SG/MS 73
- 74. Besoins de santé (y compris DSS) Besoins de soins et services Situation sanitaire actuelle Comparaison Écart actuel Besoin en offre de soins À l’horizon t0+n Programmation Niveaux d’utilisation des soins et services Situation sanitaire Projetée (t0+n) (Nat. & internat.) Ecart projeté Dr Belghiti/SG/MS Besoins de ressources (dont l’offre de soins) Niveaux de ressources (dont l’offre de soins) 74
- 75. Population générale (CC/TAH) MNT Travailleurs Populations à besoins spécifiques Jeunes & Adolescents (VMS/IST) Enfants (Vac/CNS) Femmes (CPN/AMS) Dr Belghiti/SG/MS … 75
- 76. Le mode fixe : les paniers de soins sont organisés Par établissement de santé (privé et public) « On entend par établissements de santé au sens de la présente loi cadre, les divers établissements de santé, quel que soit leur statut, organisés en vue de participer à l’offre de soins » Art 11 L34-09 « Les établissements de santé publics et privés assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins ou de réadaptation nécessitant ou non une hospitalisation ». Art 11 L34-09 « Le SROS détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire, en fonction du découpage sanitaire intra-régional et sur la base de l'analyse des besoins;[…] la projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale;… » Article 24 L34-09 Avec une normalisation (et régulation) des dimensions techniques et des standards de qualité de sécurité « Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements de santé des secteurs public el privé el à l'exercice des professions de santé, ces établissements sont organisés et gérés dans des conditions qui garantissent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, normes de sécurité des patients, normes de sécurité des installations, des équipements et les personnes qui y travaillent, règles d'éthique et de déontologie applicables à chaque profession ; normes et standards de qualité: règles d'hygiène et de salubrité: règles de bonne pratique clinique ». Article 12 L34-09 « Une procédure d'évaluation des établissements de santé, publics et privés dite « accréditation » sera instaurée en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ». Article 18 L34-09 Le mode mobile: VAD, UMM, CMS et HM Dr Belghiti/SG/MS 76
- 77. Article 14 L34-09 Les établissements de santé prestataires de soins et services dans le secteur privé, à but lucratif ou non, sont constitués notamment des: cabinets médicaux (de médecine générale et de spécialité) ; cabinets de radiologie et d'imagerie médicale; installations d' assistance médicale urgente; cabinets de médecine dentaire; cliniques et établissements qui leur sont assimilés; établissements médico-sociaux assurant une prise en charge médicalisée des personnes âgées et, de manière générale, des personnes à besoins spécifiques; établissements de soins de suite et de convalescence; laboratoires d'analyses de biologie médicale; officines de pharmacie et dépôts de médicaments; cabinets paramédicaux. Dr Belghiti/SG/MS 77
- 78. Article 5 D2-14-562 « L’offre publique de soins en mode fixe est composée des quatre réseaux d’établissements de santé suivants : 1. Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) ; 2. Le réseau hospitalier (RH) ; 3. Le réseau intégré des soins d’urgence médicale (RISUM) ; 4. Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS). L’offre publique de soins comprend, en outre, 5. des structures spécialisées d’appui aux réseaux précités 6. ainsi que des installations de santé mobiles ». Dr Belghiti/SG/MS 78
- 79. ESSP en milieu rural (art 21 D2-14-562) Centre de santé rural de premier niveau: CSR1 (ex CSC) Centre de santé rural de 2e niveau : CSR2 (ex CSCA) +/- Dispensaire rural au besoin (DR) ESSP en milieu urbain (art 21 D2-14-562) Centre de santé urbain de premier niveau : CSU1 (ex CSU) Centre de santé urbain de 2e niveau: CSU2 (ex CSU) Structures spécialisées d’appui du RESSP (art 26 D2-14-562) Les centres de référence pour la santé reproductive (CRSR) ; Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR) ; Les laboratoires de santé publique (laboratoires de diagnostic épidémiologique et d’hygiène du milieu) Dr Belghiti/SG/MS 79
- 80. Panier primaire de premier niveau (CSR1 et CSU1) 1. la surveillance épidémiologique, 2. Les consultations de médecine générale ; 3. Les prestations de soins infirmiers ; 4. Le suivi de la santé de la mère et de l’enfant ; 5. Le suivi des maladies chroniques ; 6. Le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire ; 7. Les prestations d’information et d’éducation pour la santé. Panier primaire de niveau 2 (CSR2 et CSU2) 1. les prestations fournies par le centre de santé de premier niveau, 2. Les soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB) ; 3. Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; 4. Les examens d’échographie obstétricale. 5. Lorsque le CSR2 est implanté dans le chef-lieu d’un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, le centre est doté 1. d’un module d’accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus : 2. Des prestations d’urgence médicale de proximité ; 3. Des soins bucco-dentaires ; 4. Des consultations de santé mentale. Dr Belghiti/SG/MS 80
- 81. Le RH est composé des établissements suivants (art 27 D2-14-562) : 1. Les Hôpitaux préfectoraux et provinciaux ; 2. Les Hôpitaux régionaux ; 3. Les Hôpitaux interrégionaux; 4. Les Hôpitaux psychiatriques ; 5. Les Centres régionaux d’oncologie ; 6. Les Centres d’hémodialyse. 7. +/- Hôpitaux de proximité, lorsque la superficie d’une province est étendue, 8. +/- clinique du jour, lorsque la taille d’une préfecture est importante, 9. +/- des pôles d’excellence, 10. +/- des centres de référence. Structures spécialisées d’appui au RH(art 36 D2-14-562): 1. le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d’hématologie ; 2. l’institut national d’hygiène ; 3. le centre national antipoison et de pharmacovigilance ; 4. le centre national de radioprotection ; Dr Belghiti/SG/MS 81
- 82. Les CHP: 20 spécialités Les CHR: 28 spécialités Les CHI: 40 spécialités Les hôpitaux de proximité : 5 spécialités Dr Belghiti/SG/MS 82
- 83. Le réseau intégré des soins d’urgence médicale (RISUM) accomplit sa mission selon les trois modes suivants (Art 38 D2-14-562) 1. les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P), assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ; 2. les Urgences Pré-hospitalières (UPH), assurées par 1. les moyens de transport de secours de base, 2. les services médicaux d’urgence et de réanimation (SMUR) 3. et les services médicaux héliportés (HELISMUR); 3. les Urgences médico-hospitalières (UMH), qui comprennent 1. les urgences médico-hospitalières de base (UMHB) assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux, 2. les urgences médico-hospitalières complètes (UMHC) assurées par les centres hospitaliers régionaux 3. et les urgences médico-hospitalières spécialisées (UMHS) assurées par les centres hospitaliers interrégionaux. Dr Belghiti/SG/MS 83
- 84. LES URGENCES MEDICALES DE PROXIMITE (UMP): 7 fonctions de soins d’urgence sont préconisées à ce niveau (F1 à F7) : F1 : Permanence 24/24 (Garde ou Astreinte) ; F2 : Diagnostic clinique des détresses vitales ; F3 : Gestes et manœuvres de premier secours : massage cardiaque, aspiration/libération des voies aériennes supérieures, Oxygène, pose d’une perfusion, pose d’un garrot compressif, sonde vésicale, administration parentérale de médicaments vitaux (antalgique, sédatif, antispasmodique, antibiotique, etc.), suture de plaie simple, mise en condition de l’urgent pour son transfert à un niveau supérieur ; F4 : Contention provisoire et immobilisation de fractures par attelles (minerves, attelles) F5 : Surveillance du patient (salle d’observation) ; F6 : Examen biologique de base : 3 paramètres (Automate) : NFS, Glycémie, urée ; 3 paramètres (Bandelettes réactifs) albuminurie, glucoserie, acétonurie ; F7 : Transfert sanitaire simple 24/24. Dr Belghiti/SG/MS 84
- 85. LES URGENCES MEDICO-HOSPITALIERES DE BASE (UMHB) En plus des fonctions UMP précitées, on trouve 5 autres fonctions à ce niveau (F8 à F12). F8 : Gestes de ressuscitation et de réanimation (F3 + Déchoquage cardio-vasculaire, sédation, intubation/ventilation, Sonde gastrique, monitorage) F9 : Examen complémentaire de Base : (F6 + Echographie, ionogramme, bactériologie, immunologie) ; F10 : Transfusion ; F11 : Hospitalisation ; F12 : Intervention chirurgicale (Bloc opératoire). LES URGENCES MEDICO-HOSPITALIERES COMPLETES (UMHC) En plus des fonctions des UMHB, on trouve les 4 autres fonctions suivantes à ce niveau : F13 : Fonction de réanimation hospitalière polyvalente (prise en charge complète des défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital) ; F14 : Examens complémentaires complets : (F11 + TDM/IRM, explorations fonctionnelles ou invasives, virologie, etc.) ; F15 : Transfert SMUR en plus de F9 ; F16 : Régulation des appels médicaux. Les Urgences Médico-Hospitalières spécialisées (UMHS) Urgences obstétricales, Urgences psychiatriques, Prise en charge des brûlés, oxygénothérapie hyperbare… Dr Belghiti/SG/MS 85
- 86. Article 40 (art 21 D2-14-562) Le réseau des établissements médico-sociaux est composé des : 1. Des centres dits espaces « santé-jeunes » ; 2. Des centres de rééducation physique, d’orthoptie et d’orthophonie ; 3. Des centres d’appareillage orthopédique ; 4. Des centres d’addictologie ; 5. Des centres médico-universitaires ; 6. Des centres de soins palliatifs. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de la santé. Dr Belghiti/SG/MS 86
- 87. TS interrégional 40 Spécialités cibles Région sanitaire Panier : 28 spécialités cibles CHR Province/préfecture sanitaires Panier : 20 spécialités cibles CHP Territoire sanitaire: Circonscription sanitaire Panier complet des soins de santé primaire RESSP 11 fonctions Population générale et populations cibles 16 fonctions 7 fonctions Dr Belghiti/SG/MS RISUM 16 fonctions d’urgence médicale 87
- 88. Article 5 décret « L’offre publique de soins en mode fixe est composée des quatre réseaux d’établissements de santé suivants : 1. Le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) ; 2. Le réseau hospitalier (RH) ; 3. Le réseau intégré des soins d’urgence médicale (RISUM) ; 4. Le réseau des établissements médico-sociaux (REMS). 5. L’offre publique de soins comprend, en outre, des structures spécialisées d’appui aux réseaux précités 6. ainsi que des installations de santé mobiles ». Dr Belghiti/SG/MS 88
- 89. Art 2 D2-14-562 Filière de soins: une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d’accès aux soins, représenté par le Médecin Généraliste ou le Médecin traitant relevant du secteur public ou privé, et des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent. Réseau coordonné de soins : une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Il vise le renforcement de la coordination d’une prise en charge médicale multidisciplinaire faisant intervenir des professionnels de la santé relevant du secteur public et/ou privé. Dr Belghiti/SG/MS 89
- 90. Le réseau intégré des soins d’urgence médicale (RISUM) accomplit sa mission selon les trois modes suivants (Article 38, décret) 1. les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P), assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ; 2. les Urgences Pré-hospitalières (UPH), assurées par 1. les moyens de transport de secours de base, 2. les services médicaux d’urgence et de réanimation (SMUR) 3. et les services médicaux héliportés (HELISMUR); 3. les Urgences médico-hospitalières (UMH), qui comprennent 1. les urgences médico-hospitalières de base assurées par les centres hospitaliers préfectoraux ou provinciaux, 2. les urgences médico-hospitalières complètes assurées par les centres hospitaliers régionaux 3. et les urgences médico-hospitalières spécialisées assurées par les centres hospitaliers interrégionaux. Dr Belghiti/SG/MS 90
- 91. Article 6 D2-14-562 « Les établissements de santé publics et privés peuvent dispenser, outre les prestations rendues en mode fixe, d’autres prestations de soins et services en mode mobile pour répondre aux besoins de la population au moyen de : 1. visites à domicile (VAD); 2. unités médicales mobiles (UMM) ; 3. caravanes médicales spécialisées (CMS) ; 4. hôpitaux mobiles (HM). Dr Belghiti/SG/MS 91
- 92. Offre = f (population) Clés de planification Application au RESSP : Nbre = f(population) Avec correction par le territoire: Dispensaire rural Art 22 D2-14-562 « Lorsque le territoire de desserte du centre de santé rural de premier niveau est étendu, il est possible de créer en plus dudit centre, un ou deux dispensaires ruraux qui lui sont rattachés et qui sont placés chacun sous la responsabilité d’un(e) infirmier(e) ». Etablissements de SSP Normes d’implantation Art 43 D2-14-562 C.S.R 1er niveau 7.000 habitants C.S.R 2ème niveau 25.000 habitants C.S.U 1er niveau 25.000 habitants C.S.U 2ème niveau 50.000 habitants Dr Belghiti/SG/MS 92
- 93. Offre = f (Besoins de soins et services) Hypothèse : corrélation entre besoins de santé et besoins de soins et services Besoins de soins et services : Utilisation des services de santé (la consommation de soins préventifs curatifs et promotionnels) Clés de planification : Indices d’utilisation Lits = f(utilisation hospitalière attendue) [formule] Avec correction par la population et par le territoire Dr Belghiti/SG/MS CHP Territoire provincial ou préfectoral & 200.000 habitants au moins Hôpital de proximité Territoire étendu & 70.000 habitants au moins CHR Territoire régional CHU 02 régions sanitaires ou > 2 millions d’habitants 93
- 94. Le nombre de lits à prévoir dans une région est calculé en fonction de la formule suivant : P x TA x DMS 365 x TOM • L = Nb de lits à prévoir • P = Effectif de la population • TA= Taux d’admission fixé à 7% • DMS= Fixée à 5 jours • TOM= Fixé à 80% L = •TA = Admissions/population •DMS = JH/Admissions (JH=DMS x Admissions) •TOM = Journées d’hospitalisation/365x Lits •Lits = JH/365xTOM •Lits = DMS x Admissions/365xTOM •Lits = Population x TA Dr Belghiti/SG/MS 94
- 95. Pour 2025, le nombre de lits à prévoir au niveau national est de : 36 000 000 x 0,07 x 5 365 x 0,80 • Actuellement (2014) # 37 000 lits (pub et privé) • Besoins pour les objectifs d’utilisation fixés et pour les deux secteurs • 43 150 – 37 000 = 6 150 lits L = Dr Belghiti/SG/MS = 43 150 lits 95
- 96. Régle1 : Compléter l’offre de soins > S’il n’y a pas d’ESSP, priorité aux SSP Dans le RESSP priorité au rural Si les SSP SONT DISPONIBLES, priorité à l’offre hospitalière de niveau 1 (provinciale) Si le territoire est vaste , priorité à l’hôpital de proximité (5 spécialités); Si l’offre hospitalière de recours existe, priorité à la rationalisation (production, productivité et intégration des activités) avant l’extension; Régle2 : le curatif est > Dans les SSP priorité aux activités curatives; À l’hôpital priorité à l’urgence et aux 5 spécialités de proximité, Règle 3 :Dans le curatif priorité aux médicaments Règle 4 :Dans le préventif priorité à la SE et à la lutte contre les épidémies Après la SE, priorité aux populations cibles; Après les populations cibles priorité aux maladies cibles Règle 5 :En gestion priorité à l’information sanitaire puis à la rationalisation des ressources critiques Dr Belghiti/SG/MS 96
- 97. Partie 4 GOUVERNANCE & MESURES D’ACCOMPAGNEMENT Dr Belghiti/SG/MS 97
- 98. Article 30 L34-09 « Pour assurer la cohérence des actions du système de santé, améliorer sa gouvernance et permettre la participation active des différents partenaires audit système, les instances suivantes seront instituées: 1. un conseil national consultatif de la santé: 2. un comité national d'éthique; 3. une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé: 4. une commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins; 5. un comité national de veille et de sécurité sanitaires; 6. un comité national d'évaluation et d'accréditation. Dr Belghiti/SG/MS 98
- 99. Article 52 D2-14-562 La commission nationale de l’offre de soins est présidée par le Ministre de la Santé ou, la personne déléguée par lui à cet effet. Composition (26 membres) Outre son président, la commission comprend les membres suivants : deux représentants de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, dont le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances ; un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national ; un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur ; un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ; un représentant du haut-commissariat au plan ; l’inspecteur du service de santé des Forces Armées Royales ou son représentant ; le président du conseil national de l’ordre national des médecins ou son représentant ; le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens ou son représentant ; le président du Conseil National de l’Ordre des médecins dentistes ou son représentant ; les directeurs des centres hospitaliers régis par la loi n° 37-80; l’Inspecteur général et les directeurs de l’administration centrale du Ministère de la santé ; La commission nationale de l’offre de soins peut inviter à assister à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile. Dr Belghiti/SG/MS 99
- 100. Article 52 D2-14-562 La commission nationale se réunit à l’initiative de son président et sur sa convocation. Elle est tenue de se prononcer par avis sur les projets qui lui sont soumis dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de la date de sa saisine. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les travaux et avis de la commission nationale sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président. Secrétariat: DHSA Dr Belghiti/SG/MS 100
- 101. Article 53 Décret Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi cadre n° n°34-09 précitée, chaque CROS a pour mission de donner son avis sur le projet de SROS relatif à l’espace territorial de la région concernée et sur tout projet de révision de celui-ci. Article 54 Décret Chaque CROS est présidée par le Wali de la région concernée ou son représentant. Outre son président, chaque commission comprend les membres suivants (>ou=13): les gouverneurs des préfectures et provinces de la région ou leurs représentants ; le président du conseil de la région ou son représentant ; un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national au niveau de la région ; le Président du conseil régional de l’ordre national des médecins ou son représentant ; le Président du conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’officines ou son représentant ; le Président du conseil régional de l’ordre des médecins dentistes ou son représentant ; le directeur du Centre Hospitalier interrégional, dont le siège se trouve au niveau de la région ; deux représentants de l’administration centrale du Ministère de la santé désignés par le Ministre ; le directeur régional de la santé ; les délégués du ministère de la santé aux préfectures et provinces de la région. Chaque commission régionale peut inviter à assister à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile. Le secrétariat de la commission régionale est assuré par la DRS. Dr Belghiti/SG/MS 101
- 102. Article 54 Décret Chaque CROS se réunit à l’initiative de son président et sur sa convocation. Elle est tenue de donner son avis sur le projet qui lui est soumis dans un délai maximum de 60 (soixante) jours à compter de sa saisine. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les travaux et avis de la commission sont consignés dans des procès-verbaux, signés par son président, dont une copie est envoyée au président de la commission nationale de l’offre de soins. Dr Belghiti/SG/MS 102
- 103. Ajustement au regard de la LDF 2015 et de la réforme de la loi organique de la loi des finances Redynamiser le processus de contractualisation Actualisation des budgets programmes des DRS Actualisation des conventions nationales et régionales Revisiter certains programmes sanitaires pour veiller à leur cohérence avec les dispositions de la carte sanitaire Adapter et informatiser le SNIS : Art 17 L34-09 « Il sera institué un système national d'information sanitaire qui collecte, traite et exploite les informations essentielles relatives aux établissements de santé publics et privés, à leurs activités, à leurs ressources et à l'évaluation de la dimension et de la qualité des soins ». Dr Belghiti/SG/MS 103
- 104. Accélérer les processus de normalisation Accréditation: Article 18 L34-09 « Une procédure d'évaluation des établissements de santé, publics et privés dite « accréditation » sera instaurée en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ». « La procédure d'accréditation vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité des établissements de santé ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs de leurs services sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux élaborés par un organe dénommé « comité national d'évaluation et d'accréditation» qui sera créé il cette fin. » Mise en cohérence avec le code des médicaments (L17-04) Mise en cohérence avec le projet de loi 131-13 et activation de la mise en place des textes législatifs en rapport avec l’encadrement du secteur privé Dr Belghiti/SG/MS 104
- 105. Définit l’organisation de l’offre de soins et consolide son intégration Les 4 réseaux d’établissements : RESSP ; RH ; RISUM et REMS. Introduction d’un nouveau réseau d’établissement médicosociaux Les filières, réseaux de soins et SAMU La santé mobile : VD, UMM, CMS & HM Les centres de référence et les pôles d’excellence Met en place un découpage sanitaire : Circonscription sanitaire, Préfecture et provinces sanitaires, Région sanitaire, Territoire de santé interrégional. Fixe les normes, les critères et les modalités d’implantation : des établissements de santé, des équipements biomédicaux lourds et des installations de haute technologie, Les ressources humaines pour le secteur public. Renforce la participation et la concertation : CNOS et CROS Formalise la relation entre le secteur public et privé à travers des contenus tangibles Permet la lutte contre l’improvisation des décisions Contribue à la réduction des écarts de l’offre de soins entre milieux et entre régions C’est un dynamo pour la réactivation et l’accompagnement de beaucoup de chantiers de réformes (CBM, Contractualisation, régionalisation, normalisation…), … Dr Belghiti/SG/MS 105
- 106. Partage avec les DRS/DPS (mi-déc 2014) Mise en commun et préparation des outils Techniques (nov 2014) Actualisation du BOSS Actualisation de la méthode SROS Bases des prévisions Numerus Clausus des officines Organisation du REMS Dispositions particulières de coordination: Filières, RCS et SAMU Elaboration des SROS Réorganisation du Mode mobile Réunion de la CNOS (fin janvier 2015) Réunion des CROS (Fin mai 2015) Visa par des arrêtés des SROS (Juin 2015) Régime des Autorisations Visa par le MEF des arrêtés d’appli cation MEO Cadrage du processus de m.e.o des dispositions de la loi 34-09 et du décret 2-14-562 relatifs à la carte sanitaire et au SROS Centres de référence
