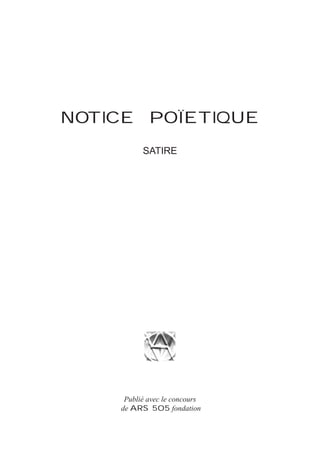
Notice poïetique
- 1. NOTICE POÏETIQUE SATIRE Publié avec le concours de ARS 505 fondation
- 3. POÏETICA Mélanges à la mémoire de MASSIMO SPINOZI ( Para-thèse de Dodoctorat ) ••• sous la direction de Denis Vermont
- 5. AVERTISSEMENT Videmus nunc per speculum in aenigmate Saint Paul I l n’y a pas de sens à attendre du texte qui se propose à toi, lecteur. Aucun sens unique et univoque tout au moins. Il met en oeuvre ce qu’on pourrait éventuelle- ment définir comme un protocole expérimental pour une possible pensée virale, celle que Bau- drillard, bon Pasteur, entend opposer au monde de l’information globalisée. Un sujet ? Le modalisme de l’image à l’époque de sa production mondialisée ! Aussi bien en est-il du personnage dont le texte flatte la mémoire posthume comme d’un perpétuel Père Ubu, égaré dans les couloirs d’une Sorbonne quelconque, bonne fortune ! En a-t-il jamais trouvé son grand amphithéâtre ! Aussi, point d’honneur qui, ici, soit en cause, Docteur. Et toute autre demeure autant lui sera riche lieu. Et s’il doit s’agir d’un portrait que ce soit aussi bien celui de Vertumne, dieu des transmutations ! Voici donc un monstrueux (tout autant merveilleux) bouquet d’O.G.M. symboliques qu’on est allé « fau- cher » dans les champs policés du SAVOIR (« organe érudition… »). Son mode d’être est la satire ; la satura latine n’était-elle pas déjà un pot-pourri, un florilège ? Avis aux agélastes ! Et après tout qu’est-ce qu’un essai ? Eliminez les paraphrases, il ne reste que des citations. SOLLERS : « C’est le multiple qui convoque le singulier pour se faire entendre. Et quand on dit que ce sont des citations, on a grand tort. Car ce sont, en effet, selon la stratégie de Picasso, des preu- ves qui doivent avoir le même niveau d’intensité que le texte lui-même. Quand je lis une thèse, je lis les citations qui sont faites et je n’ai pas besoin de savoir ce que me raconte l’universitaire. Il faut disposer d’une transversale qui est nécessaire – et là je reprends Guy Debord – dans les époques d’ignorance ou de croyances obscurantistes comme la nôtre. Il faut apporter des preuves. Et ces preuves se font par ces collages dont, dit Debord de façon très juste, aucun ordinateur n’aurait pu fabriquer la pertinente variété. » DEBORD : « Le détournement est le contraire de la citation, de l’autorité théorique toujours fal- sifiée du seul fait qu’elle est devenue citation ; fragment arraché à son contexte, à son mouvement, et finalement à son époque comme référence globale et à l’option précise qu’elle était à l’intérieur de cette référence, exactement reconnue ou erronée. Le détournement est la langage fluide de l’anti-idéologie. » BARTHES : « Il faut bien voir qu’avec le langage, rien de vraiment neuf n’est jamais possible : pas de génération spontanée ; Hélas ! le langage lui aussi est filial ; en conséquence, le nouveau radical (la langue nouvelle) ne peut être que de l’ancien pluralisé : aucune force n’est supérieure au pluriel. » VEYNE : « La poésie est du même côté que le vocabulaire, le mythe et les expressions toutes faites : loin de tirer son autorité du génie du poète, elle est, malgré l’existence du poète, une sorte de parole sans auteur ; elle n’a pas de locuteur, elle est ce qui “se dit” ; elle ne peut donc mentir, puisque seul un locuteur le pourrait. »
- 6. SKACEL: « Les poètes n’inventent pas les poèmes Le poème est quelque part là-derrière Depuis très très longtemps il est là Le poète ne fait que le découvrir. » MALLARME : « Muse moderne de l’Impuissance, qui m’interdis depuis longtemps le trésor familier des Rythmes, et me condamnes (aimable supplice) à ne faire plus que relire » KIERKEGAARD : « Une seule remarque encore à propos de tes nombreuses allusions visant toutes au grief que je mêle à mes dires des propos empruntés. Je ne le nie pas ici et je ne cacherai pas non plus que c’était volontaire » PASCAL : « Certains auteurs, parlant de leurs ouvrages, disent : “Mon livre, mon commentaire, mon histoire, etc.”. Ils sentent leurs bourgeois qui ont pignon sur rue, et toujours un “chez moi” à la bouche. Ils feraient mieux de dire : “Notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc.”, vue que d’ordi- naire, il y a plus en cela du bien d’autrui que du leur. » KUNDERA: « “Mon livre” - l’ascenseur phonétique de l’autodélectation. (Voir : GRAPHOMA- NIE.) »
- 7. TABULA GRATULATORIA Je tiens à exprimer ici ma gratitude à tous ceux qui ont permis la réalisa- tion de ce livre. D’abord à ..................... qui, depuis les travaux préparatoires à la rétrospective .................... , jusqu’à aujourd’hui, m’a témoigné sa confiance, et en souvenir des déjeuners dominicaux qui nous réunissaient autour de ............................ à ........................... . A ........................ dont le soutien constant a permis que ces travaux reprennent leur cours. A .................... , directeur honoraire de la ..................de ....... , dont la parfaite connaissance de ................. a toujours été le meilleur des soutiens intellectuels et son amitié le plus sûr des appuis. A ........................... , dont la tenue minutieuse des archives m’a évité bien des erreurs et autorisé bien des précisions. A .......................... pour ses conseils et son appui. Enfin à ceux dont la commune passion a été pour moi un ressort inesti- mable et sans la patience de qui ce livre n’aurait jamais été écrit, je veux dire Albert, Alberti, Apollinaire, Appel, Aragon, Arasse, Aristote, Arp, Arthaud, Bach, Bachelard, Bacon, Baltrusaïtis, Barthes, Basch, Bataille, Baudelaire, Baudrillard, Becq, Benjamin, Bergson, Berkeley, Besançon, Bloch, Boais- tuau, Boece, Böhme, Boileau, Borges, Bouhours, Bourdieu, Bousquet, Breton, Brown, Bruno, Brusatin, Burke, Callois, Calvino, Chalumeau, Changeux, Char, Chastel, Clair, Colonna, Comenius, Condillac, Corbin, Croce, dal Po- zzo, Dali, Damasio, Damisch, Dante, de Bergerac, de Cues, de Duve, de la Mirandole, de Loyola, de Piles, de Vinci, Debord, Debray, Delacroix, Deleuze, Denys, Derrida, Descartes, Dickie, Diderot, Didi-Huberman, Dolce, Dubuf- fet, Duchamp, Eco, Eisenstein, Eluard, Ernst, Fénéon, Ficin, Fintz, Flaubert, Foucault, Freud, Fumaroli, Gadamer, Garcia Lorca, Gassendi, Genet, Goethe, Grabar, Gracian, Grainville, Haskell, Hegel, Heidegger, Heinich, Hobbes, Hokney, Horace, Hugo, Husserl, Huysmans, Jacob, Jarry, Joyce, Jung, Kafka, Kandinsky, Kant, Kircher, Klee, Krauss, Kundera, Kupka, l’ Arétin, Lacan, Laforgue, Le Tasse, Leibniz, Leiris, Lévi, Lévi-Strauss, Lissagaray, Locke, Lomazzo, Longin, Maeterlinck, Male, Mallarmé, Manet, Marino, Masson, Matisse, Merleau-Ponty, Michaud, Michaux, Millet, Mirbeau, Monnier, Mon- taigne, Moreau, Morel, Morin, Moulin, Mozart, Munch, Nietzsche, Orphée, Ovide, Panofsky, Paulhan, Pawlowski, Paz, Pétrarque, Piaget, Picabia, Picasso, Platon, Plotin, Poincaré, Pommier, Ponge, Poussin, Proust, Pythagore, Que- neau, Rabelais, Ragon, Reclus, Reverdy, Rilke, Rimbaud, Romains, Rousseau, Roussel, Sartre, Satie, Schlegel, Schlosser, Schneider, Schopenhauer, Seznec, Shakespeare, Sollers, Spinoza, Stein, Steiner, Stirner, Stravinski, Suger, Sul- zer, Thévoz, Tristan, Tzara, Valery, Van Dongen, Vasari, Veyne, Vian, Vin- cent, Vollard, Wagner, Wilde, Wittgenstein, Wittkower, Wolfe, Yates, Zola
- 9. POSTULATS L’histoire sera conçue comme la forme graphique des phénomènes vécus, que l’homme garde dans sa mémoire collective. En tant que forme, développée dans un espace conceptuel de coordonnées chronologiques mesuré et orienté, de - à l’axe de référence zéro du hic et nunc, elle est consti- tutivement téléologique, narrative, « roman vrai ». Sa lecture, asymptote, parabole, sinusoïde … est par définition variée puisqu’elle est l’expression concrétisée des actions variables de l’homme et du monde. L’anthropologie serait la tentative, au-delà de cette lecture des formes concrètes variables du vécu, de déceler une règle quasi ou pseudo-universelle de développement des phénomènes, une fonction à multiples inconnues, mais dont les termes premiers (l’homme comme corps vivant, l’univers comme énergie en expansion, etc.) seraient des constantes sta- bles, au moins à l’échelle humaine, la seule qui nous importe, les autres n’existant pour ainsi dire pas. Il s’agirait d’écrire le programme informant du vécu, d’en déchiffrer le code génétique, le génome de l’histoire (anthropologie génétique).
- 10. POÏETICA 10
- 11. AUTOPORTRAIT PSYCHOLOGIQUE Le MOI et l’AUTRE ou la recherche d’un « lieu commun » de la pensée [ SPECULUM ECCLESIAE ] « Je veux me rendre simple, c’est-à-dire pareil à une épure, et il fau- dra bien que mon être gagne les qualités du cristal qui n’existe que par les objets qu’il laisse apercevoir » Jean Genet, Pompes funèbres Ogni pintore dipinge se Le plus simple étant peut-être d’entrer dans le cercle par la voie la plus carnée qui soit : du pathos à l’ethos. Mardi, 25 septembre 2001, Paris, Nel mezzo del cammin di nostra vita, ou presque, mi ritrovai per una selva oscura. Puis la lumière, « O Diespiter… » [ Jupiter ] JE… ( EGO ). Ego Le propos de ces lignes ( lignes écrites, lignes dessinées…) serait de définir, par approximation, quelque chose comme un « lieu » de la pensée : avant moi, en moi, au-delà de moi, hors de moi, face à moi… Si l’EGO reste le noyau dur à partir duquel je pense, on pense, ça pense, « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où… » la pensée se déploie vers des champs bien plus vastes que celui du sujet, de la conscience, du moi, du pensé même peut-être. Connaît-toi toi même, c’est traverser le cogito, si je est un autre. La psychanalyse a stigmatisé cette topologie hétérogène de l’appareil psychique, emportant avec elle les théories classiques du sujet de la con- naissance issue de la philosophie [ la schize du sujet ]. Freud décrit le moi comme une partie du ça qui se serait différenciée sous l’influence du monde extérieur. Le moi étant avant tout un moi-corps : Freud « Il peut être considéré comme une projection mentale de la surface du corps et représente la surface de l’appareil mental. »1 Le moi est en grande partie constitué par mécanisme d’identification, par ses emprunts à l’autre, Moi ce qui équivaut à lui donner la valeur d’une formation symptomatique. « Qui copiez-vous là? » demande Freud à Dora à l’occasion de douleurs aiguës à l’estomac. Le surmoi est d’abord cette première identification à l’Autre originel, le père. 1. Freud, le moi et le ça – 1923 11
- 12. POÏETICA Cet échafaudage identificatoire constitue le moi et définit son carac- tère. Il devient cristallisation chez Lacan avec la théorie de la phase du mi- Lacan roir1. L’image spéculaire est conçue comme fondatrice de l’instance du moi. phase du miroir L’identification narcissique originaire serait le point de départ des séries identificatoires. L’enfant, aux temps pré spéculaires, se vit comme morcelé, identification l’infans, qui n’a pas encore accès au langage, n’a pas d’image unifiée de son infans corps, ne fait pas bien la distinction entre lui-même et l’extérieur, n’a notion ni du moi ni de l’objet – c’est-à-dire n’a pas encore d’identité constituée, n’est pas encore sujet véritable. Avec la phase du miroir, entre six et dix- huit mois, l’image spéculaire dans laquelle l’enfant se reconnaît, lui donne la forme intuitive de son corps ainsi que la relation de son corps à la réalité environnante. Le début de la structuration subjective fait passer cet infans du registre du besoin à celui du désir ; les notions d’intérieur / extérieur puis de moi / autre, de sujet / objet se substituent à la première et unique discri- sujet/objet mination, celle de plaisir / déplaisir. Mais si le stade du miroir est l’aventure originelle par où l’homme fait pour la première fois l’expérience qu’il est homme, c’est aussi dans l’image miroir de l’autre (l’autre du miroir) qu’il se reconnaît. C’est en tant qu’autre qu’il se vit tout d’abord et s’éprouve. Les comportements des jeunes enfants mis autre face à face sont marqués du transitivisme le plus saisissant, véritable capta- tion par l’image de l’autre : l’enfant qui bat dit avoir été battu, celui qui voit tomber pleure. Le moi, c’est l’image du miroir en sa structure inversée. Le sujet se confond avec son image, et, dans ses rapports à ses semblables, se manifeste la même captation imaginaire du double. Pour Lacan la conscience, support du moi, n’a plus une place cen- trale ; le moi n’est, selon lui, que la somme des identifications successives, identifications ce qui lui donne le statut d’être un autre pour lui-même et c’est le sujet de l’inconscient qui nous interroge. C’est comme autre que je suis amené à connaître le monde : une dimension paranoïaque est, de la sorte, normale- paranoïa ment constituante de l’organisation du « je ». La psychologie expérimentale met d’ailleurs en valeur la compétence proprement humaine (vraisemblablement associée au cortex préfrontal) d’attribution à ses congénères de connaissances, d’intentions, d’émotions, pour comprendre et tenter de prédire leurs conduites. Cette compétence, selon Uta Frith, apparaît précocement au cours du développement humain, mais ne se formerait pas chez l’enfant autiste. En possédant cette faculté de se représenter les états mentaux d’autrui, et de les « théoriser », l’enfant de l’homme acquiert la compétence de représenter « soi-même comme un autre » (Ricoeur). Cette diffraction du sujet recoupe en partie ce que la biologie peut nous apprendre sur la fabrique de l’homme. Jean-Didier Vincent défini état central fluctuant le territoire de la subjectivité par le concept d’état central fluctuant dans lequel le sujet est un être unique, à la fois état et acte, représentation et action, qui s’exprime selon trois dimensions : corporelle, extracorporelle et temporelle. En effet les représentations du monde ne peuvent être con- 1. Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du « je » 1936 12
- 13. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E sidérées indépendamment des actions du sujet sur ce même monde. Ces « représentactions » sont à la fois les formes et les forces qui produisent et représentaction reproduisent le monde du sujet. Elles font du cerveau un chantier permanent qui déborde de la période embryonnaire et infantile sur toute la vie du su- jet, chantier dont la neuropsychologie, par l’analyse des lésions cérébrales, révèle les dissociations qui clivent l’unité du psychisme en processus ou compétences distincts. L’Autre lacanien dont la référence se fait dans la parole, l’Autre qui à l’extrême se confond dans l’ordre du langage et fonde l’échafaudage des identifications, n’est guère éloigné des ces représentactions. En effet si Autre lacanien l’on admet que le cerveau fonctionne comme une « métaphore agissante », c’est-à-dire dans laquelle la représentation est confondue avec l’action 1, langage alors le moi est bien ce chantier à l’intérieur duquel se construit, à travers l’Autre, le temps, le monde… et dont l’être est verbe agissant, Fiat lux. On pourrait peut-être, dans le domaine de la représentation ou de la pensée, retrouver partout une même date importante, celle de la constitu- tion de la fonction sémiotique ou symbolique, qui apparaît en nos milieux entre un et deux ans environ : formation du jeu symbolique, des images manipulation mentales, etc., et surtout, développement du langage. Il semble, nous dit la psychologie génétique, que le facteur principal qui rende possible cette fonction sémiotique soit l’intériorisation de l’imitation : celle-ci, au niveau sensori-moteur constitue déjà une sorte de représentation en acte, en tant que copie motrice d’un modèle, de telle sorte que ses prolongements, en fonction sémiotique imitation différée d’abord, puis en imitation intériorisée, permettent la for- mation de représentations en images, etc. Il y a donc une corrélation étroite entre l’opérativité et le langage, et il semble que ce soit l’opérativité qui conduise à structurer le langage, par choix au sein des modèles préexistants de la langue naturellement, plus que l’inverse. imitation Cette liaison intime entre pensée / langage et action / corps se re- trouve dans la biologie même du cerveau. Le cortex préfrontal établit, en effet, de riches connexions avec un ensemble sous-jacent de structures et de circuits nerveux appelé système limbique. Ce « cerveau des émotions » est engagé dans le contrôle des états affectifs du sujet. La réalité à laquelle opérativité / langage le très jeune enfant est exposé instruit son cerveau. Cette « éducation » est reçue dans un contexte émotionnel qui en est la condition même ; l’interpré- tation du monde à laquelle se livre le cerveau repose sur le duo passionné de la sensibilité et de l’action. Les émotions fonctionnent selon un système de processus opposants mis en places lors de réactions affectives répétées. Chaque fois que se produit un processus primaire affectif dans un sens donné ( douleur ou plaisir ), interviennent en sens inverse, des structures nerveuses responsables de processus opposants. Tout ce que le sujet connaît 1. Les études neurophysiologiques confirment l’interdépendance totale des aires motrices et sensorielles, l’observation du bébé renforce encore la notion de parenté entre le langage et les fonctions instrumentales ; les études anatomiques et surtout l’utilisation de l’image- rie médicale montrent qu’une même structure cérébrale sous-tend la fonction langagière et la manipulation d’objet, tout au moins au début du développement de l’enfant. 13
- 14. POÏETICA du monde et toutes ses actions sur ce monde font intervenir ces processus opposants qui se déroulent dans les structures profondes du cerveau qui émotions projettent sur l’ensemble de l’encéphale, notamment sur le cortex où se font les cartes cognitives, support des représentations. Dans l’espace / temps du verbe agissant s’expriment ces émotions et ces passions qui informent le déploiement de la subjectivité. L’Identité est la somme [ SUM ] toujours originale de toutes les iden- tifications à l’autre d’un individu. Son in-divisable est le trait d’union qui identité opère sur tous ces autres, la touche = qui donne la solution, touche qui est le Même en soi, trait qui est l’ardeur du désir même, Eros, amor che move il sole e l’altre stelle. Ce verbe agissant qui est amour, cet Etre du moi qui réalise le monde sur le duo passionné de la sensibilité et de l’action est l’essence du Mo- derne. La réflexion philosophique s’est tenue pendant longtemps éloignée du langage, il n’est rentré directement et pour lui même dans le champ de la pensée qu’à la fin du XIXe siècle, avec Nietzsche qui ouvre pour nous langage cet espace philosophico-philologique, où le langage surgit selon une multi- plicité énigmatique qu’il faudrait maîtriser. Dans la pensée classique, celui pour qui la représentation existe, et qui se représente lui-même en elle, s’y reconnaissant pour image ou reflet, celui qui noue les fils entrecroisés représentation de la « représentation en tableau », celui-là ne s’y trouve jamais présent lui-même, l’homme n’existe pas avant la fin du XVIIIe siècle. Déjà la con- ception kantienne du concept comme schème représente une véritable ré- schéma kantien volution, en effet la connaissance n’est plus pensée essentiellement comme une contemplation, une théorie, mais comme une activité. Nous sortons du vocabulaire de la vision pour entrer dans celui de l’action : connaître, c’est « synthétiser » ou, comme le dit Kant, « penser c’est juger ». La pra- tique prend le pas sur la théorie de sorte que, désormais, la pensée apparaît comme une construction, thème que reprend souvent l’épistémologie con- temporaine. Toute la pensée moderne est traversée par la loi de penser l’impensé, Pensée/impensée elle s’avance dans cette direction où l’Autre de l’homme doit devenir le Même Même que lui. Cette présence de l’Autre dans le Même est ce qui , nous attendant, est au-devant de nous, venant à notre rencontre ; c’est ce qui attend que nous nous y exposions ou que nous nous y fermions , c’est l’à- venir rigoureusement pensé. Le sujet et l’objet sont comme deux moments abstraits de cette structure unique qu’est la présence [ PRAESENCIA ]. Les présence « autres » ne sont pas des congénères, comme dit la zoologie, mais ceux qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un seul être actuel, présent… historicité primordiale… Or l’art et notamment la peinture puisent à cette nappe de sens brut dont l’activisme ne veut rien savoir. Une bonne part de l’art moderne (la meilleure sûrement) aura poursuivi cette tentative de perturbation de la subjectivité. Finira-t-on bien, un jour, par accorder qu’il n’aura tendu à rien tant qu’à provoquer, au point de vue intellectuel et moral, une telle crise de conscience de l’espèce la plus générale et la plus grave ? « La poésie doit être faite par tous, non par un » Poètes, peintres, sculpteurs du Moderne ont tous poursuivi, selon des 14
- 15. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E voies diverses, cette diffraction du sujet. Mallarmé recherchait la transparence du moi, où le cosmos agirait : « Il faut que je te dise qu’à présent je suis impersonnel, je ne suis plus le Stéphane que tu connaissais, mais l’une des sentes que l’univers spirituel Mallarmé a choisies pour se voir lui-même et avancer – en traversant de part en part ce qui était mon moi » ( Ecrits nouveaux ). Cette transparence fait tout le ressort d’Igitur , « Car tel est son mal : l’absence de moi, selon lui ». Guillaume Apollinaire, lorsqu’il s’intéressait au Dramatisme de Barzun [ L’ère du drame ] adhérait à la définition d’un homme capable de révéler sa vision multiple et totale de l’Individuel, du Collectif, de l’Humain et de l’Universel : La synthèse permanente de ces ordres fondamentaux et Apollinaire de leurs combinaisons infinies existe sans consentement préalable. Mais dramatisme la perception et la révélation simultanée des éléments de cette synthèse, à travers la conscience et l’âme, ne peut pas ne pas modifier profondément l’expression du chant individuel. Ainsi, ce chant, accru en intensité, perd son caractère monodique unilatéral et atteint à l’ampleur polyphonique ; ainsi, les ordres psychologiques, fondamentaux, à l’état de voix et de pré- sences poétiques simultanées, dramatisent l’œuvre ; ainsi, le poème devient drame par l’innombrable conflit de ces ordonnances, entre l’individuel et l’universel. N’est-ce pas cette même polyphonie-polymorphie qu’il évoque dans « cortège » : Un jour Un jour je m’attendais moi-même Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes Pour que je sache enfin celui-là que je suis Moi qui connais les autres […] Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes Et d’un lyrique pas s’avançaient ceux que j’aime Parmi lesquels je n’étais pas […] Le cortège passait et j’y cherchais mon corps Tous ceux qui survenaient et n’étaient pas moi-même Amenaient un à un les morceaux de moi-même On me bâtit peu à peu comme on élève une tour Les peuples s’entassaient et je parus moi-même Qu’ont formé tous les corps et les choses humaines1 Cette transparence du sujet révèle au moderne la puissance réalisante concrète de la représentation, du langage. Depuis longtemps déjà, le lan- gage prétendait à un type d’existence particulier : il n’était pas seulement un moyen vide de voir ; il existait, il était une chose concrète et même une chose colorée. Les surréalistes comprennent en outre que ce n’est pas une chose inerte : il a une vie à lui et un pouvoir latent qui nous échappe. Tout au long de son existence, le surréalisme proclame la primauté du langage. 1. Apollinaire, Alcool, Paris 1920 15
- 16. POÏETICA Langage surréalisme La similitude des hallucinations et des sensations provoquées par le sur- réalisme forçait à envisager l’existence d’une matière mentale différente de la pensée, dont la pensée même ne pouvait être, et aussi bien dans ses modalités sensibles, qu’un cas particulier. Le nominalisme absolu trouvait dans le surréalisme une démonstration éclatante, et cette matière mentale nominalisme était le vocabulaire même : il n’y a pas de pensée hors des mots, tout le surréalisme étaie cette proposition. Duchamp ne croit pas au langage, qui au lieu d’expliquer les pensées subconscientes, crée en réalité la pensée par Duchamp et après le mot. En bon nominaliste, il propose le mot patatautologie qui, patatautologie après une répétition fréquente, créera le concept qu’en vain on essaierait d’exprimer avec ces exécrables moyens : sujet, verbe, objet, etc. , faisant par là allusion au système élaboré par les logiciens de Vienne, Wittgenstein en tête, selon lequel tout langage est infinie tautologie, c’est à dire répéti- tion des prémices, système qu’il s’empresse d’accoupler à la méthode de Logiciens de Vienne pensée du docteur Faustroll . Le travail de Wittgenstein consistait à détruire Wittgenstein notre conception d’un espace mental privé (et accessible au seul moi) dans lequel les significations et les intentions existeraient avant même d’être lâ- chées dans l’espace du monde. Ce moi privé est bien mis en question dans le travail de Duchamp ; à Alfred Barr qui lui demandait pourquoi il avait usé du hasard, il répondait que c’était là un des moyen d’éviter « l’élément personnel subconscient en art » (l’autre étant, dans la facture, d’user d’un tracé purement mécanique). La caractéristique essentielle de l’art américain de la fin des années soixante [Stella, Morris, Judd, André…] sera encore d’avoir misé sur la vé- rité de ce modèle de signification débarrassé de toute tentatives de légitima- tion d’un moi privé. La signification de l’élimination de tout illusionnisme opéré par un artiste comme Stella, ne peut se comprendre qu’en relation Stella avec cette volonté de maintenir toute signification à l’intérieur des conven- tions (sémiologique) d’un espace public et de mettre en évidence la façon dont l’espace illusionniste a pu servir de modèle à l’espace privé, à l’espace du Moi conçu comme une entité constituée avant son entrée en contact avec le monde. Breton recoupe ce dépassement du moi privé lorsqu’il attribue à l’inconscient une signification et un pouvoir plus important que ne le Breton fait la psychanalyse freudienne qui l’avait inspirée au départ. Grâce à ses expériences, il aboutit à la conclusion que l’individu possède un courant inconscient, qu’il interprète comme étant une sorte de langage intérieur et Conscience universelle continuel qui s’exprime en chaque homme. Dans « Entrée des médiums », il utilise le concept de conscience universelle, une conscience qui se reflète dans le courant inconscient et qui est le point de départ des actions humaines qu’elle dicte. C’est la nature elle-même qui pour lui s’exprime directement et sans falsifications à travers ce courant inconscient et perpétuel. Hasard, rêve, humour, mythes… participent bien de ces entités culturelles suscep- tibles d’être transmises et propagées de manière épigénétique de cerveau à cerveau dans les populations humaines, ce que Dawkins nomme « mêmes », Lumsden et Wilson « culturgènes », Sperber « représentations publiques », Mêmes Cavalli-Sforza « objets culturels », et qui parasitent littéralement le cer- culturgènes veau, le tournant en un véhicule de propagation du « même » à la manière 16
- 17. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E d’un virus parasitant le mécanisme génétique de la cellule hôte. Ce modèle instructionniste est, dans beaucoup de ses aspects, con- firmé par la génétique moléculaire. La construction épigénétique d’une structure, y compris celle du psychisme, n’est pas une création, c’est une révélation, et le clivage organisme / milieu s’efface au niveau de l’orga- nisme si l’on replace celui-ci dans l’état central fluctuant. Les généticiens construction nous apprennent que les corps, ces avatars périssables d’un dieu immortel, épigénétique sont les « organismes à survie » des gènes, les véhicules qui transportent du psychisme ces derniers à travers les générations ; de « petits transparents » en som- me ! Aussi n’est-il toujours pas impossible d’approcher jusqu’à les rendre vraisemblables la structure et la complexion de tels êtres hypothétiques, qui se manifestent obscurément à nous dans la peur le sentiment du hasard, et ailleurs. Cette recherche de la transparence du sujet révèle une parenté spiri- tuelle réelle entre le surréalisme, l’art moderne dans son ensemble même, et le bouddhisme. Ce dernier ne conçoit pas la subjectivité humaine comme une constante, mais comme un élément, qui se reconstitue sans cesse dans transparence du sujet le temps. Le moi vécu dans ce mouvement perpétuel n’a pas de substance propre ( doctrine de la non-substance : Anâtman ), il est conditionné par autrui et par d’autres éléments. N’est ce pas ce qu’exprime Breton lorsqu’il bouddhisme déclare : « Qui suis-je ? Si par exception je m’en rapportais à un adage : en effet pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je « hante » ? Je dois avouer que ce dernier mot m’égare, tendant à établir entre certains êtres et moi des rapports plus singuliers, plus troublants que je pensais. » ? Le fos- sé créé entre les autres et soi est la source du cycle des renaissances et des souffrances (Samsâra). « A l’origine de toutes les souffrances je ne connais qu’une seule cause c’est l’amour et l’attachement au moi »1 . Déraciner l’ignorance la plus profonde c’est éliminer toute notion d’existence en soi, appliqué aux phénomènes ou aux êtres. Libéré de ces élaborations erronées, le méditant ne sera plus poussé à agir de manière inadéquate pour gratifier ce « moi », qu’il croyait réellement existant ; Libéré de telles actions, il sera libéré des renaissances. « Quand vis-à-vis de toutes choses intérieures aussi bien qu’extérieures, les conceptions du « moi » et du « mien » auront péri, toute soif d’existence cessera et par cette extinction, les naissances pren- dront fin »2 . A ce sujet, Octavio Paz indiquait, lors d’une conférence qu’il tenait à l’université de Mexico, que « l’objectivation du sujet », propre aux surréalistes, possède sa parallèle extra-européenne: « A près de deux mille ans d’intervalle, la poésie occidentale découvre un trait caractéristique de la doctrine centrale du bouddhisme : le moi est trompeur, c’est un essaim de sentiments, de pensées et de désirs »3. De fait, le surréalisme de Breton trouve ses correspondances les plus évidentes dans la philosophie et dans les pratiques bouddhistes. Les fondateurs de l’art abstrait – un Kandinsky, un Malevitch, un 1. Bodhicaryâvatâra, chapitre VIII-1341. 2. Mûlaamadhyamakakârika, chapitre XVIII-4 3. Octavio Paz, Essays 2, Francfort, 1980, p.276 17
- 18. POÏETICA Mondrian – justifient leur création en faisant appel à des légitimations Art abstrait métaphysiques ( l’art comme expériences spirituelles d’ordre religieux et mystiques ) issues de la pensée théosophique, dont les liens avec le boudd- hisme sont soulignés par Kandinsky lui-même : « Mme H.P Blawatzky a Kandinsky certainement été la première à établir, après des années de séjours aux Indes, un lien solide entre ces « sauvages » et notre culture. A cette épo- que naquit l’un des plus grands mouvement spirituel unissant aujourd’hui théosophie un grand nombre d’hommes, et matérialisant cette union sous forme de la « Société de Théosophie »1. Une même volonté de diffraction du sujet est ainsi à l’œuvre chez Kandinsky : La nécessité intérieure naît de trois raisons mystiques ; l’expression de ce qui est propre à l’artiste en tant que créateur (élément de personnalité : psychologie), l’expression de ce qui est propre à son époque (iconologie symptomatique), l’expression de ce qui est propre à l’art en général (le spirituel dans l’art). L’artiste doit seulement traverser avec l’œil spirituel les deux premiers éléments pour apercevoir alors ce troisième élément mis à nu. Seul ce troisième élément, celui de l’art pur et éternel, reste, selon Kandinsky, éternellement vivant. « En bref, l’effet de nécessité intérieure, et donc le développement de l’art est une extériorisa- tion progressante de l’éternel-objectif dans le temporel-subjectif ». Cette trilogie de la création recoupe étrangement la structuration cérébrale dans laquelle se nouent trois évolutions : L’évolution « génétique » des espèces, l’évolution culturelle et l’évolution « singulière » de l’individu. Le Père [ patrimoine génétique ], le Fils [ individu singulier ], l’Esprit [ culture ]. Klee « La modernité est un allégement de l’individualité »1 nous dit Paul Klee, « A des moments de clarté, il m’arrive de survoler douze ans d’évolu- tion intérieure de mon propre moi. D’abord le moi contracturé, le moi affu- blé de grandes œillères (moi égocentrique), puis la disparition des œillères et du moi, et maintenant peu à peu un moi sans œillère (moi divin) »3. La position moderne paraît ici particulièrement anticulturelle. Si les idées sont comme une vapeur qui se change en eau en touchant le plan de Dubuffet la raison et de la logique, on peut croire avec Dubuffet que le meilleur de la fonction mentale se trouve ailleurs, et comprendre qu’il aspire plutôt à capter la pensée à un point de son développement qui précède ce niveau des idées élaborées, qu’il essaye de saisir le mouvement mental au point de ses racines le plus reculé possible. L’expérimentation des hallucinogè- nes est la méthode drastique que Michaux s’est donnée pour mettre à jour cette machinerie de l’esprit, espionner l’animation secrète de ce dernier, Michaux plonger dans le vide du sujet – dans le vide chaotique du sujet, où tout est « passage » et flux innombrables d’énergie et où l’on devient : « …fluide au milieu des fluides. On a perdu sa demeure. On est devenu excentrique à soi ». Le point de départ de cette démarche transgressive est une mise en question radicale de l’ego qui s’avère une fiction dérisoire. Michaux utilise l’aliénation expérimentale comme moyen de détrôner le Roi-Ego, ce Sou- 1. Kandinsky, Du spirituel dans l’art, 1911 2. Klee, Approches de l’art moderne, Die alpen, n° 12, 1912 3. Klee, Journal, 1911 18
- 19. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E verain ridicule et prétentieux. En outre il s’agit pour lui, d’une part de voir ce « lieu de hantise » qu’est l’esprit, et d’autre part de faire entendre la mul- hantise titude polyphonique des voix qui nous constituent – « véritable prolétariat que chacun, par sa conduite dictatoriale, a en soi, caché ». Ce n’est que parce que ce dernier est constamment muselé, que chacun peut continuer à croire à une apparente et illusoire unité de sa personnalité. Le processus systématique consistant, par la rêverie, l’écriture et le graphisme, à faciliter le lâcher-prise de l’ego – et donc l’émergence de cette « communauté » in- térieure – est une caractéristique centrale du projet michaudien. Ainsi tout artiste, écrivain, peintre, musicien… dérègle les axiomes, les évidences de contradiction et d’identité. Chez lui, le même est l’autre ; l’autre est le même ; une chose peut être elle-même, et son contraire, la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement. Dada C’est l’état d’esprit Dada : Dada s’applique à tout, et pourtant il n’est rien, il est le point où le oui et le non se rencontrent, non pas solennellement dans les châteaux des philosophies humaines, mais tout simplement au coin des rues comme les chiens et les sauterelles. Le sujet, passé au filtre de la diffraction, ou plus justement débarrassé du filtre de l’individuation (d’autres auraient parlé de dévoilement) redevient ce lieu paradoxal aux limites mouvantes, en perpétuelle expansion sur le monde ; labyrinthe spéculaire des identifications assemblées [ SPECULUM ECCLESIAE ], il redéploie la conscience, fragile Ariane, dans le dédale des signes en réflexion. Iles fortunées (bienheureuse Cythère), montagnes pérégrines ou jardins clos, les diverses figures de ce locus amoenus nous ra- mènent toujours à une forme emblématique minérale. Rappelons-nous avec Fourier que le diamant est (avec le cochon !) hiéroglyphe de la 13e passion polyèdre (harmonisme) que les civilisés n’éprouvent pas. C’est l’armature de ce po- lyèdre que l’on s’attachera à mettre ici en évidence à travers les expériences picturales proposées. Si « ars » est un terme dont les multiples acceptions sont toutes convoquées pour tenter la délimitation du champ sémiologique de ces expériences, c’est dans la mesure ou, patronnées par le polyèdre Ars nova mélancolique de Dürer, il est aussi vide et ouvert que le sujet lui-même, polyphonie toujours en promesse de rénovation, perpétuel Ars Nova. Polyphonie pourrait d’ailleurs être un des mots clef par lequel abor- der le déploiement de ces peintures et dessins, leur déploiement physique étant lui-même éminemment polyptyque. « Avez-vous déjà conversé avec un icosaèdre ? » La structure que tente de mettre en place ces propositions graphiques, de par leur mode d’exposition modulaire et sérielle, relève tout aussi bien Exposition modulaire de l’intention utopique de réaliser cette chambre catoptrique que Léonard sérialité de Vinci, fasciné par les jeux de miroirs, avait imaginé construire, véritable labyrinthe optique où saisir l’homme et sa nature au piège d’une perspec- tive non naturaliste. Processus de capture de la connaissance, il impose au regardeur la radicale verticalité d’une iconostase symbolique dont l’opacité concrète se veut épreuve – traversée du miroir – et dont chaque facette se développe comme saisi momentanée, particulière, provisoire et proportion- née du Tout [SCHEMA]. Projetée en trois dimensions, cette forme n’est 19
- 20. POÏETICA pas sans évoquer l’espèce de diamant géant, monstrueux joyaux choisi par Maître Martial Canterel comme point de direction de l’esplanade de son domaine Locus Solus. éclectisme Toute prolifération est monstrueuse, c’est le principe même de la collection, et l’éclectisme stroboscopique de ces facettes polyptyques met en œuvre la barrière assourdissante à partir de laquelle peut se réaliser l’aiguillage salutaire entre distraction [ SPECTACLE ] et attention [ SA- apparition VOIR ]. Sur la trame brouillée des images exposées pourra alors se cons- truire pour le regardeur attentif le réseau des apparitions, formes vivantes, sens énoncé. Première victime à sacrifier : l’Artiste, l’Auteur, le Style [ « Est-ce que Dieu a un style ? » - Picasso ]. La notion de style appliquée aux arts plastiques n’apparaît que tardi- vement dans nos cultures. C’est dans l’entourage de Bellori, lié à l’acadé- style misme absolutiste français, que l’on a commencé à emprunter à la poétique et à la rhétorique le terme de « style », terme alors nouveau pour la théorie des arts plastiques, et qui a mis fort longtemps, sauf en France, avant d’être généralement reçu ; en définitive c’est seulement à Winckelmann qu’il doit d’avoir remporté une victoire décisive. Jusqu’alors la théorie de l’art préférait plutôt utiliser le terme de ma- maniera nière, « maniera ». Poussin lui-même ne conçoit pas la maniera comme un Poussin objet stylistique donné au peintre pas sa personnalité, sa nationalité ou son époque. La maniera recoupe chez lui la notion de mode qu’il emprunte aussi bien à la poésie qu’à la théorie musicale de son temps. Le mode selon lequel est traité un tableau doit correspondre au sujet qu’il traite. C’est le thème de la fameuse lettre sur les modes qu’il adresse à Chantelou . Ce dernier repro- chait au peintre d’avoir traité avec plus de séduction le tableau qu’il avait réalisé pour un autre collectionneur. Poussin lui fait remarquer que c’est la nature du sujet qui est cause de cet effet : « les sujets que je vous traite doivent être représentés par une autre manière. C’est en cela que consiste l’artifice de la peinture. […] Nos braves anciens Grecs, inventeurs de toutes modes les belles choses, trouvèrent plusieurs modes par le moyen desquels ils ont produit de merveilleux effets. […] Cette parole « mode » signifie propre- ment la raison ou la mesure et forme de laquelle nous nous servons à faire quelque chose, laquelle nous astreint à ne passer outre, nous faisant opérer en toutes les choses avec une certaine médiocrité et modération, et, partant, telle médiocrité et modération n’est autre qu’une certaine manière ou ordre déterminé et ferme, dedans le procédé par lequel la chose se conserve en son être. » Mode, manière ou style ( le terme d’ordre employé par Poussin y fait directement allusion ) sont bien pour lui des procédés rationnels adap- Cicéron tés à l’expression de sujets particuliers et à la production d’un certain état gamme / aptum d’âme. Cicéron, dans ses derniers dialogues, défendait lui aussi ce principe d’une gamme de styles dont l’orateur peut jouer selon les exigences de l’ap- tum, selon son sujet, ses circonstances, son public. Dans la définition de la manière magnifique de Poussin telle que nous la rapporte Bellori, des qua- tre éléments qui la constituent : la matière ( sujet, thème, contenu ), l’idée 20
- 21. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E ( conception, invention ), la structure ( composition ) et le style, ce dernier est défini comme une simple « manière personnelle et singulière industrie de peindre et dessiner, née du génie particulier de chacun dans l’applica- tion et l’usage de ses idées, lequel style, manière et goût, dérive de la nature et de l’esprit. », mettant par la en avant l’aspect d’application technique, de tour de main, « singulière industrie », que revêt pour lui cette notion . Jusqu’au XVIIIe siècle ce qui pour nous relève du style sera pris en charge par des notions d’école (classement géographique), de genres (classement thématique), de manière (classement technique). En 1764, l’Histoire de l’art de l’antiquité marqua une rupture déci- Winckelmann sive dans la théorie classique de l’art : le livre de Winckelmann proposait en effet le premier projet d’un développement historique du style à travers l’élaboration des catégories esthétiques. L’étude de l’ « essence de l’art » supposait l’identification de l’histoire des œuvres à l’histoire de la civilisa- tion toute entière. Dans ce même contexte historique du pré-romantisme l’esthétique Kantienne est venue bouleverser le contenu de la notion d’art avec en par- Esthétique Kantienne ticulier l’idée qu’à la source de toute création esthétique réside une force mystérieuse : le génie artistique original. Jusque là la théorie de l’art restait marquée par un certain platonisme. Une œuvre valait avant tout par l’éven- tuelle noblesse de son sujet et la « vérité » qui devait y régner. Dès lors, l’art lui-même ne pouvait occuper qu’une place secondaire dans le champ de la culture, après les idées qu’il servait. Contrairement aux classiques, Kant montre que l’art ne relève pas du concept de perfection. Sa mission n’est pas de « bien » présenter une « bonne » idée, mais de créer inconsciemment une œuvre inédite, douée d’emblée de signification pour tout homme. L’art n’est plus, selon Kant, au service d’un pouvoir, d’une religion, d’une quel- conque pensée formulée hors de lui. Il n’a d’autre finalité que lui-même, Finalité sans fin c’est la fameuse « finalité sans fin » qui sous-tend l’idée de l’art pour l’art et le retour sur les qualités propres qui font sa spécificité. La non-responsa- bilité de l’artiste dans l’apparition du phénomène est intéressante à noter : L’artiste de génie ne saurait suivre de règles, puisqu’il détient le mysté- rieux pouvoir de les inventer. « Le créateur d’un produit qu’il doit à son Génie propre génie ne sait pas lui-même comment se trouve en lui les idées qui s’y rapportent ». Le génie selon Kant, cette « faculté des idées esthétiques sachant rendre universellement communicable ce qui est indicible » est donc absolument à l’opposé de l’esprit d’imitation qui fondait la conception classique de l’art ; il fonde en revanche l’importance qu’a pris désormais le style dans l’histoire de l’art à travers tous les formalismes issus de la pensée kantienne. Chaque génie recommence l’art à partir du fondement. « Le génie est le talent de produire ce dont on ne saurait donner de règle déterminée, et non l’habileté, aptitude à accomplir ce qui peut être appris suivant quelques règles : par suite l’originalité doit être son caractère ». Puisque le génie donne ses règles à l’art, celui-ci, pour se manifester génial, devra laisser voir ses règles. Il y aura donc un didactisme nécessaire dans la peinture, renforcé par des manifestes ou par la formation d’écoles militantes Esthétique idéaliste et de mouvements qui constitueront autant de systèmes différents. Hegel et Schelling, les deux fondateurs de l’esthétique idéaliste sont venus complé- 21
- 22. POÏETICA ter ce système en considérant l’art comme la totalité accomplie de tous les discours fondamentaux (religieux, philosophique, politique, éthique) et, en même temps, l’organe spéculatif fondamental, un véritable « analogon » de la philosophie, une incarnation de l’Absolu ; l’artiste devenant de fait une sorte de prêtre de son propre culte. Ainsi la subjectivité en art est-elle la conséquence naturelle du Kan- tisme. Le terme de « subjectif », apparaît dans la langue française, en 1812, grâce au dictionnaire franco-allemand de l’abbé Mozin, avec le sens neuf que lui avaient conféré Kant, Fichte, Schelling. L’ensemble du mouvement romantique s’en est nourri. Dans son Salon de 1831 Henri Heine pouvait subjectivité déclarer : « Chaque artiste original, chaque génie nouveau doit être jugé d’après l’esthétique [ c’est à dire, au sens propre, d’après la manière de sentir ] qui lui est propre et qui se produit en même temps dans son œu- vre ». L’art ne propose plus à l’homme de rejoindre quelque chose, modèle concret ou concept idéal ; il part de lui-même et a pour rôle de l’exprimer dans sa particularité unique. Aussi chaque créateur sera-t-il amené à cultiver d’abord sa résonance particulière. Très vite le style n’est plus seulement conçu comme « la physiono- mie de l’âme » ( Schopenhauer ) mais aussi comme la physionomie d’une époque. Avec Rumohr (1785-1842), l’histoire accédait au statut de savoir objectif au sens moderne d’une véritable épistémologie. Les historiens de Histoire de l’art l’art comprirent alors que leur travail relevait de la faculté de connaître au sens Kantien. Pour comprendre l’art dans ce sens critique, il importait de connaître l’intention artistique du créateur. Aloïs Riegl (1858-1905) fut l’un des premiers à mettre en rapport les formes artistiques avec les caractères Wölfflin sociaux, religieux et scientifiques. Heinrich Wölfflin (1864-1945), fonda- formalisme teur de l’interprétation formaliste de l’art, qui ne s’attache pas aux contenus de l’art ( les sujets et les motifs ) mais aux procédés, aux formes, a fondé sa méthode d’interprétation des œuvres d’art sur cette proposition de base que Panofsky le style exprime l’état d’esprit d’une époque, d’un peuple. Cette proposition est reprise par Erwin Panofsky , mais ce dernier s’attache à maintenir le contenu de l’œuvre d’art au cœur de son interprétation. Il prend pour modè- le du type d’interprétation qu’il préconise la conception Kantienne de ce qui fait qu’un jugement est un jugement scientifique : ce n’est pas une opinion kunstwollen personnelle, mais son caractère de nécessité causale. Empruntant à Aloïs Riegl la notion de kunstwollen (la volonté d’art) corrigée de ses acception psychologiques possibles, Panofsky chercha ainsi à dégager la « significa- tion intrinsèque » de l’œuvre d’art en prenant connaissance de ses principes sous-jacents qui révèle la mentalité de base d’une nation, d’une période, d’une conviction religieuse et philosophique – particularisés inconsciem- ment par la personnalité propre à l’artiste qui les assume – et condensés en une œuvre d’art unique (valeurs « symboliques » en général ignorées de l’artiste, parfois même fort différentes de ce qu’il se proposait d’exprimer). L’œuvre, indépendamment des intentions psychologiques de son auteur, ne Intention artistique saurait être comprise que comme réponse à des problèmes artistiques, géné- raux ou spécifiques. L’intention artistique s’identifie aux stratégies utilisées pour y répondre, stratégies qui donnent à l’œuvre son unité et son sens. Le 22
- 23. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E style est le lieu de cette condensation du sens de l’œuvre. La majorité des l’historiens d’art se sont conformés à ce type de schéma, dans le sens d’une analyse psychologique, psychanalytique voire phénoménologique pour les uns ( Gombrich, Marcuse, Huyghe, Malraux… ), dans le sens d’une approche sociologique, politique pour les autres ( Hau- ser, Adorno, Francastel…). Dans tous les cas le discours sur le style ne peut se départir d’un dis- cours sur l’originalité qui donne sens à l’œuvre, et ce aussi bien en ce qui concerne l’art romantique que l’art moderne et contemporain. Mais la pra- tique effective de l’art d’avant-garde tend à révéler que cette « originalité » est une hypothèse de travail émergeant sur un fond de répétition et de ré- currence. Goethe aimait à dire qu’il n’appréciait guère l’originalité, au sens moderne du mot, où on l’a chargé d’une sorte d’anxiété, de désir maladif de se dissocier et de se distinguer, de refus des racines et des dépendances originalité nécessaires. « Chercher à savoir si quelqu’un a de l’originalité ou s’il doit beaucoup à un tiers, quelle folie ! Nous sommes tous des êtres collectifs ». La notion d’originalité, chère à l’esthétique romantique individualiste, n’a pas de sens pour lui. « On parle toujours d’originalité, mais qu’entend-on par là ? Dès que nous sommes nés, le monde commence à agir sur nous, et ainsi jusqu’à la fin, et en tout ! Nous ne pouvons nous attribuer que no- tre énergie, notre force, notre vouloir »1. « Au fond nous avons beau faire, nous sommes tous des êtres collectifs ; ce que nous pouvons appeler notre propriété au sens strict, comme c’est peu de chose ! et par cela seul, comme nous sommes peu de chose ! Tous, nous recevons et nous apprenons, aussi bien de ceux qui étaient avant nous que de ceux qui sont avec nous. […] Qu’y a-t-il de bon en nous, si ce n’est la force et la tendance à nous appro- prier les éléments du monde extérieur ? »2. L’idée de copie gît toujours déjà au cœur de l’original. Dans son analyse du discours de la copie Roland Barthes définit le réaliste non comme celui qui copierait d’après nature mais comme « pasticheur », comme quelqu’un qui ferait des copies de copies : Barthes/copie « Dépeindre, c’est faire dévaler le tapis des codes, c’est référer, non d’un langage à un référant, mais d’un code à un autre code. Ainsi, le réalisme […] consiste non à copier le réel, mais à copier une copie ( peinte ) du réel […] par une mimesis seconde, il copie ce qui est déjà copie »3. La neurobiologie met en évidence cette imbrication intime du couple copie / original dans l’acquisition des savoirs via le « plaisir taxonomique » et les préférences esthétiques. Nicolas Humphrey fonde les préférences esthétiques sur la faculté qui associe apprentissage et reconnaissance des invariants, la « prédisposition parmi les animaux et les hommes d’effectuer des expériences par lesquelles ils apprennent à classer les objets dans le Acquisition des savoirs monde qui les entoure ». Selon Humphrey, les « structures belles dans la nature et dans l’art sont celles qui faciliteraient la tâche de classification en présentant des évidences de relation “ taxonomiques ” entre les choses, 1. Lettre à Eckermann, 12-5-1825 2. Lettre à Eckermann, 17-2-1832 3. Roland Barthes « Le modèle de la peinture », S / Z 1970 23
- 24. POÏETICA d’une manière informative et facile à saisir »1. Le plaisir taxonomique ré- sulterait donc de la perception simultanée de la rime et de la nouveauté. La psychologie expérimentale montre que les enfants sont attirés par des sti- muli qui ne sont ni entièrement nouveaux ni complètement familiers, mais présentent des variations mineures par rapport à un original. Rime / nouveauté Mais si l’originalité ( la nouveauté ) est une variation mineure par rapport à un modèle ( la rime ), elle n’en reste pas moins essentielle, en tant que variation, dans le processus de mémorisation. Pour Cavalli-Sforza et Fellman, la sélection d’objets culturels, de « mêmes », s’effectue en deux variation étapes : l’une permissive, d’information, donne accès au compartiment de travail de la mémoire à court terme des receveurs, l’autre, active, d’adop- tion, d’incorporation à long terme dans le cerveau de chaque individu du groupe social et dans le patrimoine culturel extra-cérébral de la collectivité processus de concernée. La configuration mémorisée s’intègre à un ensemble hautement mémorisation organisé et hiérarchisé, à un « arbre taxonomique », à un système de classe- ment déjà existant avec lequel elle entre en résonance. La mise en mémoire dans cet espace sémantique et son évocation ultérieure ( facultés qu’exploi- tent les procédés mnémotechniques ) sont facilités par le caractère imagé de la configuration, mais aussi par sa nouveauté. La sélection pour l’entrée dans le long terme – la conversion de l’objet mental actif et transitoire en trace latente et stable – exclut la représentation à l’identique d’un objet naturel, ses chances pour qu’elle laisse une trace dans la mémoire à long terme seraient réduites, sinon nulles. Les figures qu’elle représente sont assez naturelles pour offrir des étiquettes de sens, des indices, requis pour le classement sémantique. Mais elles manquent de ce décalage signifiant que l’esthétique appelle style. Toute représentation met en œuvre ce déca- lage dont le caractère artificiel, singulier, souligné par le style de l’artiste et le contexte de l’œuvre, apporte la nouveauté, la distance nécessaire pour qu’elle s’inscrive efficacement dans la mémoire à long terme. La nouveauté, l’originalité ne doit donc pas être appréhendé comme Nihil novo sub sole un absolu d’invention ( rien de neuf sous le soleil ) mais bien comme un dé- calage, une variation de « mêmes ». A cet égard le tableau est un « même » d’une extrême complexité ou plutôt une synthèse complexe de « même », dont la transition et la propagation s’effectuent, par le truchement du cer- veau du peintre, d’une toile à l’autre dans l’œuvre du peintre et de l’œuvre d’un peintre à celle d’un autre. Le peintre en même temps qu’il invente, emprunte à lui-même, et surtout au autres, schémas, figures et formes qui deviennent autant d’unité de réplication, de « même », qui se perpétuent au fil de l’histoire.( maternité, mise au tombeau, paradis, sphères, grille, arbre, métamorphose, etc.) . Rosalind Krauss a montré avec force le rôle de la copie dans la pein- Krauss ture du XIXe siècle et sa croissante nécessité pour la formation du concept d’originalité, de spontanéité ou de nouveau2. Ainsi les discours sur le pitto- 1. Nicola Humphrey, « Natural Aesthétics », dans Architectures for people, 1980 2. Rosalind Krauss, L’originalité des avant-gardes et autres mythes modernistes 24
- 25. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E resque mettent en évidence que le singulier et le stéréotypé forment les deux pittoresque moitiés du concept de paysage ; pour le spectateur la singularité du pittores- que n’existe que s’il la reconnaît en tant que telle, et cette reconnaissance n’est rendue possible que par un exemple antérieur. De même la « spon- tanéité » des toiles de Monet est le résultat d’un lent travail de retouches constantes ( Monet reprit à son marchand la série des cathédrales de Rouen pour y retravailler pendant trois ans ), la touche, qui fonctionnait chez lui comme le signe de la spontanéité, relevait en fait d’une élaboration des plus calculées. Le discours de l’originalité dont participe l’impressionnisme re- foule et discrédite celui, complémentaire, de la copie. L’avant-garde comme le modernisme repose sur ce refoulement. Cette lecture post-structuraliste, en profonde rupture avec la tradition idéaliste et formaliste qui a nourri l’histoire de l’art, n’est pas sans rencon- trer certains éléments de convergence chez les acteurs même de la création artistique moderne, les artistes, que les approches symptomatiques de l’art n’ont cessé de déresponsabiliser vis-à-vis de leur propre œuvre. Ce n’est en effet nullement a un art sans finalité qu’en appelle un des fondateurs de l’art moderne, Kandinsky. Il s’indigne même contre « cet étouffement de toute résonance intérieure, qui est la vie des couleurs, cette Kandinsky dispersion inutile des forces de l’artiste, voilà « l’art pour l’art » […] la question « quoi » disparaît dans l’art. Seule subsiste la question « com- ment » l’objet corporel pourra être rendu par l’artiste. Elle devient le credo. […] en général, l’artiste, dans ces périodes, n’a pas besoin de dire grand chose et un simple « autrement » le fait remarquer et apprécier… » Parmi les trois raisons mystiques d’où naît la nécessité intérieure, l’expression personnelle (le style propre de l’artiste), l’expression sociétale (le style de l’époque) et l’expression de l’art pur et universel, c’est cette dernière com- posante qu’il nous invite à privilégier, opérant, à l’inverse du romantisme, une remontée du subjectif à l’objectif : « Et l’on voit que l’appartenance “ à une école ”, la chasse à la “ tendance ”, la recherche de “ principe ” et de certains moyen d’expression propres à une époque dans une œuvre, ne peuvent que nous égarer et aboutir à l’incompréhension, à l’aveuglement et au mutisme ». On comprend que les historiens d’art aient des réticences à prendre en compte avec sérieux les théories des artistes quand elles sont comme ici une charge radicale contre ce qui fait le travail même de l’histo- rien d’art : définir des tendances, l’appartenance à des écoles, les moyens d’expressions propres à une époque. Plus loin Kandinsky réintroduit la responsabilité de l’artiste par la liberté de ses choix stylistiques : « En bref, l’artiste a non seulement le droit, mais le devoir de manier les formes ainsi que cela est NECESSAIRE Liberté des choix à ses buts. Et ni l’anatomie, ni les autres sciences du même ordre, ni le ren- stylistiques versement par principe de ces sciences ne sont nécessaires, mais ce qui est nécessaire, c’est une liberté totalement illimitée de l’artiste dans le choix de ses moyens. » Là encore les mots même de l’artiste viennent démentir avec une certaine évidence l’édifice formaliste que l’histoire de l’art avait mis en place sur la base de la pensée Kantienne, et qu’elle a poursuivi jusqu’à aujourd’hui, poussant le paradoxe jusqu’à la farce de faire de Kandinsky l’inverse de ce qu’il se proposait de réaliser dans son projet théorique, à 25
- 26. POÏETICA savoir le père fondateur de l’art abstrait formaliste. Kandinsky - son intérêt pour le douanier Rousseau en témoigne - ne s’interdisait pas un possible re- tour vers le concret, dans la mesure ou la nécessité intérieure ( qu’il nomme honnêteté ) le lui commandait. On mesure alors combien a pu avoir d’artificiel la téléologie forma- liste d’un Michel Seuphor1 qui voyait « très clairement la filiation organi- que avec l’impressionnisme, le fauvisme, le cubisme. » et pensait tout aussi facilement « démontrer, par suites d’images, comment impressionnisme, fauvisme, cubisme, passant à travers le génie de Delaunay, de Kandinsky, Téléologie formaliste de Mondrian, et portés à leurs dernières conséquences, sont devenus ce que nous appelons l’art abstrait. ». On mesure également avec quelle naï- veté les historiens d’art formalistes américains, d’Alfred Barr à Clément Greenberg, ont pu croire à une poursuite sur leur sol de la belle aventure des révolutions plastiques en marche vers l’identité picturale ultime qui pointe à l’horizon du processus de réductions progressives de l’art moderne à son propre médium. Merleau-Ponty, qui repose les problèmes de philosophie à l’examen de la perception, souligne l’inexactitude d’une telle approche téléologique : « Parce que profondeur, couleur, forme, ligne, mouvement, contour, physionomie sont des rameaux de l’Etre, et que chacun d’eux peut ramener toute la touffe, il n’y a pas en peinture de « problèmes » séparés, ni de chemins vraiment opposés, ni de « solutions » partielles, ni de progrès par accumulation, ni d’options sans retour. Il n’est jamais exclu que le pein- tre reprenne l’un des emblèmes qu’il avait écarté, bien entendu en le faisant parler autrement »2. Matisse, autre figure fondatrice de l’art moderne, a lui aussi insisté sur le danger du style qui serait conçu comme contenu même de l’œuvre et sur le rôle primordial de la copie dans le processus de création : « j’aime Matisse ce mot de Chardin : je met de la couleur jusqu’à ce que ce soit ressemblant. Cet autre de Cézanne : je veux faire l’image et aussi celui de Rodin : co- piez la nature. Vinci disait : qui sait copier sait faire. Les gens qui font du style de parti pris et s’écartent volontairement de la nature sont à côté de la vérité » Cette importance de la copie n’est pas seulement chez Matisse l’impératif classique de « mimesis », d’imitation de la nature, il est aussi ce- mimesis lui de savoir prendre à bras le corps l’œuvre de ses prédécesseurs : « ne pas être assez robuste pour supporter sans faiblir une influence est une preuve d’impuissance ». Cette liberté vis-à-vis des influences stylistiques, est-ce chez Gustave Moreau qu’il l’a découverte : « Les styles et les modes. An- tiques. Flamand. Italiens. Héroïques. Esquisse libres. Peinture de premier jet. Rubens. Rembrandt […]. Déterminer les sujets qui peuvent être traités avec les moyens employés par ces maîtres. Bien définir les différences qui s’établissent, si les sujets sont traités dans un mode ou dans un autre (anti- que, italien, flamand). […] Mélanges piquants des différents modes, des différents styles, des éco- Gustave Moreau les les plus opposées selon les besoins du sentiment et de l’imagination. 1. Michel Seuphor, L’art abstrait 2. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris,1964 26
- 27. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E Grand clavier à connaître à fond et à manier. mélanges Sources intarissables, éternelles, auxquelles le génie nouveau ajoute manières et qu’il modifie en s’y mêlant. […] Styles Faire comprendre, par exemple, comment tel sentiment, telle idée, tel- modes le pensée, telle imagination, se trouvent modifiées par l’emploi d’un style, d’un mode différent ; à quelles cases de l’esprit, de l’âme, du cœur, s’adres- sent tels ou tels styles, tels ou tels modes. Prouver que les effets produits par l’instrument de l’artiste poète sont à l’instant modifiés par l’emploi d’un autre mode ou d’un autre style que celui qu’il a choisi »1 Picasso n’est guère éloigné de cette idée lorsqu’en 1934 il donne sa définition du peintre : « Qu’est-ce au fond qu’un peintre ? C’est un collec- tionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui même les ta- bleaux qu’il aime chez les autres. C’est comme ça que je commence et puis Picasso ça devient autre chose ». Le multiple convoque le singulier pour s’y faire collection entendre. Et quand on dit que ce sont des citations, on a grand tord. Car se sont, en effet, selon la stratégie de Picasso, des preuves qui doivent avoir le même niveau d’intensité que le texte lui même. Dans cette optique qui place paradoxalement les fondateurs de l’art moderne du côté des « clas- siques » la voix de Max Jacob, proche de celle de Picasso, nous rappelle qu’ « en matière d’esthétique, on n’est jamais nouveau profondément. Les Max Jacob lois du beau sont éternelles. Les plus violents novateurs s’y soumettent sans s’en rendre compte : ils s’y soumettent à leur manière. C’est la l’intérêt »2. Apollinaire a la même approche aux antipodes de toute téléologie. Certes, l’évolution des arts est indéniable, mais elle ne prend pas la forme d’un progrès. Le nouveau réside simplement dans la surprise de combinaisons Apollinaire inédites d’éléments préexistants. Le 11 septembre 1918 il écrivait à Pi- casso : « Je suis très content que tu aies décoré la villa biarrote et fier que mes vers soient là. Ceux que je fais maintenant concorderont mieux avec tes préoccupations présentes. J’essaie de renouveler le ton poétique, mais dans le rythme classique. D’autre part, je ne veux pas non plus revenir en arrière et faire du pastiche. Qu’y a-t-il encore aujourd’hui de plus neuf, de plus moderne, de plus dépouillé, de plus lourd de richesses que Pascal ? Tu le goûtes, je crois, et avec raison. C’est un homme que nous pouvons aimer. Il nous tou- che plus qu’un Claudel qui ne déluge avec assez de bon lyrisme romantique que des lieux communs théologiques et des truismes politiques et sociaux ». Et Picasso pouvait encore dire à John Pudney, en août 1944 : « Un art plus discipliné, une liberté moins incontrôlée, voilà la défense et la garde de l’artiste dans un temps comme le notre. C’est probablement le moment pour un poète d’écrire des sonnets » Le nouveau Apollinarien contient en effet le passé : « le sublime moderne est identique au sublime des siècles passés nouveau / classique et le sublime des artistes de l’avenir ne sera rien d’autre que ce qu’il est aujourd’hui.[…] Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». On retrouve dans cette idée l’écho explicite de la voix de Nietzsche : « Qu’est-ce que l’ori- 1. Gustave Moreau, L’assembleur de rêves , Fontfroide 1984 2. Max Jacob, L’Art poétique 27
- 28. POÏETICA ginalité ? C’est voir quelque chose qui n’a pas encore de nom, qui ne peut encore être nommé, bien que cela soit sous les yeux de tous. Tels sont les Nietzsche / originalité hommes habituellement qu’il leur faut d’abord un nom pour qu’une chose leur soit visible – Les originaux ont été le plus souvent ceux qui ont donné des noms aux choses »1. Ce n’est d’ailleurs pas forcément pour leur extra- vagante originalité que les détracteurs de l’art moderne du début du XXe siècle condamnaient les artistes mais parfois, paradoxalement, pour leur côté pasticheur . Ainsi Maurice Delcourt, dans Paris-Midi, en 1914, pou- vait-il écrire : « De naïfs jeunes peintres ne manqueront pas de tomber dans le piège. Ils imiteront l’imitateur Picasso qui, pastichant tout et ne trouvant immitation plus rien à imiter, sombra dans le bluff cubiste… » Parmi ces « violents novateurs », ces « originaux » : les peintres de De Stijl ( Mondrian, Van der Leck, Huszar, Vantongerloo, Van Does- burg etc. ). Tout en souhaitant « poser les principes logiques d’un style basé sur l’équilibre entre l’esprit de l’époque et les moyens d’expression »2, ils en arrivent à dissoudre la notion traditionnelle de style ( expression d’une De Stijl individualité, d’une nation, d’une époque ) : « La nouvelle plastique [ le néo-plasticisme ] s’oppose à l’art moderne dans toute sa diversité […] De Stijl, qui reconnaissait en Mondrian le père de la nouvelle expression plastique [ le néo-plasticisme ], amorçait la reconnaissance générale d’une force d’expression a-nationale et a-individuelle (et finalement col- lective) »3. En fondant leur art sur la construction d’une nouvelle image du monde puisée dans la pensée philosophique et mathématique du théosophe théosophie M. H. J. Schoenmaekers4 De Stijl tentait bien d’établir un Style définitif, mathématiques un quasi non-style abolissant en lui toutes les diversités stylistiques de l’art moderne. Échapper aux styles, par la géométrie, le hasard ou tout autre moyen, aura également été le fil rouge de l’œuvre si déconcertant, y compris (et surtout peut-être ) pour les historiens d’art, d’une personnalité éminente de l’art moderne, Francis Picabia. Son parcours, fait de constants revirements stylistiques, se réclame d’une attitude nettement décomplexée vis-à-vis de l’idée de copie : Picabia « Le Matin a été très fier de montrer, en première page, mon tableau du salon d’automne, Les yeux chauds, en publiant au-dessous le schéma d’un frein de turbine aérienne, paru dans une revue scientifique en 1920 ! “ Picabia n’a donc rien inventé, il copie ! ” Eh oui, il copie l’épure d’un ingénieur au lieu de copier des pommes ». Ses prises de positions polémiques vis-à-vis de nombreux mouve- ments stylistiques modernes soulignent la naïveté de ces tentatives de définition d’une méthode pseudo scientifique ou philosophique d’un phéno- mène - l’art - qu’il persiste à considérer comme insaisissable. Il s’en prend 1. Nietzsche, Le gai savoir 2. De Stijl octobre 1917 3. De Stijl décembre 1922 4. Schoenmaekers, Het nieuwe wereldbeeld (La nouvelle image du monde) de 1915, Beginselen der beeldende wiskunde (Principes des mathématiques plastiques) de 1916 28
- 29. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E ainsi violemment à ses anciens amis de la section d’or : « Ils ont cubé les tableaux des primitifs, cubé les sculptures nègres, cubés les violons, cubé les guitares, cubé les journaux illustrés, cubé la mer- de et les profils de jeunes filles, maintenant il faut cuber de l’argent !!! »1. Répondant à Gleizes, l’instigateur du renouveau de la section d’or, qui avait épuré son groupe des perturbateurs quelques jours auparavant : « Son appareil sexuel, ainsi qu’il le nomme élégamment, à quoi peut-il bien lui servir ? Sans nul doute à construire du cubisme aquatique ! »2. Il déclare ailleurs : « Le cubisme représente la disette des idées ». Après avoir réguliè- rement attaqué le purisme de « l’esprit nouveau » le surréalisme devient la cible privilégiée des derniers numéros de sa revue 391 : « (le surréalisme) de Breton, c’est tout simplement Dada travesti en ballon-réclame pour la maison Breton et Cie »3. Dans son œuvre même cette critique radicale des styles passe par l’ironie d’une multiplication des poses stylistiques et de leurs appareillages théoriques modernes : les manifestes. Le numéro spécial de la revue Ca- mera Work de juin 1913, consacré à l’œuvre de Picabia, nous révèle son cynique « Manifeste de l’Amorphisme » : « prenons l’œuvre géniale de Po- paul Picador : Femme au bain ( ici, un carré blanc signé Popaul PICADOR ) Cherchez la femme, dira-t-on, quelle erreur ! […] Prenons maintenant La mer, du même artiste. ( ici, le même carré blanc, pareillement signé). Vous ne voyez rien au premier regard. Insistez. Avec l’habitude, vous verrez que l’eau vous viendra à la bouche. Tel est l’amorphisme ». Dans le même es- amorphisme prit le dernier numéro de 391 se terminait sur l’annonce de Relâche, « Bal- let instantanéïste ». Picabia a précisé ce rejet des styles dans son « Manifeste du bon goût » :4 « Je compte faire de la peinture qui, je l’espère, ne sera jamais clas- sée en “ iste ”, mais sera tout simplement une peinture Francis Picabia, la « iste » plus jolie possible, une peinture imbécile, susceptible de plaire à mon con- cierge, aussi bien qu’à l’homme évolué, une peinture qui n’ira pas chercher dans les musées ce que les conservateurs y ont enterré ! ». Un tel texte n’est pas sans mettre en évidence la profonde divergence de vue en matière d’art que les artistes modernes majeurs ont pu avoir par rapport aux historiens d’art, divergence qu’ils partagent avec les poètes : « D’ailleurs, pour saisir une œuvre d’art, rien n’est pire que les mots de la critique. Ils n’aboutissent qu’a des malentendus plus ou moins heu- reux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s’accom- Rilke/critique plit dans une région que jamais parole n’a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d’art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que 1. Manifeste DADA, 391 n° 12 mars 1920 2. Cannibale, n°2, mai 1920 3. 391 n°19, octobre 1924 4. Picabia, « Manifeste du bon goût » [ mai 1922, paru dans Temps mêlés, n°59-60, oc- tobre 1962 29
- 30. POÏETICA côtoie la nôtre qui passe »1. Quels enjeux traversent donc cette notion de style – enjeux philo- sophiques, enjeux politiques, enjeux économiques – pour qu’elle demeure si indispensable aux uns (historiens, théoriciens), et si problématique aux autres (artistes, poètes, écrivains) ? Pour Bourdieu, l’ambition qui, à l’origine, ne se souciait que de l’authenticité de l’art, suscite en fait une Bourdieu « dialectique de la distinction », en vertu de laquelle les artistes se font Dialectique de la concurrence en se distinguant à la fois les uns des autres et de la génération distinction précédente, concurrence qui est renforcée par la dynamique économique qui se développe sur le marché des biens culturels. A la fin du XIXe siècle le système académique ne pouvait fonctionner sans l’apport financier du marché artisanal de l’imitation alors en plein essor. Le tarissement de ce marché provoqué par l’invention de la photographie a remis en cause toute l’organisation du marché de l’art. Pour que celui-ci survive, les marchands, acteurs centraux du nouveau système, ont promu une nouvelle convention stylistique de qualité, l’originalité (comprise dans ses deux conceptions de nouveauté et d’authenticité), qui est devenu jusqu’à aujourd’hui le principal critère d’appréciation esthétique et par suite économique des oeuvres. D’un côté la perception compétente du marchand est à l’affût de la moindre singularité, mais elle doit aussitôt traiter et évacuer ses singularités à coup de labels et de catégorisations qui donnent un ordre, même provisoire, à cette diversité. La notion d’avant-garde se révèle ainsi intimement structurée par le marché et son impératif de nouveauté tournante, de mode et de publicité. Simple ra- tionalisation d’une valeur d’échange qui ne cesse de s’étendre au détriment de la valeur d’usage, les styles artistiques sont-ils aujourd’hui autre chose qu’un simple démarcage publicitaire ? La « stylistique », cette étude – plus ou moins scientifique – du style dans l’ordre de la langue, mais ses résultats sont traditionnellement trans- posables aux expressions plastiques (ut pictura poesis), se différencie selon la définition plus spécifique, étroite quelle se donne du style. Elle discerne au moins deux significations et deux emplois du mot : tantôt il désigne un système de moyens et de règles mis en jeu dans la production d’une œuvre, tantôt il définit une propriété et singulièrement une qualité. Si l’on met l’ac- cent sur l’antériorité et l’autorité du système par rapport à la production, on définit le style comme collectif et on l’emploie comme un concept opéra- toire pour un savoir dont la principale ambition est de recenser et de classer, comme un instrument de généralisation ; si au contraire on met l’accent sur la transgression du système, sur la novation et la singularité, on définit le style comme personnel, et on lui assigne une fonction individuante. La théorie classique, telle qu’elle a longtemps été mise en œuvre, vise elle-même la pratique ; la détermination du style ne sert pas à classer après coup des objets, mais à prescrire leur fabrication. Ainsi le style n’est pas pensé comme système d’effets, mais comme système de moyen, comme l’indique l’étymologie du mot. Il recoupe en partie des notions comme les genres, les modes, les écoles ou les manières. 1. Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète 30
- 31. A U TO P O RT R A I T P S Y C H O L O G I Q U E La stylistique moderne, animée par le même souci de positivité que la linguistique à laquelle elle se rattache, renonce aux fonctions normatives et critiques de la rhétorique classique. Mais si elle s’interdit de juger les œuvres, elle ne renonce pas à leur examen. Du même coup elle se partage entre deux disciplines, qui répondent aux deux conceptions du style que nous avons distinguées : d’une part ce que Pierre Giraud appelle une stylis- tique de l’individu, d’autre part une stylistique de l’expression. La première, génétique, traite de l’art singulier de l’écrivain ou de l’artiste ; son but est de découvrir d’où vient que l’auteur, l’artiste ait ce style. En réaction contre cette démarche intellectuelle qui, depuis un siècle et demi au moins, cherchait à percer le secret des causes du style – c’est à dire du « génie » - [ on mesure dans ce courant le poids de la pensée de Kant ], est né, au début du XXe siècle, la seconde, descriptive, qui met en lumière stylistique descriptive le pouvoir ou les propriétés de la langue, des formes dans le domaine plas- tique. La stylistique descriptive, sans répudier la stylistique génétique, met plus fortement l’accent sur la nécessité de décrire d’abord en quoi consiste le style, avant d’en rechercher les explications de tous ordres. Conformément à cette approche dichotomique de la notion de style Roland Barthes a tenu à distinguer sa conception du style de celle de l’écri- ture. Dans Le Degré zéro de l’écriture, réfléchissant sur la littérature et la façon dont elle se signifie au lecteur, il rapproche la notion d’écriture de ce Barthes que l’on a appelé le style collectif : elle fait, là au moins où elle est plurielle, style / écriture l’objet d’un choix ; en opérant ce choix, l’écrivain accepte le pacte qui le lie à la société, il se situe dans une aire sociale, s’engage dans une histoire, prend parti. Le style, lui, a ses références « au niveau d’une biologie ou d’un passé, non d’une histoire » ; il constitue un langage autarcique, où se révèle la solitude de l’écrivain ou de l’artiste ; il fonctionne à la façon d’une nécessité (une nécessité intérieure qui n’est pas sans rappeler celle qui nour- rit l’acte créatif de Kandinsky), « comme une espèce de poussée florale », exprimant le pacte qui noue la chair du monde : il est du côté de la Nature - qu’on pense aussi à Klee : « Ce lieu où l’organe central de tout mouvement dans l’espace et le temps – qu’on, l’appelle cœur ou cerveau de la création – anime toutes les fonctions, qui ne voudrait y établir son séjour comme artiste ? Dans le sein de la nature, dans le fond primordial de la création ou gît enfouie la clef de toute chose ? »1 - . Le style est issu des profondeurs du corps : il est la trace d’un geste, au sens littéral une manière. Mais il en est style / corps aussi la maîtrise ; et c’est pourquoi, si naturel qu’il soit, il se conquiert. Barthes souligne par ailleurs que cette marque de l’ouvrier sur son ouvrage n’est pas expression de soi, ce n’est pas l’auteur, l’artiste, qui parle en première personne, c’est l’œuvre qui parle en personne : c’est elle qui porte témoignage du geste, du travail singulier qui l’a produite, et le créa- geste teur n’est rien d’autre que le fils de ses œuvres. La fonction du concept de style est donc exactement inverse ici de celle de l’écriture comme style col- lectif. Avant que ne cherche à s’élaborer une science du style, cette fonction se manifeste au mieux dans la pratique de l’expertise, qui a été longtemps la 1. Klee, De l’art moderne, conférence prononcée à Iéna en 1924 31
